Cela fait longtemps qu’on en parlait, c’est maintenant une obligation, les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent procéder régulièrement à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent aux usagers.
Interne, cette évaluation est un processus continu qui n’est pas une « auto-évaluation » puisqu’il se réfère à des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Le compte-rendu de cette évaluation doit être communiqué tous les cinq ans aux autorités de contrôle.
Externe, l’évaluation est conduite par un organisme extérieur selon un cahier des charges édicté par le ministère des affaires sociales. Son résultat conditionne le renouvellement de l’autorisation (maintenant limitée à quinze ans). Elle intervient tous les sept ans (soit deux évaluations externes avant le renouvellement de l’autorisation).
Il apparaît que les enjeux de ces deux niveaux d’évaluation doivent être distingués, pour pouvoir en repérer les différences de nature. L’évaluation externe peut se confondre avec une procédure de contrôle, d’autant que l’avenir de l’établissement ou du service dépend de son résultat. L’évaluation interne peut, quant à elle, dériver vers une autolégitimation. Pour tenter de les distinguer l’une par rapport à l’autre, nous pourrions dire que l’évaluation interne est synchronique alors que l’évaluation externe est diachronique.
L’évaluation externe se situe dans un espace temps dynamique : celui du rythme d’évolution et d’adaptation de l’institution à son environnement (commande publique ou mission, territoire et besoins, publics cibles). Son tempo établit un relevé de mesures à échéances fixes, réalisé par un tiers, qui porte plutôt le regard sur la qualité des procédures internes (y compris l’évaluation), la cohérence du projet avec le cadre de la mission (schéma d’organisation, convention et habilitation, cadre législatif de la mission), les effets de l’action sur les usagers et l’environnement, l’adéquation des moyens.
L’évaluation interne, parce qu’elle est un processus continu, se situe dans l’instant de l’observation. L’absence de prise de recul – notamment parce qu’elle n’est pas conduite par un tiers – la situe dans une dimension synchrone avec le fonctionnement institutionnel. Le regard se porte alors sur le projet, son rapport à l’usager et à ses besoins, son rapport avec la commande publique qui le légitime, l’impact des actions sur les usagers et le contexte de l’institution. Cette évaluation vise à produire, si besoin, des corrections immédiates de la trajectoire institutionnelle par des mesures modifiant le fonctionnement ou le projet[1].
Si nous acceptons ce premier essai de distinction entre les deux évaluations à conduire, nous pouvons dire que l’évaluation interne, parce qu’elle est synchronique, concomitante à l’action, a particulièrement besoin d’avoir du sens. Faute de cet effort axiologique, elle ne serait qu’un instrument technique qui riverait nos regards aux semelles de nos chaussures. Cet article voudrait essayer de montrer que l’évaluation interne peut tout à fait être un dispositif technique qui donne du sens à l’action.
.1. La loi 2002-2 : un nouveau contexte pour l’action
L’obligation pour les établissements et services d’évaluer leurs pratiques, apparaît à un moment historique particulier qu’il faut repérer dans sa nature pour bien comprendre ce qui est en jeu.
La mobilisation de nouveaux outils
La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale est en train de provoquer, dans les établissements et services, ce que nous pouvons appeler une « technicisation des processus »[2].
De nouvelles normes prévalent au pilotage des institutions : normes de droit, normes de marché, normes de production. Dans une société qui évolue selon des rythmes accélérés, la production normative, codifiée à travers le droit positif, est de plus en plus abondante (au risque parfois de dépasser les capacités d’appropriation, par les acteurs, de ces nouvelles normes). La loi 2002-2, et la pléthore de ses décrets d’application, en est l’illustration. A travers ces textes réglementaires, toujours plus précis, se construisent des protocoles d’intervention qui colorent différemment la « production » des services sociaux et médico-sociaux.
Dans la même dynamique, apparaissent au cœur des institutions, de nouveaux dispositifs d’intervention, de nouveaux moyens de régulation et de contrôle, de nouvelles méthodes de gestion. Nous pensons ici aux outils garantissant le droit des usagers, aux procédures d’évaluation interne et externe, aux indicateurs budgétaires, mais aussi au rôle imputé aux schémas d’organisation, aux formes de la tarification, etc.
A travers ce mouvement, se dessinent de nouveaux objets qui ont pour fonction de soutenir l’intervention. Nous pouvons parler de technicisation des procès parce que ce sont des objets techniques qui servent de support, qui permettent et orientent l’action. Ces objets techniques ne sont pas neutres. Ils s’inscrivent dans une forte interaction avec le milieu dans lequel ils se développent, résultant de ses caractéristiques propres (notamment culturelles) et influençant fortement son évolution.
C’est dans ce contexte technique nouveau que s’inscrit l’évaluation. Elle n’est pas un dispositif technique qui « tombe du ciel » sur les craintifs gaulois qui peuplent les établissements et services. Elle en est l’émanation car c’est bien ce milieu technique qui en permet l’émergence. Elle est aussi le produit de l’air du temps qui sollicite plus de lisibilité et de visibilité – notamment de la part des politiques – pour les institutions. Finalement, l’évaluation nous permet de dire que les institutions du social ne sont pas des êtres purs au paradis des esprits mais en interaction forte avec l’environnement et ses transformations constantes.
Une modification des repères
Il est inévitable que ces mutations profondes des cadres et des référentiels de l’action modifient les repères quotidiens des intervenants. Confrontés à ce qu’il convient d’appeler un « choc culturel », les intervenants du travail social dénoncent à la fois une judiciarisation et une marchandisation de l’action sociale, qui entraînent une perte de « l’âme du métier ».
Judiciarisation en ce sens que le recours au juge pour arbitrer les différends est de plus en plus fréquent, exposant les professionnels à l’injonction de se justifier devant les tribunaux : impression que le magistrat viendrait remplir le vide laissé par la déliquescence de la qualité des liens sociaux.
Marchandisation en ce sens que l’intervention se réduirait à une simple prestation de service, quantifiable et mesurable au même titre et de la même manière que n’importe quel autre bien de consommation courante, sorte de banalisation de cette éminente et noble tâche qui consiste à porter secours et assistance aux plus vulnérables de notre société.
Nous pouvons avoir une autre lecture de ces phénomènes, ou plutôt une lecture plus complexifiée. Par ces changements des repères qui structurent le travail, nous assistons à une publicisation des processus. L’action n’est plus circonscrite à la relation duelle entre l’intervenant et le bénéficiaire, ni même dans l’espace confidentiel de l’institution. Elle se diffuse dans l’espace public sous au moins deux formes : L’exposition des litiges sur cette nouvelle agora qu’est le judiciaire – arbitrage républicain qui est en fait une forme contentieuse d’évaluation de la justesse des pratiques ; L’exposition des actions sur le marché des produits de consommation – désacralisation de l’intervention sociale qui conquiert ici ses lettres de noblesse dans une société matérialiste dominée par l’économie de marché.
C’est sur ce fond de bouleversement des repères qu’émerge l’évaluation. Elle peut alors être conçue comme un moyen de redéfinir des repères, d’en confirmer certains qui constituent les fondamentaux incontournables de l’intervention sociale, de supprimer ceux qui n’ont plus de pertinence, d’en construire de nouveaux, plus adaptés aux besoins de balises, de points d’horizon qu’ont aujourd’hui les acteurs, professionnels et usagers.
.2. La qualité : du projet associatif au projet personnalisé
Sur cette trame de la technicisation, l’évaluation se détache comme un mode de régulation assez puissant. La loi 2002-2 réfère très explicitement l’évaluation à la qualité des prestations[3]. En effet, que peut-on évaluer si nous n’avons pas préalablement défini le système de valeur qui sert d’étalon à la mesure des actions ?
Du côté des valeurs …
Dans la culture du travail social, le recours aux valeurs est fréquent. Cela peut sembler logique quand on pense aux fondements humanistes qui servent de mythe fondateur aux institutions sociales, tant religieuses que laïques. Cependant, il ne suffit pas de dire « valeurs ! valeurs ! » pour donner une réelle plus-value à l’action. L’incantation et l’effet d’annonce sont des effets de manche qui ne garantissent aucune consistance ni aucune qualité aux actions réelles. Il nous faut donc aller voir ce que pourraient être les valeurs qui font la qualité du travail social.
La question de la valeur de l’action sociale se pose d’abord, me semble-t-il, comme une question politique. En effet, la production de services d’aide à la personne, dans une société qui s’est construite sur la notion de solidarité, représente un enjeu politique de premier plan. D’abord parce que l’existence de personnes fragiles – handicapées, âgées, en difficulté sociale, exclues – menace implicitement l’ordre établi et l’idéal sociétal. Ensuite parce que la capacité de la société à mobiliser une partie de ses ressources pour traiter les problèmes sociaux est un débat de fond sur les orientations collectives : faut-il ralentir la marche en avant des «vainqueurs» au nom de la solidarité avec ceux qui sont «à la traîne» ?
En fait, et de manière sensiblement différente des sociétés anglo-saxonnes, la question de la valeur de l’action sociale se pose, en France, comme une question démocratique. Plus de deux siècles après l’affichage politique de l’utopie des droits de l’homme, la capacité de chacun à participer au bien commun reste une préoccupation forte du débat public. Si nous nous référons à l’article premier de la loi rénovant l’action sociale, comme de nombreuses autres lois sociales, le souci d’intégration citoyenne de la personne (qu’elle soit porteuse d’un handicap, qu’elle sollicite le RMI, qu’elle soit malade ou sans domicile fixe ou âgée et limitée dans son autonomie) est annoncé comme une priorité. La valeur de l’action sociale tient à sa capacité à maintenir ou à réintroduire ses bénéficiaires dans le périmètre démocratique, c’est-à-dire à participer à la délibération collective.
Du côté de l’éthique …
En sus de ces valeurs politico-démocratiques de l’action sociale, il est souvent fait référence à l’éthique. L’éthique traite de la conduite des sujets, en référence à des principes moraux. Elle est ce «supplément d’âme» qui légitime l’action et la différencie de comportements automatiques ou routiniers qui n’interrogeraient pas le sens de ce qui est fait. C’est là une valeur forte, souvent affirmée par les professionnels, qui place l’intervention sociale aux antipodes de l’activisme. La particularité de ce champ d’intervention est d’opérer un retour incessant sur le sens de l’action, de toujours l’interroger.
Cette valeur de l’action sociale, politique et éthique, se dévoile essentiellement par le Projet. Ce Projet avec un grand « P » est en fait la déclinaison de plusieurs niveaux de projets qui s’articulent entre eux dans un souci de cohérence.
Et la cohérence …
Les politiques publiques font partie d’un projet global de société, elles en dessinent le contour toujours mouvant et fortement évolutif. Elles sont le premier lieu où s’énoncent un certain nombre de repères qui fixent les perspectives du « vivre ensemble ». Une politique sociale de qualité est une politique en phase avec les attentes des publics concernés, avec les ambitions de l’intégration citoyenne.
Ce niveau d’orientation se décline ensuite au plan des acteurs qui transforment ces cadres référentiels en actions concrètes. Dans le champ de l’action sociale et médico-sociale, constitué pour les trois quarts d’associations loi 1901, le projet associatif est un enjeu central de la qualité des dispositifs et des actions.
Le projet associatif prend forme dans le projet d’établissement ou de service. C’est là que sa qualité s’enracine dans les pratiques concrètes des acteurs de terrain.
Enfin, c’est le projet personnalisé qui achève ce jeu interactif entre des natures et des niveaux différents de projets. Nous entrons ici dans le domaine de la clinique – cette capacité à se tenir « au chevet » de l’autre – qui doit conserver une vraie cohérence avec les autres niveaux de projet. Le projet personnalisé est contenu par le projet d’établissement, il ne peut en sortir au risque de provoquer une dérive du cadre institutionnel. Cependant, l’interaction entre les différents niveaux de projet, pour éviter que le projet d’établissement ne soit un carcan figé, amène le projet d’établissement à évoluer sans cesse (il doit désormais être réécrit tous les cinq ans) pour s’adapter à l’évolution des projets personnalisés.
La qualité, dont la définition est la condition préalable à toute forme d’évaluation, serait cette construction patiente, souple et réactive, de plusieurs plans de projets, articulés entre eux, cohérents et interactifs, référés à des valeurs qui s’inscrivent, pour l’action sociale, dans les registres politique et éthique.
.3. L’évaluation interne : outil de la conduite du changement
L’évaluation émerge de ce moment historique marqué par la technicisation et de ce débat sur les valeurs de l’intervention comme un outil qui n’est cependant pas exempt d’ambiguïtés.
Evaluation ou contrôle ? La notion de « bonnes pratiques »
Si l’évaluation externe est menacée de dériver vers une forme de contrôle indirect par les autorités chargées de l’autorisation et de son renouvellement, l’évaluation interne peut devenir une forme insidieuse de contrôle hiérarchique. Seule la mobilisation effective de tous les acteurs (administrateurs, professionnels, usagers) peut éviter ces ornières. Cela suppose que tous les niveaux hiérarchiques de l’organisation présentent les garanties nécessaires pour ne jamais utiliser le processus d’évaluation dans le sens d’une introspection soupçonneuse des conduites individuelles. Ce rapport de domination que peut révéler l’évaluation concerne autant les liens entre salariés qu’entre les professionnels et les usagers.
Les choses se compliquent quand on sait que l’évaluation interne doit être conduite « au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements ou de services, par un Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale [4]» Par l’expression « bonnes pratiques » se dévoile un autre risque : l’évaluation ne serait qu’une pratique de contrôle de la conformité à des normes. Dans ce cas, l’évaluation se borne à mesurer des écarts entre les pratiques référencées comme « bonnes » et les conduites concrètes des opérateurs, a priori suspectées d’être « mauvaises ». Ce découpage de la réalité en bon et mauvais révèle une vision normalisante et moralisante de la conduite des institutions. Vision qui peut être celle des décideurs politiques qui ont concocté les textes législatifs, vision qui pourrait être celle des équipes de direction qui utiliseraient là l’opportunité d’imposer un conformisme rassurant.
La définition des conduites attendues par le « bien » – telle par exemple la notion de « bientraitance » – fixe définitivement, et de manière étroite, le rapport à la norme. Cette norme devient unique, univoque, fixée et sans évolution possible. Tout comportement décalé par rapport aux bonnes pratiques est jugé mauvais et renvoie son auteur dans l’enfer du « mal ». C’est le principe du pouvoir dictatorial qui définit les comportements autorisés : tout ce qui n’est pas autorisé est réputé interdit[5].
Une autre approche de l’évaluation consiste à l’envisager comme un moyen de visibiliser et de négocier le rapport qui évolue sans cesse entre les normes et les conduites[6]. Cela suppose de convenir que la norme est un construit social provisoire et fortement soumis aux rapports sociaux, à leur violence et à leur évolution. L’évaluation est alors un jalon posé à un moment précis de l’histoire de l’institution qui met en lumière les postures réelles des catégories d’acteurs au regard des postures idéales projetées dans l’organisation. L’évaluation, vue sous cet angle, ne dit pas si les acteurs sont « bien » positionnés, elle constate les positions tenues et leur plus ou moins forte congruence avec les positions souhaitées. L’évaluation met en mouvement le rapport entre objectivité et subjectivité.
C’est à ce prix que l’évaluation sera un outil de conduite du changement et non un moyen de contrôle figeant les façons de faire dans le marbre du conservatisme.
Evaluation et management : la place des usagers
L’évaluation interne, envisagée comme un outil technique dynamique, inscrite au cœur du débat éthique et politique, référée au projet associatif et d’établissement ou de service, envisagée comme le moyen de mettre en mouvement les conduites et les pratiques des acteurs est un véritable outil de management, une opportunité pour mobiliser tous les protagonistes.
Si nous discernons quelques manières de mobiliser les professionnels autour des enjeux de l’évaluation interne, cela peut paraître plus complexe en ce qui concerne les usagers. Pour éclairer ce point, il faut analyser les positions respectives des professionnels et des usagers pour tenter de repérer les places et les rôles. Nous pourrions nous contenter d’une vision simpliste avec d’un côté le professionnel « producteur » du service et de l’autre l’usager « consommateur » ou « bénéficiaire ». Autour de l’idée de « co-production » qu’avance Jacques T. Godbout[7], nous constatons que la production d’un service – social ou médico-social – n’est pas l’apanage d’une seule catégorie d’acteurs mais le résultat d’une interaction complexe entre l’intervenant et le destinataire de l’aide. Autrement dit, la qualité de l’action dépend du niveau de technicité du professionnel, mais aussi des qualités de l’usager (capacité de réception de l’aide, capacité à s’inscrire dans l’échange, capacité à tirer profit de l’action, etc.) et peut-être surtout de la qualité de l’interaction entre les deux acteurs.
L’évaluation de la qualité d’une action, outre les éléments de contexte et d’impact qu’elle aura à analyser, doit s’intéresser aux qualités professionnelles de l’intervenant, aux qualités d’usage du bénéficiaire, aux qualités de l’échange et des interactions entre eux. Cela impose donc un regard croisé entre usagers et professionnels. C’est le croisement de ces approches qui garantira la vision circulaire nécessaire à une évaluation complète d’une situation.
Cela suppose donc que les référentiels d’évaluation ne soient pas construits par les seuls professionnels. Nous pouvons, en fait, envisager trois types d’indicateurs à retenir pour l’évaluation interne :
- Les critères d’évaluation élaborés par les professionnels entre eux : ces critères se fondent sur la technicité des équipes, leur compétence professionnelle, la spécificité de leur rôle et de la place qu’ils occupent dans l’institution ;
- Les critères d’évaluation élaborés conjointement entre professionnels et salariés : ceux-ci sont le fruit des instances collectives de travail – dont essentiellement le conseil de la vie sociale – et des rapports d’usage qui structurent l’institution, faisant émerger des représentations partagées qui peuvent se traduire en conceptions communes ;
- Les critères d’évaluation élaborés par les usagers eux-mêmes : la culture du milieu a sans doute moins préparé les acteurs à l’apparition de ces critères, externes au champ professionnel, qui proviennent des organisations autonomes d’usagers (association de défense des intérêts de telle ou telle catégorie de bénéficiaires qui élaborent leurs propres critères d’une « bonne prise en charge »).
Ces trois catégories d’indicateurs nous amènent à affirmer l’intérêt et l’importance, pour une évaluation réellement panoramique de l’établissement ou du service, de référentiels spécifiques et distincts aux professionnels et aux usagers. L’existence de ces critères, élaborés selon des trajectoires différentes (trajectoires des professionnels d’une part, parcours d’usagers de l’autre), représente une richesse et une complémentarité originale pour l’évaluation interne. La reconnaissance de critères fortement différenciés alimente la conflictualité nécessaire pour que l’évaluation contribue à l’enrichissement de l’espace démocratique dans et à l’entour des établissements et services.
Au plan méthodologique et stratégique, cela suppose de construire – ou de faciliter la construction – d’espaces d’évaluation autonomes. Nous pensons ici à ceux que les usagers pourront se donner dans l’institution et qui ne seront ni téléguidés ni contrôlés par les professionnels. L’enjeu consiste à ce que les usagers se saisissent eux-mêmes de leurs droits et se donnent les lieux et les moyens d’évaluer la qualité des prestations qu’ils reçoivent et, surtout, de faire connaître leur propre évaluation qui participe de l’évaluation interne.
L’évaluation interne, peut ainsi se concevoir comme le croisement de plusieurs approches évaluatives, comme la somme de points de vue différents et comme le résultat du débat interne qui met en valeur des positions et des stratégies d’acteurs.
A première vue, il peut apparaître qu’une conception de l’évaluation qui va aussi loin dans la participation des usagers complique singulièrement la perspective d’action. Cela nous semble être le moyen d’éviter deux écueils :
- Celui d’une évaluation interne qui « passerait à côté » de l’usager, de ses besoins, de son expression ;
- Celui d’une évaluation qui déifierait l’avis de l’usager équivalant alors à la « satisfaction du client ».
L’usager est « aux côtés » des professionnels, partageant avec lui des intérêts communs, des différences de point de vue, des divergences d’intérêt. C’est bien « aux côtés » les uns des autres que se joue la complémentarité.
Roland JANVIER
[1] Un texte du Groupement National des Directeurs d’Association éclaire cette distinction entre l’évaluation interne et l’évaluation externe dans le cadre des travaux du Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale (à demander à [email protected]).
[2] « Refonder les pratiques démocratiques des établissements sociaux et médico-sociaux, la mise en œuvre des dispositifs techniques, un usage à risque pour garantir le droit des usagers » R. Janvier, Actualité & Perspective, revue du Snasea, n°94, juillet/août 2005.
[3] «Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent» (Article L.312-8 du CASF
[4] Article L. 312-8 du CASF.
[5] Alors qu’en démocratie, c’est l’inverse : l’interdit étant fixé, il délimite l’espace des possibles qui laisse une marge d’autonomie et de créativité aux acteurs, tout ce qui n’est pas interdit étant, par nature autorisé.
[6] Le lecteur attentif remarquera ici le passage de « norme » au singulier quand nous parlons de bonnes pratiques à « normes » au pluriel quand nous nous intéressons au rapport dynamique entre normes et comportements. C’est une illusion autoritariste que de penser qu’il n’y aurait qu’une sorte de norme et qu’un type de comportement.
[7] « Les usagers entre marché et citoyenneté » sous la direction de M. Chauvière et J. Godebout L’Harmattan – 1992 (préface de Michel Sapin)
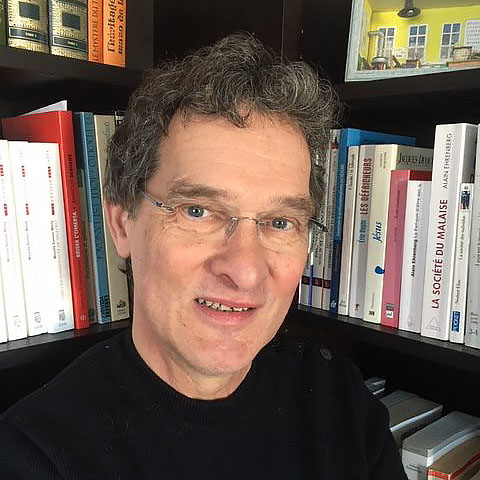
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


