La loi du 2 janvier 2002 introduit un lien entre le droit des usagers et la qualité des prestations. Le premier serait garanti par la seconde… Cette qualité étant « suivie » par un processus continu d’évaluation interne et des rendez-vous réguliers d’évaluation externe.
Le lien « droit – qualité » relèverait de l’évidence… Il mérite donc d’être interrogé :
- Par le concept de qualité, n’assistons-nous pas à une réarticulation des sphères de l’économie et du travail social ?
- Ce remaniement représente-t-il une garantie pour les droits fondamentaux des personnes accueillies dans les établissements et services sociaux ?
- En fait, qu’entend-on par qualité au regard du droit des usagers ?
- En conséquence, quelle pourrait être la place des usagers dans un processus d’évaluation ?
.1. L’articulation de l’économique et du social :
Le terme même de qualité semble s’imposer sans discussion à tous les secteurs de l’activité sociale. Dans le secteur industriel, les qualiticiens existent depuis longtemps. Dans le champ sanitaire, la qualité des soins est une vieille idée. C’est donc dans l’action sociale que ce thème a fait son apparition la plus récente. En cela, il apparaît que la rhétorique de la qualité est le symptôme d’une évolution forte des rapports sociaux qui se décline en tension entre plusieurs pôles : industrialisation et standardisation des modes de production ; banalisation des rapports aux objets (biens et services de consommation) ; recherche de la plus grande sécurité possible pour chaque individu ; étendard publicitaire du principe de satisfaction ; idéalisation, voire euphémisation, des rapports de consommation ; etc.
C’est sans doute en ce sens que d’aucuns prétendent que la notion de qualité des prestations revient à réduire l’intervention à une prestation marchandisable. Si cela était possible, il y a un risque que la qualité soit potentiellement toxique pour les usagers : Le professionnel serait amené à abdiquer devant une nouvelle tyrannie, celle de « l’usager roi ».
Il apparaît que la réalité est un peu plus complexe. Face à un discours « d’économisme triomphant », nous trouvons une simplification et une diabolisation de l’économie. A se laisser piéger par les promoteurs d’une économie teintée de néo-libéralisme, nous laissons s’estomper des dimensions des rapports économiques qu’il serait urgent de réhabiliter. L’état des échanges économiques n’est que le produit de choix politiques explicites ou implicites. Ce n’est pas l’économie qui dicte les relations entre les individus, ce sont les rapports sociaux qui produisent un mode d’échange économique, marqué par des enjeux de domination. Il faudrait réintroduire dans l’économie sa finalité humaine. Par exemple, Jacques Généreux[1] nous démontre que l’économie peut être réhabilitée comme vecteur de la promotion de la dignité humaine. Patrick Viveret[2] nous démontre la fécondité qu’aurait pour nos sociétés développées, la prise en compte des dimensions non-monétaires qui caractérisent toutes relations humaines. Dans ces perspectives, l’action sociale, par définition non-monétaire et fort peu lucrative, gagnerait de nouvelles légitimités, se situant au cœur des échanges sociaux, aux côtés – mais avec ses spécificités – des autres échanges économiques. L’impact des interventions sociales pourrait être valorisé en termes d’effets productifs pour la vie sociale et la capacité de chacun à contribuer activement à la construction collective. La « plus-value » sociale des institutions du travail social serait enfin mise en « valeur ».
En fait, il s’agit, dans une perspective réellement et pleinement « économique », de réinterroger le travail social dans ses fonctions sociales et politiques. Il faudrait ainsi redéployer la question de l’évaluation dans tout l’espace sociétal, c’est-à-dire ne l’enfermer ni dans une logique strictement « économiste », ni dans une réduction utilitariste, voire instrumentale, des missions de l’action sociale.
Nous voyons que sur cette piste, la qualité se réorienterait alors du côté des valeurs et du projet de société.
.2. Quelles garanties l’évaluation apporte-t-elle aux droits fondamentaux ?
La qualité est une fiction, c’est-à-dire un compromis provisoire qu’un groupe social définit pour qualifier un « vivre ensemble » le plus consensuel possible. La qualité est, elle aussi, empreinte de rapports sociaux, de clivages, de dominations. Il ne s’agit nullement d’une conception univoque des choses. Certains professionnels du social seraient surpris de découvrir, s’ils en prenaient le temps et les moyens, les conceptions de la qualité qu’ont les usagers de l’action sociale. Les clivages culturels, les « habitus », se révèlent quand on essaie de creuser cette question.
L’évaluation de cette qualité est, quant à elle, un discours, un construit social. L’évaluation ne dit pas ce qu’est la qualité, elle désigne, renforce et installe, une représentation dominante des rapports humains, des rapports des humains avec leur environnement, des rapports des groupes sociaux entre eux.
C’est là que les droits fondamentaux sortent de l’ombre. En référence aux Droits de l’Homme (autre fiction qui nous vient de nos ancêtres révolutionnaires) ces libertés fondamentales refusent l’enfermement du citoyen dans des rapports de soumission, dans des comportements de conformité. Cet étendard du « droit » ne protége par pour autant du développement d’attitudes consuméristes ou, dans un autre sens, de la recherche d’une maîtrise des comportements d’usage.
La qualité des prestations prônée par la loi de rénovation sociale ne peut donc se réduire au transfert des normes qualitatives du secteur marchand. Les normalisations (type ISO) n’évitent pas les écueils cités ci-dessus, bien au contraire.
Comment donc adapter, dans ce contexte historique, culturel et social, la question de la qualité et de son évaluation au champ de la production de services non-marchands pour des personnes fragiles ?
C’est sans doute du côté d’une « approche processus » qu’il faudrait orienter nos efforts. L’enjeu est alors de développer une forte capacité de différenciation des réponses. Le principe d’individualisation qui se fait jour dans les textes fondateurs de l’intervention sociale, s’il expose à l’écueil de l’individualisme – forme paroxystique du libéralisme –, est l’inverse de la standardisation. Pour les professionnels du social, cette posture renvoie à des savoir-faire éprouvés qui consistent à anticiper sur des situations à risque, à inventer des réponses singulières adaptées à chaque situation. Nous sommes là, par les pratiques concrètes des acteurs, très éloignés d’une normalisation préétablie des protocoles.
Ce qui « fait » qualité, c’est finalement la reconnaissance de la singularité de l’usager.
.3. Qu’est-ce que la qualité au regard du droit des usagers ?
A suivre cette piste de réflexion, nous assisterions donc à un déplacement de la « chose » (la prestation réduite à un objet) vers le « sens » (ce que la prestation signifie dans une relation). Ce qui suppose des référentiels spécifiques de qualité qui ne peuvent se limiter à un paresseux emprunt à des démarches conçues dans d’autres partiques économiques (le champ de la production industrielle), d’autres cultures (les modèles anglo-saxons), d’autres réalités (la transmission d’un objet à consommer).
Cela suppose de prendre une distance résolument critique avec la normalisation des processus. Il n’y a pas de « bonnes pratiques ». Elles n’existent que dans des visées sécuritaires de contrôle et de maîtrise des comportements (autant ceux des professionnels que des usagers). Même si le terme « bonnes pratiques » est imposé par le cadre légal, nous devons être en mesure de les référer au sens des actions, aux valeurs qui sous-tendent la relation d’altérité, aux finalités du travail sur autrui.
Parler de bonnes pratiques renvoie à un idéal unique, une manière d’agir enfermée dans des préceptes rigides. La bientraitance de l’usager est une injonction comportementale qui n’ouvre pas à la qualité de l’intersubjectivité, à sa souplesse innovante, à sa fluidité dynamique et créatrice. Elle limite l’acte à ce qui est autorisé – principe fondamental des régimes autoritaires – alors que le rapport démocratique – fondé sur le principe de l’interdit – ouvre à d’autres possibles parce que les comportements ne sont pas dictés d’avance. En ce sens, il conviendrait plutôt de parler de « meilleures pratiques », c’est-à-dire des pratiques repérées, à un moment donné de l’histoire d’un secteur d’activité, comme celles qui produisent le plus d’effets positifs. Le terme « meilleurs pratiques » ne signifie pas l’excellence mais l’aspect provisoire, discutable et évolutif des comportements professionnels.
La normalisation de l’intervention sociale, si les recommandations de bonnes pratiques s’enfermaient dans l’assignation procédurale et oubliaient de situer les pratiques interdites, entraînerait la normalisation des comportements sociaux. Ce n’est pas cette qualité là qui garantirait les droits des bénéficiaires !
C’est une logique de débat qui peut interroger le rapport à la norme. Celle-ci n’est pas un donné objectif posé une fois pour toute, mais une relation dynamique avec un corpus vivant, et mouvant, de règles et de repères toujours à renégocier collectivement. La mise en œuvre du droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux n’est pas autre chose que la création de ces espaces de débat, associant tous les acteurs, au cœur même des institutions.
.4. Quelle place pour l’usager dans l’évaluation ?
Réarticuler économie et travail social, instaurer une conception interactive de la prestation, refuser une normalisation moralisante des références professionnelles, sont des éléments qui ouvrent un espace à l’usager dans le processus d’évaluation.
La qualité ne peut être confisquée par les professionnels. Les usagers doivent disposer d’un droit d’expression sur cet aspect. Cependant, la disparité qui marque la relation entre intervenants et bénéficiaires est telle que cela suppose des précautions importantes. Il s’agit de permettre aux usagers d’apporter un regard réellement autonome sur la vie et le fonctionnement des établissements et services, sur la qualité des prestations dont ils bénéficient. Cela suppose une construction collective, par les usagers et entre eux, de leurs représentations, de leurs avis, de leurs ressentis. La collectivisation des usagers, par des dispositifs de représentation et de délégation, est la condition d’élaboration de l’autonomie de leur parole collective qui constitue un apport considérable, fondamentalement indispensable, à l’évaluation de l’action sociale.
Nous percevons bien qu’il y a des enjeux de pouvoir autour de la maîtrise des référentiels et des protocoles évaluatifs. Le choix d’une méthode, référée aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles que doit valider le Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale, n’est pas une chose simple. Cela peut devenir encore plus complexe si les usagers sont associés à ces choix. N’est-ce pas là une façon de prendre en compte toute la complexité de la question ?
La redistribution des processus entre tous les acteurs, selon les principes du débat démocratique évitera la dérive vers une simplification du travail social.
La loi 2002-2 dessinait les contours d’un usager participant, co-acteur du projet qui lui est destiné. C’est dans cette logique, qui ouvre de nouvelles perspectives à l’action sociale, que devrait être pensée la place des usagers dans l’évaluation. Peut-on rêver d’un usager évaluateur des dispositifs d’action qu’il aura lui-même, au côté des professionnels, contribué à élaborer ?
Nous l’avons entendu sur tous les tons : l’usager est citoyen. A ce tire, il ne peut se désintéresser de l’évaluation de la qualité du service public dont il bénéficie. Cet « usager-citoyen-évaluateur », à l’instar des professionnels et des gestionnaires des institutions du social, ne limite pas son regard à l’horizon de l’établissement ou du service. Le champ optique de l’évaluation embrasse beaucoup plus large. Partant de la notion ambiguë de l’évaluation de la qualité des prestations, la démarche à laquelle il participe s’élargit vers l’impact des actions sur l’environnement (les territoires, les groupes sociaux), vers la position de l’institution dans les politiques publiques, vers l’adéquation des moyens aux objectifs et aux missions, vers les politiques sociales elles-mêmes, leur définition, leur pertinence, leur efficience, etc.
C’est en ce sens que le Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale tente de jeter les bases d’une doctrine sur ce terrain, encore relativement vierge, de l’évaluation dans le champ de l’action sociale. En attestent les deux premières notes d’orientation qu’il a publiées.
Roland JANVIER
[1] Manifeste pour une économie humaine, Esprit, juillet-août 2001.
[2] Reconsidérer la richesse, Rapport au secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, 2002.
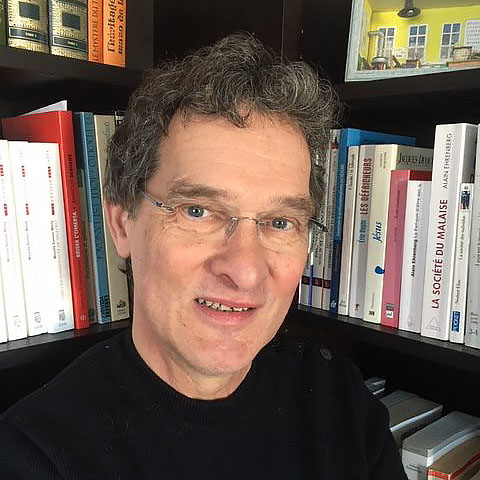
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


