Introduction
Reste-t-il aujourd’hui encore une ambition pour le travail social ? En 1982, Nicole Questiaux publiait sa circulaire « Orientations pour le travail social ». A la relire, elle reste d’une brûlante actualité. 30 ans plus tard, dans le cadre d’un plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté, on nous annonce la préparation d’ « Etats Généraux du Travail Social ». Retour aux sources ? Refondation ? Rattrapage ? Sauvetage ? Ou tentative de ravaudage d’un filet de sécurité pour les plus fragiles qui se trouve maintenant déchiré de toutes parts ?
Parcourir les orientations que fixait la ministre de la Solidarité Nationale, à la fin du siècle dernier, permet de mesurer le chemin parcouru, ou plutôt ce qui n’a pas vraiment changé. Sa volonté était de refonder une nouvelle citoyenneté par l’action sociale, de sécuriser le statut des professionnels par la clarification des missions de l’action sociale et de garantir un pluralisme institutionnel en articulant tous les champs du sanitaire au social et du public au privé.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Les enjeux de participation de tous à la délibération démocratique sont exacerbés par les questions d’exclusion économique décuplées par la crise et celles des migrations résultant des grands déséquilibres planétaires. Dans ce contexte, un procès est instruit à l’encontre du travail social. On lui reproche – comme l’écrivait déjà la ministre en 82 –, « de coûter cher, trop cher, dans une période de crise économique, d’être inefficace techniquement. » La légitimité des professionnels du travail social reste profondément interrogée. Là aussi, on pourrait croire que la circulaire de 82 a été écrite cette année. « En premier lieu, nous devons faire lucidement le constat d’un très grand cloisonnement institutionnel, d’une segmentation des professions sociales et donc de l’hétérogénéité des statuts qui font de la « gestion » de l’action sociale une tâche extrêmement ardue, et rendent difficiles aux travailleurs sociaux les évolutions et adaptations personnelles… » Enfin, le constat à dresser sur les articulations actuelles entre les institutions du travail social montre que les ambitions de 1982 n’ont pas été satisfaites : « La complémentarité doit passer par une meilleure définition de la dimension associative, mais aussi du rôle des pouvoirs publics. (…) Elle ne signifie nullement que l’État démissionne de ses propres responsabilités. » Brûlante actualité avions-nous dit ?
Et pourtant, si les constats sont les mêmes, le fond de tableau a complètement changé. De profondes mutations anthropologiques ont bouleversé les places et les rôles dans la relation d’aide. Des transformations sociétales sans précédent ont révolutionné les fonctions des institutions et notamment, celles du travail social. Nous nous intéresserons, dans le cadre de cet article et en référence à la posture professionnelle de son auteur[1], aux associations qui assument la gestion d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces organisations de l’action sociale sont aujourd’hui mises au défi de réformer de fond en combles leurs modèles de référence tant au plan structurel qu’à celui des actions et donc des postures des acteurs.
.1. Mutations anthropologiques et sociétales
– Le sujet, l’individu, l’identité
L’évolution des droits des personnes est un fait majeur des évolutions récentes[2]. Ce fait impacte tous les secteurs de la vie sociale (santé, consommation, administration…). Cette évolution confère au principe d’égalité républicaine une acception plus complexe dont nous pouvons retenir deux aspects :
– L’égalité se combine avec des principes d’équité qui modifient la mise en œuvre effective de droits généraux en cherchant à s’adapter à la singularité des situations.
– La puissance publique ne tire plus sa légitimité de l’affirmation de normes globales mais de l’effectivité de leur application au plus près de l’individu.
Cette tendance s’interprète parfois comme une explosion de l’individualisme au détriment des grandes solidarités sociétales. La réalité est plus complexe. Les figures identitaires se démultiplient dans des espaces sociaux d’appartenance qui semblent moins consistants et moins prégnants qu’avant mais qui sont aussi plus ouverts, plus variés et plus riches. La garantie de l’autonomie des personnes devient un préalable à tout dispositif d’accompagnement social. Les organisations d’action sociale, et les politiques publiques qui les missionnent, doivent donner chair au principe de solidarité nationale tout en préservant l’individualisation.
La revendication d’une reconnaissance personnelle et sociale des sujets est le terreau où se développent ces nouvelles conceptions des liens sociaux. Chacun doit articuler la revendication de soi et la reconnaissance des autres, via de nouveaux supports de communication et de relation. Cependant, les clivages sociaux perdurent dans des rapports qui peuvent devenir plus violents et plus excluants autour de notions telles que la concurrence, la compétition, la performance. La lutte pour la reconnaissance prend des formes qu’il est parfois difficile de décrypter tant les changements nous incitent à modifier en profondeur nos grilles de lecture et d’interprétation.
C’est dans ce contexte que se trouvent recomposés la plupart des rôles sociaux. La conception des fonctions d’autorité, associée à une remise en cause des grandes institutions, doit rechercher de nouveaux points d’appuis, plus consensuels, plus immanents aux communautés. La famille et le rôle des parents se sont considérablement modifiés sous l’effet des mutations des représentations et d’évolutions législatives essentielles (Cf. la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe de mai 2013).
– L’usager-citoyen
Ces faits, entre autres, ont entraîné une révolution dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux quant à la place des usagers qu’ils accompagnent. Ces derniers sont désormais titulaires de droits garantis par des outils ou des dispositifs de participation[3]. Ils sont associés tant à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé qui les concerne qu’à tous les aspects de la vie et du fonctionnement des établissements et services.
Un élément symptomatique de ces grandes évolutions concerne la révolution copernicienne qu’opère le principe d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Le handicap n’est plus envisagé comme l’incapacité de la personne de s’adapter à la société mais comme la difficulté de cette dernière à intégrer la personne selon un principe général d’égalité de traitement. Ce renversement paradigmatique ouvre au droit à compensation et place l’accessibilité – à entendre ici dans une conception large qui ne se limite pas aux problèmes architecturaux – comme une ambition sociétale déterminante pour notre capacité collective à vivre ensemble, y compris avec nos différences.
De même, la notion de parcours de vie vient occuper le premier plan des dispositifs d’action, charge aux institutions d’en garantir la continuité dans le respect le plus vif des souhaits de la personne, première évaluatrice de ses besoins. Il s’agit d’une décentration de l’organisation qui déplace ses préoccupations de son centre vers les personnes accueillies en portant une attention accrue à leurs demandes.
Nous assistons à la montée en force d’un soupçon généralisé à l’égard des formes instituées. La critique gagne maintenant les organisations d’action sociale. Il ne s’agit pas d’un retour des critiques très politiques de la seconde moitié du vingtième siècle autour des thèmes du contrôle social. Ce soupçon est l’ombre portée d’une attente implicite à l’égard du travail social. Il serait accusé de ne pas être en mesure d’endiguer les phénomènes sociaux d’inadaptation. Le travail social – ses professionnels et ses institutions – est en défaut de performance. Cette critique qui lui est régulièrement adressée tant par l’opinion publique que par les décideurs politiques lui confère un rôle de bouc-émissaire selon une logique qui confond la pathologie (les problèmes sociaux générés par le fonctionnement de la société) et les moyens thérapeutiques (les organisations du travail social). C’est un bon moyen d’éviter une critique à construire sur le fonctionnement social qui génère ces phénomènes d’inadaptation tout en privant les organisations d’action sociale des moyens nécessaires –certes de plus en plus importants – de conduire leurs missions.
.2. Penser de nouvelles organisations pour le travail social
– Refonder l’institution autrement
Ces mutations anthropologiques et sociétales nous invitent à refonder une nouvelle légitimité pour les organisations d’action sociale. Mais, dans ce contexte et face aux critiques qui les agressent, les associations d’action sociale, cherchant des voies nouvelles pour leur avenir, semblent s’enfermer dans une double impasse :
– D’une part, elles sont prises dans un phénomène d’isomorphisme avec les administrations qui tentent de les mettre sous tutelle. L’affaiblissement de la dimension politique de leur projet, de plus en plus instrumentalisé par les actions mises en œuvre, les place dans une dépendance forte aux dispositifs technocratiques qui leur apportent à la fois l’autorisation de conduire leurs actions et les subsides nécessaires. La prédominance de ce modèle administratif conduit les associations à se montrer hyper conformes, jusqu’à reproduire, à l’interne, les raisonnements et la culture des autorités qui les encadrent.
– D’autre part, faute d’un travail d’élaboration sur des formes alternatives d’organisation, les associations tendent à importer des modèles conçus pour l’entreprise marchande de production de biens matériels. Ce copier/coller sans critique ni distanciation a des effets redoutables sur les organisations d’action sociale qui tendent à standardiser des normes là où il y aurait besoin de libérer des initiatives les plus diverses possibles.
Isomorphisme et imitation ne sont pas deux processus contradictoires. Au contraire, ils se combinent entre eux dans un système d’adaptation réciproque des organisations[4]. Prises dans des formes inadaptées à leur mission, les organisations d’action sociale peinent à s’affranchir des modèles dominants. Il est pourtant déterminant pour elles de penser leur organisation sur des bases originales, inédites, innovantes.
– Concevoir des organisations du seuil[5]
L’enjeu est double :
– Les organisations d’action sociale doivent promouvoir leur autonomie. Les défis qu’elles ont à relever au cœur des mutations sociales en cours ne peuvent supporter une situation de dépendance qui aliènerait leurs initiatives à des centres décisionnels externes. C’est leur autonomie qui est la condition de leur réactivité aux besoins, de leur capacité d’adaptation aux demandes, de l’innovation nécessaire pour maintenir les principes de solidarité.
– Les organisations d’action sociale doivent également, et selon le même mouvement d’émancipation, se décentrer d’elles-mêmes. L’impératif d’enraciner leurs actions au cœur du social, au plus près des habitants, immergées dans les territoires, ne peut s’adapter à une conception autocentrée de l’organisation. C’est leur capacité d’interaction avec leur environnement qui est la condition de leur pouvoir d’agir, là où émergent les besoins sociaux, en proximité des phénomènes à traiter.
Finalement, il y a urgence à conceptualiser une alternative organisationnelle pour les institutions d’action sociale. Elles ne peuvent se résoudre à être les clones des administrations ou les pâles copies des entreprises industrielles. Pour se distinguer du tropisme centralisateur du modèle technocratique et de la tendance à l’accumulation égocentrique de l’entreprise marchande, l’organisation d’action sociale doit s’inscrire dans une dynamique de flux qui repose sur sa capacité à se décentrer d’elle-même et à intensifier la quantité et la qualité de ses interactions.
Ce sont des organisations du seuil qu’il faut promouvoir. C’est-à-dire des systèmes d’échanges qui travaillent leurs interdépendances avec les acteurs territoriaux qui les entourent. Cela suppose d’agir sur les délimitations institutionnelles. Une organisation du seuil dispose de frontières souples et poreuses qui facilitent les interactions. Sa survie et son développement ne dépend pas de la claire délimitation de son terrain d’action (chasse gardée), ou de ses prérogatives (expertise exclusive), mais de la quantité et de la qualité de ses liens externes. L’organisation du seuil assume le fait que son centre de gravité n’est pas situé en son sein mais en dehors d’elle : c’est de l’intérêt du territoire et des habitants qui y vivent, qu’elle tire sa raison d’être et sa légitimité. Cette conception de l’organisation où ce n’est pas son centre mais ses seuils qui font sens, place les forces instituées au second plan. Ce qui domine, c’est la puissance instituante des énergies qui la traversent. Ces énergies sont constituées de la vie ordinaire des habitants avec leurs souffrances et leurs réussites, leurs échecs et leurs joies. Ces énergies sont également faites des partenariats qui sont noués entre organisations pour créer des complémentarités assurant la continuité des parcours de vie des personnes accompagnées et surtout, évitant l’enfermement et l’isolement institutionnel des usagers. Ces énergies sont aussi caractérisées par les liens de l’organisation d’action sociale avec les acteurs de la vie sociale, tous les acteurs, évitant la réification sociale des usagers.
– Réencastrer le travail social dans la société
C’est en effet par leur insertion pleine et entière dans leur environnement que les structures du travail social deviennent des organisations du seuil. Immergées, elles se fondent dans le paysage jusqu’à en devenir un élément ordinaire. Ce faisant, elles réencastrent le travail social dans la société et replacent leurs bénéficiaires au cœur des interactions sociales. La socialisation des organisations du travail social conditionne la socialisation de leurs usagers. C’est, par exemple, ce que produisent les foyers de protection de l’enfance organisés en petites unités de vie disséminées dans les quartiers et occupant des maisons ordinaires. Ceux qui ont connu les grands internats logés dans des châteaux mesurent le chemin parcouru vers l’intégration sociale de ces structures.
La notion d’organisation du seuil semble bien adaptée à l’ambition intégrative que porte le travail social, travail du social, travail sur, et dans, la société, travail de transformation sociale. Cette orientation intègre et modifie l’injonction à la désinstitutionnalisation. La critique adressée aux institutions porte sur les effets marginalisants et stigmatisants que produisent les établissements et services sociaux et médico-sociaux. L’objectif est le recours aux formes ordinaires de socialisation : l’école, la formation, le travail, le logement, toutes ces structures doivent être « normales », sans exception. Ceux qui défendent la désinstitutionnalisation considèrent les institutions spécialisées comme des lieux d’exception, marginalisés et marginalisants, produisant de l’exclusion. Il s’agit là d’organisations autocentrées telles que nous les avons critiquées. L’organisation du seuil, si elle est authentiquement fondée sur la dynamique des flux et des échanges, en travail sur la porosité de ses limites pour favoriser les interactions et parfaitement immergée dans son territoire, n’est aucunement stigmatisante. Elle devient, au-delà de ses missions spécifiques, un élément banal du milieu où elle vit et agit, parmi les habitants. Par exemple, la reconnaissance des entreprises d’insertion comme des lieux de production ordinaires, pleinement intégrés dans le tissu économique, participe de cette banalisation de parcours professionnels divers et ouverts.
Le mouvement décrit est bien un mouvement de désinstitutionnalisation qui permet de réinstituer autrement des formes d’accompagnement plus adaptées aux défis de ce temps. En fait il s’agit plus d’une dynamique de déségrégation qui porte à la fois sur les structures et sur les personnes qu’elles accompagnent.
– Construire des organisations banalisées, référées au droit commun tant pour les usagers que pour les professionnels
C’est par ce mouvement de remise en cause des modèles organisationnels et de conceptualisation de formes alternatives – qui ne soient ni isomorphisme de l’administration, ni imitation de l’industrie marchande – que nous parviendrons à transformer nos établissements et services sociaux et médico-sociaux en lieux banalisés, fondés sur le droit commun.
Cette transformation des cadres de référence est vitale pour les personnes accueillies. Mais elle revêt également une importance de premier plan pour les professionnels.
Les travailleurs sociaux s’épuisent, dans une société de plus en plus excluante, à tenir la position d’intermédiaire entre les publics relégués aux lisières du vivre ensemble et le fonctionnement commun de la société. Ils s’épuisent dans cette posture qui n’est plus une simple tension mais un grand écart qui les déchire et réduit à néant tous leurs efforts. Penser le travail social au sein de systèmes qui permettent des passages fluides entre des mondes vécus différents ouvre de nouvelles perspectives. L’organisation du seuil ne délimite plus des lieux sociaux qui deviennent des lieux de marquage social, elle représente des points de passage, des espaces de mobilité qui rendent labiles les identités et les appartenances. Pour illustrer ce propos, le travailleur handicapé n’est pas identifié par son appartenance à un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) mais par sa capacité de production dans une unité, certes adaptée mais banalisée, qui concoure à la vie économique du territoire.
Les travailleurs sociaux vivent péniblement une crise d’identité pour eux-mêmes ou portée par le regard des autres et de la société. Qui sont-ils à œuvrer ainsi auprès de personnes en difficulté ? Le flou de leur place et de leur mission tient à la manière dont la société regarde les phénomènes de mise à l’écart que génère son système socio-économique. Plus les structures du travail social seront banalisées comme des activités sociales ordinaires s’adressant à tous les membres du corps social, plus les travailleurs sociaux seront à l’abri de ce malaise identitaire.
Les organisations du seuil devraient ainsi devenir des lieux où l’action sociale redeviendrait possible par cette nouvelle alliance qu’elles autorisent entre usagers et professionnels réunis par ce point commun de la citoyenneté. Travailleurs sociaux et bénéficiaires sont avant tout des citoyens développant, les uns et les autres, chacun avec la spécificité de sa position, leur capacité d’agir sur le monde. C’est sous cet angle que le travail social relèvera les défis qui se présentent à lui, que les établissements et services sociaux et médico-sociaux seront des lieux d’insertion sociale, que les associations d’action sociale seront des laboratoires du vivre ensemble.
[1] Roland JANVIER est directeur général de la Fondation Massé Trévidy (Finistère), Docteur en Sciences de l’information et de la communication, il intervient dans des formations supérieures de cadres de l’action sociale et a publié des ouvrages relatifs à l’action sociale. Il est actuellement co-président du Groupement National des directeurs Généraux d’Associations du secteur éducatif, social et médico-social (GNDA).
[2] Cf. R. Janvier et Y. matho, Comprendre la participation des usagers en institution sociale et médico-sociale, Dunod, 2011.
[3] Cf. R. Janvier et Y. Matho, Aide-mémoire : le droit des usagers, Dunod, 2013.
[4] Le mouvement de copie des modèles marchands impacte également les administrations publiques, par la généralisation du new public management.
[5] Cf. R. Janvier, « Penser des institutions du seuil », in R. Janvier, J. lavoué, M. Jézéquel, Transformer l’action sociale avec les associations, Desclée De Brower, collection Solidarité et Société, 2013.
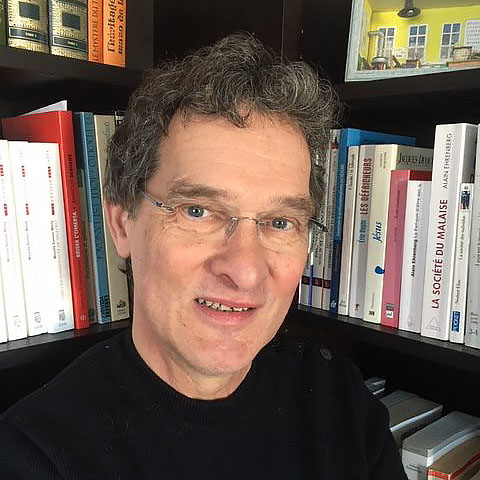
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


