Conflits à tous les étages !
La vie des établissements et services sociaux et médico-sociaux n’est pas un long fleuve tranquille ! Leur vie est marquée par de fréquentes tensions : tensions liées aux problématiques des personnes accueillies ou accompagnées ; tensions d’un dialogue social souvent délicat, parfois difficile ; tensions des rapports avec les partenaires du champ professionnel ; tensions au sein et entre les équipes de terrain.
De même, la vie des organismes gestionnaires d’actions sociales n’est pas exempte de conflits : tensions avec les autorités de contrôle et de tarification dans un contexte de plus fort contrôle et de maîtrise des dépenses ; tensions au sein même de l’organisation autour du projet et des stratégies dans un contexte de refonte des logiques d’action et des légitimités ; tensions entre les organismes gestionnaires qui se manifestent autant entre associations et organismes publics qu’entre les associations elles-mêmes dans des logiques de plus en plus concurrentielles.
Bref, ce n’est pas une sinécure de vivre, de travailler ou de diriger au sein d’un établissement ou un service social ou médico-social. Ce billet voudrait démontrer que la conflictualité non seulement est inscrite dans le code génétique de ces organisations mais qu’en plus elle constitue une opportunité pour leur développement.
Trois conflits institutionnellement structurants
Les institutions d’action sociale se constituent – c’est-à-dire ont leur essence – sur trois conflits structurants :
Le premier niveau de tension est tout entier contenu dans la mission dévolue aux organisations sociales et médico-sociales : c’est le conflit entre les normes sociétales et les conduites particulières des personnes. Ces dernières relèvent d’une intervention sociale ou médico-sociale, d’un accompagnement ou d’une prise en charge parce qu’elles se trouvent en porte-à-faux par rapport aux comportements attendus de la société, du fait d’un handicap, d’une inadaptation ou d’une dépendance. C’est parce qu’il existe un écart entre normes et comportements que les institutions d’action sociale son légitimées à intervenir. Il s’agit là d’une sorte de scène primitive, d’un conflit qui fonde l’institution, d’un conflit où prennent leur source toutes les pratiques professionnelles, toute la clinique institutionnelle.
Le second niveau de tension se situe entre le projet de l’organisme gestionnaire et les pratiques professionnelles. La conversion d’une intention d’action (venir en aide, accompagner, soutenir…) en actes concrets (assister, secourir, étayer, écouter…) est une opération de traduction complexe. Cela met en rapport la dimension politique (finalités) et la dimension technique (objectifs opérationnels). Ce rapport, par essence conflictuel, est particulièrement visible dans les associations par la relation complexe qui s’établit entre les adhérents/administrateurs et les salariés et par la relation emblématique du Président avec le directeur d’association. Technique et politique entretiennent tour à tour des relations dialectiques, répulsives ou fusionnelles, toujours difficiles à réguler.
Le troisième niveau de tension oppose les cadres hiérarchiques, parfois étroitement associés aux administrateurs, aux acteurs de terrain. D’un côté, les manageurs se laissent trop souvent séduire par les sirènes du « new management », pétris d’intentions rationalisantes et performatrices. De l’autre, les salariés traversent une douloureuse crise identitaire alimentée par les injonctions paradoxales qui percutent les cultures sur lesquelles ils ont construit leur projet professionnel. Cette situation provoque des effets compliqués dans les rapports hiérarchiques des organisations, chacun reprochant tout à l’autre…
Comment faire avec la conflictualité ?
Ce qui rend problématique l’existence de ces conflits, c’est leur non appropriation par les acteurs qui les vivent sur le mode d’un âge d’or perdu. Les acteurs du social se vivent comme chassés d’un Eden où tout était harmonie au nom de tout le bien qui était souhaité aux personnes fragiles qui sont la cible de toutes ces énergies.
Plutôt que d’assumer ces conflits comme étant puissamment structurants de la légitimité institutionnelle, ils sont vécus sur le mode de la perte : perte d’énergie, perte d’identité, perte de substance…
· Là où il faudrait réhabiliter le conflit entre normes et conduites comme constitutif de la finalité éminemment politique de toute intervention sociale, les acteurs s’enferment dans un débat sans fin sur la conformité ou la non-conformité des actions.
· Là où il faudrait réincorporer les dimensions technique et politique l’une dans l’autre comme moteur dialectique de l’action, les acteurs s’enferment dans des négociations visant à délimiter des territoires, des prérogatives, des espaces réservés (dont les usagers sont constamment les exclus !).
· Là où il faudrait reconnaître les divergences d’intérêts, notamment entre la hiérarchie et le terrain, comme un rapport social naturel et productif (de plus de sûreté, de plus d’autonomie, de conceptions plus négociées et partagées…) les protagonistes s’opposent dans une lutte stérile empruntée au modèle de l’entreprise productrice de biens de l’économie marchande en lieu et place d’un dialogue social centré sur le projet à développer.
Pour transformer ces impasses en voies fécondes pour l’avenir, il nous faudrait apprendre à mieux construire les désaccords et nos compromis au profit d’une culture du provisoire et de la fluidité.
Construire les désaccords
Contrairement à une idée reçue, les désaccords ne sont pas bloquants pour les institutions. A certaines conditions, ils peuvent être moteurs de la construction institutionnelle. Cela suppose que les désaccords ne soient pas vus comme des oppositions stériles mais comme la défense de positions qui, toutes, contribuent à assurer la bonne marche de l’organisation. L’opposition d’une équipe à une modification n’est pas à lire uniquement sous l’angle d’une résistance au changement. C’est aussi l’affirmation de l’attachement de l’équipe à des valeurs, à des postures, à des convictions qui fondent leurs pratiques professionnelles et qui méritent d’être entendues. Certes, cette position défensive peut être un frein à l’évolution nécessaire de l’institution. Il faudra parfois passer outre pour ne pas empêcher la réussite du projet. Mais toujours, et c’est là un principe fondamental de bonne gestion de la conflictualité, la décision doit être prise après avoir pris le temps de comprendre tous les arguments avancés. Comprendre n’est pas cautionner. Comprendre, c’est à la fois faire œuvre de compréhension et vouloir intégrer dans le périmètre des enjeux la position de l’autre. Comprendre n’impose de décider comme l’autre le demande. Comprendre suppose de décider en tenant compte de la demande de l’autre, en l’intégrant dans les paramètres déterminants la décision, positivement comme négativement.
La construction des désaccords permet d’aller au bout des argumentations de part et d’autres, selon un principe absolu de respect, d’écoute et de volonté de comprendre, pour être sûr d’avoir tout intégré dans l’analyse, pour identifier le noyau du désaccord, la part irréductible qui différencie les intérêts en présence, les positions défendues. Le désaccord, ainsi enrichi et éclairé par cet effort collectif d’intelligence partagée, devient fécond pour l’organisation, il produit du sens, de la clarification, de la lisibilité.
Négocier des compromis
Cette culture de la conflictualité dont il est question dans ce billet suppose, une fois les désaccords identifiés et compris, de déboucher sur des compromis. Le compromis est l’accord maximal qui résulte de la négociation. A l’inverse, le consensus est l’accord minimal que les uns ont imposé aux autres selon un rapport du fort au faible. Le compromis ne se comprend qu’à la suite de la construction des désaccords, c’est en connaissance de cause qu’on négocie. Le consensus n’est qu’un « malentendu partagé » qui repose sur le flou et l’approximation.
Le compromis n’est pas un abandon. Les positions, et les désaccords qui en résultent, sont repérés et tenus. Le compromis est une concession faite en toute responsabilité de part et d’autre. Il se situe au point de croisement des chemins que les uns et les autres ont fait pour permettre la rencontre, pour éviter de bloquer le système. Le compromis n’est pas une défaite mais une conquête de l’intelligence dans la différence reconnue et assumée.
Pour une dynamique du provisoire
Tout compromis est, par nature – du fait même des conditions quasi-permanentes de négociation et de mise en conflictualité des différences – un élément provisoire et instable. Il est un point d’étape, un accord posé à un moment donné de la vie institutionnelle, dans un contexte précis, selon un état repéré des rapports de forces.
Assumer cette dimension du compromis suppose d’accepter d’inscrire la trajectoire institutionnelle dans une dynamique du provisoire. C’est une inversion de culture qui se profile : alors que de tout temps l’institution était pensée à partir de sa substance, de ce qui la constitue en dur, le présent projet invite à la penser à partir de son mouvement, de l’éphémère de ses pérégrinations et de ses hésitations. Aujourd’hui, la durabilité de l’institution ne dépend plus de la consistance de ses fondations mais de sa capacité à évoluer, à changer. Là où, avant, le provisoire était incertitude et fragilité, il devient, maintenant, condition de vie et de développement.
Pour une sécurité dans la fluidité
Mais cette dynamique du provisoire ne peut être, pour autant, source d’insécurité pour l’organisation et ses acteurs. La capacité à s’adapter à tout, de manière souple, pourrait conduire à des « institutions-mollusques » où plus rien de solide ne ferait référence. Pour empêcher cela, la culture de la conflictualité doit s’appuyer sur des repères tangibles, qui font sens. Mais là où ces fondamentaux relevaient de la Tradition héritée et d’une certaine fixité des rôles et des places, il convient de repenser de nouveaux points d’appui dans un contexte où l’héritage ne fait plus le poids et où les rôles sont tous redistribués autrement ou, pour les plus anciens, invalidés. Ce n’est plus sur la Tradition et la hiérarchie que se construisent les institutions du 21ème siècle, c’est sur la qualité de leur projet et leur adaptabilité à l’environnement. C’est, paradoxalement, le fluide qui devient le « dur » de l’institution, sa colonne vertébrale, son programme institutionnel. Mais la capacité d’adaptation ne liquéfiera pas l’organisation si celle-ci est bien appuyée sur un projet qui fait sens, qui finalise, qui légitime le mouvement. Nous pourrions comparer cette fluidité au mouvement de la marche (on ne remet jamais deux fois le pied au même endroit) et l’institution au randonneur (inscrit dans un mouvement constant). C’est le projet qui fait boussole. Sans projet, le marcheur avance mais n’importe où dans un environnement qui n’a pas de sens, il est perdu. Avec le projet, le randonneur sait où il va et pourquoi. Comme le marcheur, il bouge et s’adapte à l’environnement, mais à la différence de celui-ci, il a un dessein, un objectif, un but à atteindre.
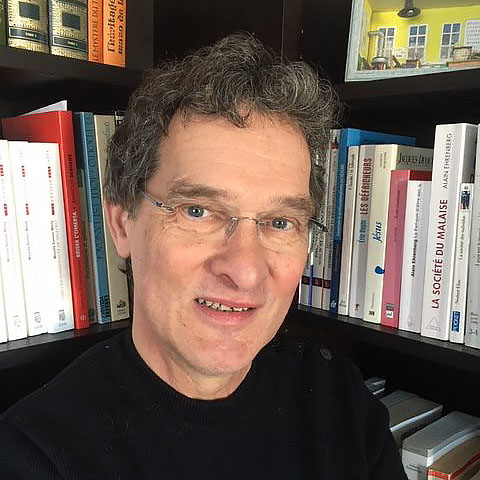
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.



