Introduction : un contexte problématique
Coincées entre le mimétisme avec le modèle de l’entreprise marchande et l’isomorphisme avec la technobureaucratie qui les encadre, les associations de l’action sociale sont interrogées quant à leur légitimité.
La question est posée : faut-il changer de modèle ? Existe-t-il une forme d’organisation plus adéquate ? Au risque d’y perdre les valeurs capitalisées par l’histoire associative ?
Réinventer un modèle associatif de solidarité suppose de prendre position entre leur instrumentalisation par la puissance publique et leur dilution dans la seule dimension militante.
À l’instar de Gabrielle Halpern (Le Pommier, 2020), ne devons-nous pas penser les associations de solidarité comme des centaures ? Ni cheval, ni homme, toujours un peu des deux, c’est entre actrices des politiques publiques et puissances politiques contribuant à la construction sociale que les associations doivent inventer de nouvelles modalités de dirigeance et de gouvernance.
- Entre mimétisme et isomorphisme
Le mimétisme, c’est le « Comportement de celui qui reproduit plus ou moins inconsciemment les attitudes, le langage, les idées du milieu ambiant ou d’un autre individu auquel il veut ressembler. » Par extension nous dit le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, ce terme englobe « tout phénomène de ressemblance plus ou moins volontaire, de communion, d’identification avec un modèle. »
L’isomorphisme institutionnel est une théorie proposée par Di Maggio et Powell dans les années 80/90. Il s’agit de la convergence de comportement entre les structures associatives, privées et publiques. Le terme isomorphisme est emprunté aux mathématiques[1] et à la chimie[2].
- La prédominance du modèle de l’entreprise marchande
Faute d’être parvenues à bâtir et à faire vivre un modèle alternatif d’entrepreneuriat, les associations de solidarité se sont rabattues sur les modèles d’entreprise préexistants.
Certes, les associations de solidarité (principaux employeurs du secteur associatif et même de l’ensemble du champ de l’Économie Sociale et Solidaire) sont des entreprises. En ce sens, elles ont des fonctionnements similaires à n’importe quelle organisation de travail : gestion des ressources humaines, processus de production de l’activité, règles de fonctionnement, organisation hiérarchique, etc.
Cependant, ces entreprises sont singulières, du simple fait que c’est l’ambition d’une société solidaire qui justifie leur raison d’être. À la différence des autres formes d’entreprise, leur centre de gravité est extérieur à elles, il se situe dans l’action qu’elles mènent au bénéfice des personnes qui évoluent dans leur environnement. À la différence des autres formes d’entreprise, la richesse qu’elles produisent ne les concerne pas ou plutôt ne leur est pas destinée, ni distribuée en dividendes entre ses membres. Leur activité produit de la plus-value sociale pour les bénéficiaires de leurs actions. De plus, et c’est une différence notable avec l’entreprise marchande classique, cette plus-value n’est pas monétarisée, elle est d’ailleurs difficile à chiffrer en termes financiers.
Mais ces spécificités notoires de « l’entreprise associative » n’ont pas donné naissance à une forme originale d’entrepreneuriat. Elles n’ont pas empêché de rabattre le modèle organisationnel sur les formes classiques et préexistantes qui s’offraient dans le paysage. L’économisme ambiant a ainsi contribué à calquer l’organisation interne de l’association de solidarité sur l’entreprise classique.
C’est ce mimétisme qui pose aujourd’hui problème car il entretien le manque de reconnaissance du secteur associatif des solidarités.
- L’hégémonie de l’administration publique
À ce phénomène mimétique s’ajoute un autre syndrome lié cette fois aux relations des associations de solidarité avec les autorités publiques qui régissent les politiques sociales. Après des phases de création plus ou moins contrôlées dans la créativité des « trente glorieuses », l’État est progressivement intervenu dans le financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cet engagement budgétaire des pouvoirs publics a été assorti, logiquement, de moyens de planification de l’offre, de régulation des coûts, d’évaluation et de contrôle des activités. Progressivement, l’État s’est immiscé de plus en plus précisément dans le fonctionnement des associations de solidarité gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L’autorité de contrôle qui délivre les autorisations, à travers une inflation législative et réglementaire de plus en plus exponentielle, a contraint les associations jusque dans leurs choix organisationnels internes.
Les associations de solidarité, selon le principe qu’on ne mord pas la main qui vous nourrit, se sont conformées aux injonctions des pouvoirs publics. Elles ont calqué leur structuration sur celles des politiques sectorielles et catégorielles qui organisent l’intervention sociale. Graduellement, les organisations associatives se sont uniformisées, leurs comportements se sont homogénéisés avec l’organisation administrative des autorités qui les contrôlent. Administrations qui se dénomment d’ailleurs significativement comme des « autorités de tutelle », battant en brèche le principe d’autonomie associative issue de la loi de 1901.
C’est cet isomorphisme qui pose aujourd’hui problème car il laisse penser que l’association de solidarité n’est qu’un instrument des politiques sociales.
- Changer de modèle au profit de l’organisation lucrative ?
Ce sont ces glissements mimétiques et isomorphiques qui ont érodé la force initiale du fait associatif : des citoyens qui s’associent pour porter ensemble un projet, défendre une cause, agir pour le bien commun voire se mobiliser sur un problème précis. Subrepticement, cette érosion de la dimension citoyenne des associations a ouvert la question de leur pertinence. Ne vaudrait-il pas mieux changer de modèle car l’association serait devenue obsolète ?
L’hégémonie de l’idéologie néo-libérale contribue à cette remise en cause. La conversion de l’État au « Nouveau Management Public » (NMP) signe ce mouvement de fond qui consiste à réduire le rôle de l’État. Le NMP manifeste la soumission de l’action publique aux règles du marché. C’est l’effet des réformes engagées au début de ce siècle (Loi Organique des Lois de Finance de 2001) qui généraliseront, jusqu’au secteur social et médico-social, les principes de mise en concurrence (loi Hôpital Patients Santé et Territoires de 2009) et, surtout, l’ouverture d’actions sociales au secteur lucratif (par exemple la loi Borloo de 2005). La performance des associations de solidarité s’évalue sur des critères financiers. De là à penser que l’entreprise lucrative serait plus à même de répondre à ces nouvelles logiques, il n’y a qu’un pas que de nombreuses administrations ont franchi.
Le procès adressé au modèle associatif est donc à resituer dans des enjeux de marchandisation des échanges sociaux. Il ne s’agit pas uniquement d’une réflexion sur l’organisation optimale pour répondre aux besoins sociaux mais de la volonté, portée par l’Europe, de placer le maximum de services d’intérêt général (SIG ou SIEG[3]) dans le jeu concurrentiel. Logiques de marché que l’idéologie néo-libérale pare de toutes les vertus, dont celle d’être plus équitable entre les « offreurs de service » et source de réduction des coûts…
La faillite des organisations lucratives (Cf. le scandale Orpea, la banqueroute de médicharme, les difficultés financières du groupe Clariane (ex-Korian)…) n’atténue pas la volonté de poursuivre la marchandisation de pans entiers de l’intervention sociale. À cela, il convient d’ajouter le transfert au marché lucratif de la plupart des activités annexes des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui, auparavant, faisaient partie de leur activité (restauration, blanchisserie, communication, gestion des salaires, sécurité, traitement numérique des données, etc.).
- Entre instrumentalisation et marchandisation, quid de l’association ?
Donc, il semble naturel aujourd’hui d’interroger la pertinence du modèle associatif pour gérer les interventions sociales. Celles-ci se trouvent dans une forte tension entre deux risques : celui de n’être qu’un mode de gestion de la chose publique, d’application d’une politique, dans ce cas quel intérêt à reposer sur un contrat entre citoyens ; celui de voir en conséquence leur dimension d’engagement reporté sur quelques manifestations militantes marginales.
- L’association, un instrument pratique pour les pouvoirs publics
L’histoire, mainte fois rabâchée dans les rhétoriques défensives du secteur associatif, nous enseigne que ce sont les associations qui ont été à l’initiative de la plupart des actions sociales qui existent aujourd’hui. Issues des organisations de solidarité portées à l’époque par des congrégations religieuses, des notables locaux, l’éducation populaire, etc. elles sont encore aujourd’hui la forme juridique majoritaire pour la gestion d’établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cependant, nous l’avons dit, la manière dont les financements publics ont imposé une mise en conformité de leurs fonctionnements a instrumentalisé les associations. Le slogan « qui paye décide » a largement servi la volonté des collectivités publiques d’asservir les acteurs de leurs politiques sociales, reproduisant pour le secteur associatif les fonctions tutélaires qu’elles exercent ordinairement sur les structures publiques.
De plus, cette conformation des associations à la volonté des décideurs publics s’est précisée et renforcée au cours du temps. La loi de 1975 était un premier pas dans la mise en ordre du secteur. La loi de 2002 est allée beaucoup plus loin. Les injonctions normatives se sont révélées d’une redoutable précision, justifiant l’immixtion des pouvoirs publics dans les moindres détail : choix présidant à l’organigramme des salariés, modèles de reddition comptable, format des projets associatifs et d’établissement[4], organisation architecturale des locaux, etc.
Quelles marges de manœuvre et d’initiative reste-t-il aux associations dans ce contexte ?
- L’association militante, hors champ des radars des politiques sociales
Ce formatage des associations mal dénommées « gestionnaires » induit un effet de mise à distance du contrat social qui a prévalu à leur création et à leur extension dans le champ des solidarités. Ce contrat associatif manifesté par les statuts et le règlement intérieur n’est pas qu’un outil d’ordre ou d’organisation. Il contient, normalement, un objet qui fixe l’orientation du projet. Cet objet, parce qu’il touche à des questions sociales – et plus précisément à la question de la place des personnes vulnérables dans la vie de la cité –, est de nature intrinsèquement politique. Dans ce phénomène d’instrumentalisation des associations, c’est cette dimension politique de leur raison d’être qui s’estompe, voire dans certains cas qui disparaît.
Le risque est alors de dresser une ligne de partage entre les associations gestionnaires et les associations militantes, entre celles qui gèrent et celles qui revendiquent. Les premières sont des dispositifs techniques de mise en œuvre des politiques sociales qu’elles sont simplement chargées d’exécuter. Les secondes sont l’espace d’engagement des citoyens qui entendent participer aux délibérations sur le projet de société. Certaines organisations (ADAPEI du Finistère et plus récemment celle du Doubs) font le choix de dissocier militance et gestion. Il y a un risque à dissocier ces deux dimensions de l’engagement citoyen. L’intuition des premières fondations associatives était précisément de ne pas en rester à une fonction tribunitienne mais aussi de mettre en actes ce qu’elles préconisent. Le risque est donc de voir la dimension militante portée par certaines associations devenir une fonction marginale de l’action sociale, de n’être que les « mouches du coche » d’un attelage qui n’a pas besoin d’elles pour mettre en œuvre ses orientations.
- Des « associations-centaures » ?
Le pari proposé dans ces lignes, c’est de persister à situer les associations dans ce champ de tension entre militance et opérationnalité, de tenir les deux bouts en même temps. Finalement de défendre l’idée que les associations sont des centaures : « Le centaure n’est pas « ou un cheval ou un homme », il est une tierce réalité…[5] ». Gabrielle Halpern plaide pour des stratégies d’hybridation dans ce monde clivé : « Là où il y avait segmentation, silos, distinction, identité, c’est-à-dire mille murs, il peut y avoir désormais combinaison, mutualisation, coordination, coopération, hybridation, c’est-à-dire un pont.[6] »
- La dimension technique au service d’un projet politique
Privées de leur opérationnalité, les associations de solidarité dégradent la pertinence de leur finalité sociale. C’est leur capacité à construire, mettre en œuvre et piloter des dispositifs techniques d’intervention sociale qui fonde leur légitimité parce que les enjeux sociétaux ne peuvent se limiter à se payer de mots. En référence à Victor Hugo qui disait : « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface », nous pouvons affirmer « Les activités des associations de solidarité, c’est la finalité politique qui se donne à voir. » Sans cette dimension technique, le projet politique des associations, porté dans leur projet associatif, est une coquille vide. L’enjeu est donc de replacer ce projet associatif au premier plan de l’organisation.
- La dimension tribunitienne au service d’un projet opérationnel
Mais pour autant, le projet opérationnel ne peut exister indépendamment du projet politique. Il est formaté par lui, il en dépend totalement. Sinon, il vide le sens de l’action sociale. Car la substance de l’intervention sociale, ce n’est pas d’apporter des solutions aux problèmes qui se posent, c’est de les résoudre en mettant cette action en perspective d’un projet de société.
C’est donc parce que les associations de solidarité contribuent à l’édification d’une société de justice, d’égalité, de droits et de libertés, par des actions concrètes, qu’elles sont crédibles quand elles prennent la parole dans l’espace public. Cette fonction tribunitienne n’est pas « la cerise sur le gâteau » qui apporterait un supplément d’âme, elle conditionne la manière dont se construisent les politiques sociales en France.
- Quid des modalités de gouvernance et de dirigeance ?
Si nous partageons cette idée d’associations-centaures, à la fois actrices des politiques publiques et contributrices à leur définition, nous devons, en conséquence, envisager les implications de ce choix quant à la manière d’associer leurs membres, la manière de piloter le projet et la manière de manager leurs professionnels.
- L’enjeu démocratique concerne toutes les parties prenantes…
L’orientation d’une association qui intervient à la fois dans le débat public et dans des activités de terrain suppose de revisiter la notion de parties prenantes. Qui sont les membres de l’association concernés par ces différents niveaux d’action ?
Nous avons l’habitude de répondre à cette question en nommant les bénévoles qui portent la gouvernance de l’association (adhérents, administrateurs, membres du bureau, président.e) et les salariés qu’elle emploie. Déjà, l’articulation de ces deux catégories d’acteurs mérite débat. Trop souvent, un partage des rôles consigne les bénévoles au choix des orientations politiques et les salariés à la traduction technique de ces choix. Une association-centaure ne peut se satisfaire de cette délimitation qui clive et sépare ces deux faces de la pièce qui fondent le contrat associatif. C’est donc un rapport dialectique qu’il faut entretenir entre les dimensions politiques et techniques, ils sont constitutifs l’un de l’autre, intrinsèquement liés, consubstantiels.
Mais à cela, il faut ajouter les grands absents du schéma associatif : les personnes visées par le projet. Comment peut-on s’acharner à défendre la légitimité du modèle associatif pour gérer les solidarités dans les territoires et maintenir à la porte du débat démocratique qu’il développe les personnes directement concernées par le projet ? C’est comme si un club de football pour enfants interdisait aux parents d’assister aux matchs ou comme si les parents d’enfants scolarisés n’aient pas accès aux résultats scolaires de leur progéniture !
- …ce qui suppose d’inventer d’autres formes de management
À ce stade de notre réflexion, nous percevons que ces transformations des références fondatrices de la légitimité des associations à promouvoir des actions solidaires impliquent une modification de l’organisation.
Les associations-centaures n’ont rien à faire des mimétismes qui tentent de les faire ressembler à des entreprises de production classiques ni des isomorphismes qui tentent de les faire disparaître en les fondant dans le paysage technobureaucratique de l’intervention sociale. Il est urgent que les associations-centaures imaginent des formes organisationnelles adéquates à leur ambition et à cette double identité qui les caractérisent. Cela signifie qu’elles doivent être à la fois des organisations efficientes, efficaces, proactives, pertinentes et ajustées aux cadres techniques de leur activité, mais aussi qu’elles doivent être de véritables espaces de délibération démocratique, suscitant des débats permanents sur les enjeux de leurs pratiques, sur les finalités de leur action.
Cela suppose, et nous finirons sur ce point nodal de la nouvelle organisation à imaginer, d’inventer de nouvelles modalités de management. Inutile d’aller copier/coller les modèles importés d’entreprises qui cherchent à moderniser leur image tout en perpétuant des formes autoritaires de direction. Le « lean management », le « management participatif », le « management horizontal », même « l’entreprise libérée » ne constituent pas des modèles « prêt-à-porter ». Ce qui compte c’est de créer les conditions d’une participation active de toutes les parties prenantes à la vie et au destin de l’entreprise. Le manageur n’est plus celui qui indique la direction à suivre mais celui qui ouvre les espaces de débat pour définir les chemins à prendre, les voies à inventer pour atteindre les objectifs du projet et, ce faisant, modifier le projet lui-même par un aller-retour permanent entre toutes les parties prenantes. Diriger une association-centaure, c’est définir la scène où vont se jouer toutes les compétences en présence, celles des citoyens engagés dans la vie de la cité ; celles des professionnels apportant leur technicité ; celles des personnes concernées qui font valoir leurs savoirs expérientiels.
Conclusion
Vous l’avez compris, il faut réinventer le modèle associatif pour refonder la légitimité des associations à intervenir comme acteurs privilégiés des solidarités. Il s’agit d’affirmer un modèle en prouvant, par les faits, sa pertinence.
C’est par la preuve que les associations de solidarité reconquerront leur légitimité :
- Non pas en se défendant face aux atteintes que lui portent les pouvoirs publics mais en étant l’espace d’une nouvelle alliance entre citoyens, professionnels et usagers.
- Non pas en affirmant leur expertise technique (qui doit être irréprochable) mais en l’associant étroitement à leur fonction tribunitienne.
- Non pas en se laissant réduire soit à une fonction d’exécution, soit à une fonction militante mais en développant cette idée d’association-centaure.
[1] « Relation existant entre deux ensembles isomorphes. » (CNRTL).
[2] « Fait, pour deux corps chimiques ou deux minéraux, de présenter une structure cristalline semblable » (CNRTL).
[3] Services d’intérêt générale et services économiques d’intérêt général.
[4] Article L. 311-8 du CFAS issu du décret 2024-166 du 29 février 2024.
[5] Halpern G. (2020), Tous centaures, éloge de l’hybridation, Paris, Le Pommier, p.24..
[6] Ibid., p.152.
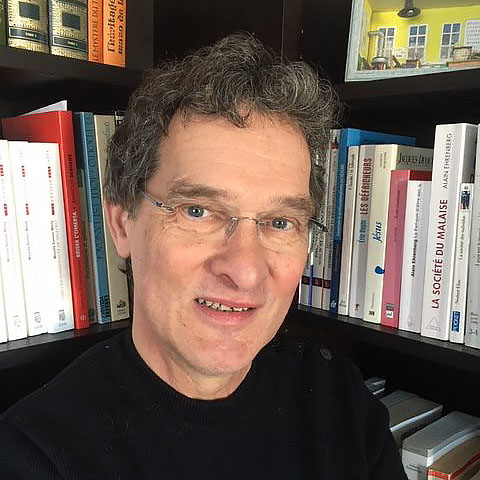
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


