Problématique :
La montée en puissance du droit des usagers pourrait enfermer l’action sociale dans des procédures contentieuses et/ou des comportements consuméristes. Une condition pour que ces droits nouveaux contribuent à l’enrichissement de la vie démocratique des institutions du social ne serait-elle pas que les usagers se structurent dans des organisations autonomes, espaces tiers qui garantissent la capacité des citoyens à délibérer du bien commun ?
Préambule : Quelques précisions sur l’axe de mon intervention :
- Ce n’est pas sous l’impact de la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale qu’émergent de nouvelles postures des usagers. La loi ne fait qu’introduire dans ce champ d’activité des mutations qui concernent l’ensemble de notre société. Je propose donc, dans un premier temps d’évoquer ces mutations sociétales.
- Les « nouveaux droits des usagers » ne contribuent pas uniquement à enrichir la vie démocratique des institutions du social. Il faudrait plutôt dire que ces droits, qui concernent les personnes les plus désaffiliées, participent à enrichir la vie démocratique de notre société. Dans ce domaine, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont une responsabilité éminente.
- La solution est donnée par la problématique avant d’avoir vraiment pris le temps de poser les questions. Mon but est donc d’exposer en quoi l’auto-organisation des usagers me paraît aujourd’hui une réponse pertinente aux défis de ce temps et non une solution miracle sortie de mon chapeau.
Introduction
Il me semble que le champ de l’action sociale et médico-sociale ne prend pas la mesure des mutations qui s’opèrent autour de lui. Où plutôt qu’il traverse ses mutations en considérant qu’il n’est pas directement concerné dans ses fonctionnements internes, dans ses représentations, dans ses modes d’organisation.
Or, les révolutions qui s’opèrent aujourd’hui heurtent de plein fouet les institutions du social. Je limiterais mon propos à un seul aspect : L’usager est devenu, comme chacun de nous, un individu « hyper moderne » (ou « postmoderne » selon les références).
Je voudrais ici démontrer qu’il est peut-être trop rapide et trop simple de parler d’une simple dérive vers l’usager consommateur. Les mouvances qui agitent les postures des usagers sont plus multiformes qu’une simple généralisation de la logique marchande. En intégrant mieux la complexité des phénomènes qui traversent l’action sociale, nous serons peut-être plus aptes à développer des stratégies mieux adaptées.
Nous vivons dans une société « liquide »
Hyper moderne ? L’individu du XXIème siècle est entraîné dans le tourbillon de la mondialisation, du déclin des institutions[1], du triomphe de l’économie libérale, de l’individualisme, de l’insécurité sociale[2] (pour ne reprendre que quelques thèmes développés par des auteurs récents). L’individu est amené à agir seul, à décider seul, à se construire seul dans un univers de plus en plus incertain. L’heure est au « dépassement de soi » mais aussi à la « fatigue d’être soi[3] ».
Avec Zygmunt Bauman, nous pouvons parler de « modernité liquide » : « Contrairement aux corps solides, les liquides ne peuvent pas conserver leur forme lorsqu’ils sont pressés ou poussés par une force extérieure, aussi minime soit-elle. Les liens entre leurs particules sont trop faibles pour résister … Et ceci est précisément le trait le plus frappant du type de cohabitation humaine caractéristique de la “modernité liquide”[4] »
Nous faisons collectivement l’expérience d’une société dont les liens n’ont jamais été aussi lâches. Contrairement à ceux qui parlent de délitement du lien social – ce qui signifierait un monde sans la rencontre de l’autre, où chacun serait « out » – je préfère parler de changement de nature du lien social. Façon d’affirmer que le lien social existe – car il est impossible d’être en dehors du lien social, être « hors » de la société, c’est une façon de s’y situer, donc d’être malgré tout « dedans » – mais aussi façon de dire que ce lien change de nature, de « solide », il devient « fluide », c’est à dire souple, mouvant, informe, imprédictible. Nous n’assistons pas à une disparition du lien social mais à une diffusion des liens sociaux qui deviennent multiples et changeants : les appartenances identitaires sont diverses et de plus en plus isolées les unes des autres. Il n’y a plus d’identité unique et contraignante (le village-tribu, la lignée familiale, la classe sociale …). Ce que l’individu hypermoderne y gagne en autonomie, il le perd en sécurité.
Les usagers que nous rencontrons dans l’action sociale font eux aussi l’expérience de cette liquéfaction des rapports sociaux. Ils en font même l’expérience douloureuse car, pardonnez-moi l’image facile, dans une société liquide, il vaut mieux savoir nager ! Et, précisément, les personnes fragiles, handicapées, exclues, en souffrance qu’accompagnent les professionnels du social ne savent pas nager. C’est dire que l’évolution de nos rapports sociaux peut être encore plus ségrégative et excluante qu’avant. La distinction ne se fait plus sur des appartenances de classe identifiées une fois pour toutes mais sur des clivages culturels, territoriaux, de participation à la société de l’information, d’accès aux privilèges ou même aux droits.
La modernité liquide a une autre série d’incidences : les institutions se recomposent et perdent de leur solidité. Elles n’ont plus, aux yeux de l’opinion, de légitimité préétablie (Cf. les effets de l’affaire d’Outreau). Leur légitimité doit se prouver, se démontrer, au travers de l’efficacité de leurs actes. Les institutions de l’action sociale n’échappent pas à la règle : leurs usagers attendent qu’elles fassent leurs preuves !
Finalement, l’usager aurait bien du mal à ne pas douter de la solidité des établissements et services qui s’adressent à lui dans ce contexte « liquide » où les points d’appuis semblent se dérober. Là encore, il faut redire que les repères ne sont pas en train de fondre comme neige au soleil (ce qui seraient une image inadaptée pour parler de modernité liquide) mais qu’ils deviennent moins rigides, plus élastiques.
Nous vivons à l’heure du virtuel
Avec un autre auteur, nous pouvons prolonger cette approche de l’hypermodernité : Pierre Lévy nous parle d’une « virtualisation » qui affecte les modalités du vivre ensemble[5].
L’actualité nous donne l’occasion de comprendre ce qu’est ce mouvement de notre monde vers le virtuel. Les débats sur les téléchargements de musiques par internet sont au cœur de la question. Avant, une musique, c’était un objet : un disque en vinyle pour les plus anciens, un « CD » aujourd’hui. On « possédait » tel ou tel enregistrement de ses chanteurs ou de ses musiques préférés, on l’achetait, on le prêtait ou on le donnait. Aujourd’hui, la musique devient un élément virtuel contenu dans le disque dur d’un ordinateur ou la mémoire d’un baladeur. Par la numérisation, la musique s’est virtualisée – ce qui ne signifie pas qu’elle n’existe pas, nous l’entendons « réellement » – le contenu a pris le pas sur le contenant. La musique « passe » sur le net, on la saisit au vol, sans en avoir de trace très visible, sans qu’elle se matérialise par un objet rangé sur des étagères.
De la même façon que la musique :
- Les corps se virtualisent sous l’effet des biotechnologies, sous l’effet des systèmes de télécommunication (projection des corps par ordinateurs interposés – Cf. Skype) …
- Le texte se virtualise dans le système de l’hypertexte : toutes les parties d’un document sont atteignables sans respect obligé de l’ordre d’écriture, des liens se construisent entre les parties en dehors de toute contrainte de support matériel.
- L’économie se virtualise.
Je voudrais insister sur ce dernier point pour montrer que nous sommes passés d’une économie de la rareté à une économie virtuelle. L’économie de la rareté, c’est l’économie matérielle, celle des biens physiques que l’on possède, c’est une économie des stocks. L’économie virtuelle, c’est une économie où l’information est prépondérante – ce qui « vaut » le plus n’est pas ce que « j’ai » mais ce que je « sais » – c’est une économie des flux. Pour illustrer cela, il suffit d’évoquer les mouvements de capitaux qui font et défont les fortunes beaucoup plus que la propriété des appareils de production industrielle, ou encore la « net-économie ». Le passage d’une logique de stock à une logique de flux est précisément ce qui agite actuellement le monde artistique à propos des téléchargements de musiques.
Cette mutation d’une économie des stocks à une économie des flux est déterminante. Mais nous continuons à raisonner en stock alors que nous traitons des flux.
Cela me semble parfaitement vrai en ce qui concerne l’action sociale. Avant, les professionnels de l’intervention sociale disposaient du capital du savoir : maîtrise des dispositifs, connaissance des remèdes, contrôle des solutions … Leur légitimité venait des informations qu’ils possédaient et que n’avaient pas les usagers. Aujourd’hui, l’usager dispose de moyens d’information qui le placent, parfois, à égalité de savoir avec l’intervenant. La légitimité du professionnel ne provient plus centralement du « stock » de ses savoirs mais de sa capacité à faire circuler l’information : capacité à construire un plan d’action avec l’usager, capacité à l’accompagner dans les dispositifs, capacité à s’adapter à la singularité de ses demandes … La nouvelle légitimité des professionnels du social repose sur leur aptitude à gérer les flux d’informations qui entourent la relation d’aide. On est passé d’une légitimité par le contenant (les « stocks », l’institution) à une légitimité par le contenu (les flux, l’action).
Dans ce processus de virtualisation, nous venons de voir combien les usagers ont changé de posture, mais aussi les professionnels, et peut être surtout combien les institutions doivent refonder leurs légitimités.
Or, dans un univers de flux, les acteurs du social continuent à raisonner en termes de stocks.
Que devient l’usager dans cette modernité liquide et dans ce contexte virtuel ?
Nous l’avons vu, d’un côté il paye cher les nouvelles formes de modernité de notre société, et d’un autre côté, il est en attente d’un « service », c’est-à-dire d’un bien virtuel. Cela impose d’agir dans deux directions : D’une part sur le collectif, d’autre part sur la notion de service.
Sur le plan du collectif :
Les institutions sociales sont les mieux placées pour comprendre qu’il n’est pas possible de renvoyer les usagers à trouver seuls des solutions à un problème social. Sygmunt Bauman le dit mieux que moi en s’appuyant sur Pierre Bourdieu et Cornélius Castoriadis : « S’il y a une chance de résoudre des problèmes engendrés socialement, la solution ne peut être que collective.[6] » Ce n’est pas d’un retour à des institutions solides et autoritaires dont ont besoin les usagers aujourd’hui – car dans cette tentation, l’illusion totalitaire n’est jamais très loin – c’est d’institutions qui les aident à « socialiser » leurs difficultés, à mettre en circulation ce qui fait problème et qui ne peut se résoudre en s’enkystant dans une problématique personnelle, à rechercher collectivement les moyens de prendre en main leur destin. Pour ce faire, il vaut mieux vivre dans une société aux contours et aux formes organisationnelles plus souples et mieux à même de s’adapter aux attentes de tous les citoyens.
Sur la notion de service :
Les débats autour de la directive « Bolkenstein » sur les Services d’Intérêt Général (SIG) en Europe donnent une actualité forte à cette question. Serions-nous menacés par une « marchandisation » du social ? Sur ce point, ma position a évolué.
D’abord, nous pouvons lire l’intérêt soudain du secteur marchand pour l’action sociale comme une véritable reconnaissance dans un contexte d’économie de marché. Le « social » deviendrait enfin une activité sociale comme une autre et, enfin, on prendrait en compte son intérêt économique. Cessons de diaboliser la logique marchande alors qu’elle a, depuis bien longtemps, infiltré nos manières de faire et de voir.
Ensuite, et ce second volet répond à ce qui précède, il revient aux institutions sociales de défendre la spécificité qui caractérise le travail social. C’est le sens de la demande des associations de repérer dans les SIG les Services Sociaux d’Intérêt Général (SSIG). Cela permet d’affirmer qu’il n’est pas de même nature de distribuer de l’électricité que d’accompagner une personne dans son insertion sociale.
Pour revenir sur la notion de flux, nous pouvons dire que défendre la spécificité de l’action sociale, dans le cadre d’une politique générale des services, c’est défendre la particularité des flux que gèrent les institutions du social :
- Faciliter la mobilité des personnes dans une société en mouvement, c’est-à-dire refuser de laisser certains au bord du chemin ;
- Garantir le partage des informations, c’est-à-dire refuser la fracture numérique en train de se constituer qui exclue certains des réseaux de communication ;
- Contribuer à la croissance de l’intelligence collective, c’est-à-dire refuser la confiscation du savoir par une classe dominante ;
- Assouplir le rapport entre les normes et les conduites, c’est-à-dire refuser d’enfermer des populations dans la stigmatisation au nom d’une norme unique de comportements « autorisés » ;
- Etc.
Délibérer du bien commun
Pour atteindre des objectifs aussi ambitieux, il nous faut refonder les institutions de l’action sociale : rebâtir leur raison d’être dans un contexte de modernité, sur la base d’une gestion des échanges. Autrement dit, quitter les murs des établissements et liquider les stocks !
Pour atteindre des objectifs aussi ambitieux, il nous faut accepter de voir les usagers prendre leur autonomie. Cela passe, entre autre, par la constitution d’organisations autonomes d’usagers.
En effet, si les usagers ne peuvent peser collectivement sur les organisations du social, ils seront condamnés à errer en solitaires dans l’hypermodernité. La seule solution pour exister étant alors de revendiquer une position de consommateur envers les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Si les usagers ne peuvent peser collectivement sur les organisations du social, ils seront condamnés à être des utilisateurs mous d’institutions liquéfiées. La seule solution pour exister étant alors de chercher à distendre jusqu’à la rupture les liens institutionnels contenants, à nier toute légitimité aux structures de l’action sociale.
Des usagers organisés sont au contraire en mesure de collectiviser leurs représentations et de contribuer à structurer conflictuellement les rapports institutionnels.
Collectiviser les représentations pour dépasser l’intérêt individuel, conflictualiser les relations sociales, ce sont là deux fondements d’une société démocratique. Il dépend de nous de promouvoir la capacité des usagers de l’action sociale à tenir toute leur place citoyenne.
Roland Janvier[7]
Le 24 janvier 2006
(article publié in Aporia (Grames, RNCE), n°5, novembre 2006)
[1] Le déclin de l’institution, François Dubet, Seuil 2002.
[2] L’insécurité sociale, Robert Castel, Seuil, 2003.
[3] La fatigue d’être soi, dépression et société, Alain Ehrenberg, Odile Jacob, 1998.
[4] Zygmunt Bauman, Liquid modernity, Polity Press, 2000, L’amour liquide, Le Rouergue/Chambon, 2004, Vivre dans la “modernité liquide”, entretien avec Z. Bauman, Sciences Humaines n°165, novembre 2005.
[5] Qu’est-ce que le virtuel ?, Pierre Lévy, La Découverte, 1998.
[6] Op. Cit.
[7] Directeur Général de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et Vilaine, Co-auteur avec Yves Matho de Mettre en œuvre le droit des usagers dans les organisation sociales et médico-sociale, 3ème édition, Dunod, 2004.
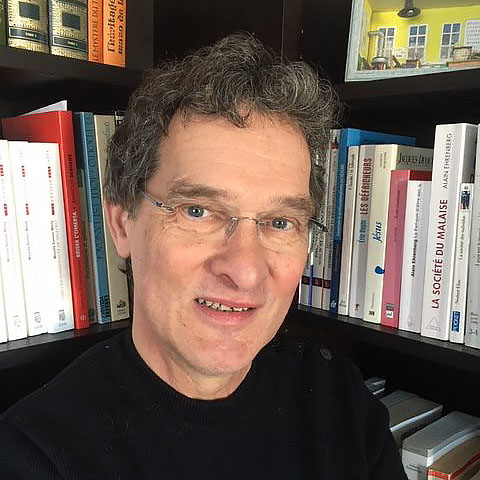
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.


