La loi du 2 janvier 2002 « Rénovant l’action sociale et médico-sociale », aboutissement d’une longue réflexion sur la réforme de la loi du 30 juin 1975 qui organisait il y a trente ans les institutions sociales et médico-sociales, porte les germes d’une véritable révolution pour les professionnels, les établissements et les services[1].
Ce n’est pas une évolution des pratiques qui est en jeu, c’est un véritable changement de paradigme qui se déroule sous nos yeux :
¨ Mutation des places et des rôles de tous les acteurs, professionnels et usagers ;
¨ Posture inédite des destinataires de l’action sociale qui deviennent co-créateur de la prestation ;
¨ Changement de statut de l’intervention autour de nouveaux concepts tels que celui de « prestation » qui se généralise ;
¨ Refondation de la légitimité de l’intervention sociale autour de la conviction qu’il faut d’abord répondre aux besoins des personnes et non assurer la pérennité de la structure ;
¨ Nécessité d’un retour sur les valeurs fondamentales, éthiques et déontologiques, de l’action sociale et médico-sociale pour éviter de voir ce champ d’activité se fondre dans une logique de marché associée à des comportements consuméristes des usagers.
Bref, à partir de cette réforme qui marque à la fois la fin d’une époque et le début d’une ère nouvelle, plus rien ne devrait être comme avant – si les équipes de terrain se saisissent des enjeux qui se présentent aujourd’hui.
La fin d’une époque, le début d’une ère nouvelle :
¨ Cela en est fini des logiques institutionnelles lourdes (l’archétype étant la figure de l’internat), s’ouvre l’ère de réponses souples, facilement adaptables et évolutives ;
¨ Nous quittons un système centré sur les dispositifs d’intervention (tel qu’il était pensé en 1975) au bénéfice d’une centration sur l’action réalisée ;
¨ La définition étroite et réductrice de l’établissement s’ouvre par la loi à la notion de service, élargissant les conceptions et les modalités de prise en charge ou d’accompagnement ;
¨ Le temps de l’autojustification est terminé, l’évaluation continue des pratiques par des processus internes (démarche qualité) et externes permettra de mesurer les écarts entre les intentions et les actes.
Le symptôme le plus visible de cette mutation m’apparaît dans les dispositions de la loi relatives au droit des usagers. Le législateur prévoit en effet que les usagers, parents et/ou enfants, doivent être étroitement associés à la vie et au fonctionnement des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, qu’ils doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’évaluation des projets individualisés. Pour ce faire, des outils sont imposés : projet d’établissement ou de service, conseil de la vie sociale, règlement de fonctionnement, livret d’accueil, contrat de séjour.
C’est sur ce dernier outil que va porter mon propos puisqu’il m’est demandé d’intervenir sur « La question du contrat dans l’accompagnement familial et social. » Je souhaite développer cette question autour de deux points :
¨ .1. La pratique du contrat modifie les postures entre professionnels et usagers :
Le contrat n’est pas un outil anodin, il bouleverse les places et les rôles dans l’institution et dans les façons de procéder.
¨ .2. La pratique du contrat modifie le rapport au droit dans l’institution :
Le droit n’est plus un facteur externe mais un élément constitutif des pratiques de l’établissement ou du service.
.1. LA PRATIQUE DU CONTRAT MODIFIE LES POSTURES ENTRE PROFESSIONNELS ET USAGERS
Légation, délégation, contrat :
Ces trois mots expriment à mes yeux trois modèles relationnels de l’accompagnement social, du plus ancien au plus actuel. Essayons de voir ce qui se passe quand des parents « confient » leur enfant à une structure éducative spécialisée, quand des spécialistes interviennent dans le jeu relationnel familial, quand des professionnels accompagnent une famille.
Dans « légation », il y a quelque chose qui relève de la démission : tout est remis dans les mains du professionnel, tel un legs, la responsabilité, le savoir-faire, la définition des objectifs de travail. Dans cette forme de relation, le parent n’existe pas, l’enfant est un « bien » qui est transmis – donné – pour que d’autres en prennent soin. Il ne s’agit pas d’une relation mais d’une transmission.
Ce modèle de relation repose sur l’image très ancienne mais encore agissante dans nos représentations éducatives de l’orphelinat. Il y avait déjà bien longtemps que les maisons d’enfants à caractère social n’accueillaient plus d’enfants sans parents que l’on parlait encore d’orphelinat, façon d’exprimer que les parents étaient définitivement rayés de la carte (même s’ils recevaient régulièrement leurs enfants chez eux !). Le principe qui prévaut, c’est la substitution : les parents ne savent pas y faire, on les remplace par des personnes qui feront « mieux » : des éducateurs ou des nourrices.
Le principe de légation ignore la triangulation qui s’instaure quant un professionnel intervient dans une famille entre celui-ci, l’enfant et ses parents. On ramène la relation à la dualité éducateur-enfant. Dans ce cas, l’enfant est objet de soin, et non sujet, les parents sont stigmatisés, et non acteurs.
La délégation, c’est l’envoi en mission. Déléguer c’est « envoyer quelqu’un au nom d’un groupe, de quelqu’un d’autre, dans un but déterminé, avec une mission définie. »(Larousse) Par rapport à la notion de légation, la délégation introduit une référence sociale plus large, l’intervenant est légitimé, au-delà de la disqualification des parents, par une mission d’utilité sociale. Les conditions d’éducation des enfants sont soumises au regard public, au nom de valeurs, d’un projet collectif. La délégation implique un peu plus de réciprocité. Dans la configuration de la relation éducative, le déléguant peut être à la fois la société (notion d’intérêt général et d’utilité sociale de l’action sociale) et les parents eux-mêmes (voir toutes les formes d’aide éducative demandée).
En référence aux attributs de l’autorité parentale, la délégation laisse une marge de manœuvre, un espace de jeu entre les intervenants socio-éducatifs et les parents. C’est l’idée de l’article 375 du Code Civil relatif aux mesures de placement judiciaire qui rappelle que les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale sauf pour ce qui serait contraire à l’exercice de la mesure. La délégation suppose de rendre compte : le délégué informe le déléguant de l’exercice de sa mission. Le principe qui prévaut, c’est la suppléance.
Ce modèle de relation dans l’accompagnement éducatif repose sur des conceptions encore actuelles, par exemple dans le système scolaire. Les parents délèguent à des enseignants le soin d’instruire leur enfant. Ceux-ci rendent compte des progrès de l’enfant, notamment à travers la notation de ses performances. Pour autant, les parents sont maintenus à la périphérie du dispositif qui est centré sur l’élève. Dans l’action sociale, l’expression « travailler avec les parents » illustre bien ce modèle relationnel : les parents sont « à côté » du spécialiste (et non « aux côtés »). C’est ce pas de côté qu’il leur est demandé de faire (ils n’interviennent pas directement) qui légitime la place du professionnel. Ce dernier ne fait plus « sans » les parents (modèle de la légation) mais il ne fait pas encore tout à fait « avec » eux (modèle du contrat).
Le contrat introduit une toute autre façon d’envisager la relation. Le contrat est un modèle relationnel basé sur la reconnaissance, a priori, de l’autonomie des compétences de chacun des acteurs. Le contrat c’est « une convention, un accord de volontés ayant pour but d’engendrer une obligation d’une ou plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres. » (Larousse) Par le contrat, chaque partie engagée peut, à tout moment, vérifier la tenue des engagements de chacun, les évaluer, les renégocier pour les faire évoluer en fonction des effets obtenus. Chacun peut régulièrement réévaluer le degré de son engagement dans le projet commun.
Utiliser le contrat dans les pratiques d’accompagnement familial et social est une façon de positionner chacun en acteur d’un projet commun. Ce projet devant être élaboré conjointement, négocié entre tous, évalué avec chacun et régulièrement.
C’est bien ce qu’impose le nouveau contexte législatif : « Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. » (Article L.311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles – CASF)
Le contrat prévu par la loi n’est pas « un truc en plus », il est au cœur même des pratiques éducatives, d’insertion ou d’accompagnement. Dans toutes ces dispositions, le contrat n’impose pas de faire des choses en plus mais de poursuivre l’action – c’est-à-dire de faire ce que nous faisons déjà – en utilisant ce nouveau support relationnel. Par exemple, le processus d’admission, s’il est utilisé à mettre au point (à négocier) le contrat de séjour entre l’accueillant et l’accueilli, ne va pas perdre en pertinence, c’est simplement la construction de ce contrat qui sera le support du plan d’action.
Nous le voyons, le contrat, vu ici sous son angle clinique, introduit un nouveau modèle dans la relation socio-éducative.
Du consensus à la conflictualité :
En se centrant sur le concept de prestation[2] la mutation de l’action sociale et médico-sociale risque de nous exposer à la dérive marchande : l’usager se transforme en client comme il en fut pour les utilisateurs de la SNCF. Ce que nous nommons la dérive libérale risque de réduire l’intervention sociale à une simple prestation de service marchandisable auprès des plus solvables des usagers (les autres n’auront qu’à se débrouiller avec une aide sociale publique au rabais).
Cette perspective se construit sur la toile de fond de la satisfaction de l’usager : la qualité de la prestation s’évaluera au degré de satisfaction des bénéficiaires. Plus ils seront contents plus cela signifiera que les professionnels ont bien travaillé.
Il me semble que cette illusion d’un consensus toujours possible entre intervenants et utilisateurs est en contradiction avec d’autres dispositions contenues dans la loi de janvier 2002 :
¨ Le règlement de fonctionnement qui, s’il garantit les droit des personnes, fixe également un cadre contraignant, donc frustrant ;
¨ Le recours par l’usager à une personne qualifiée pour l’aider à faire valoir ses droits prévoit donc explicitement des moyens pour gérer les prévisibles conflits ;
¨ Le conseil de la vie sociale qui met en présence (et en scène) les groupes d’intérêts, potentiellement divergents, dans l’institution : l’employeur, les salariés, les parents, les usagers.
A cette optique consensuelle, donc fusionnelle, du travail, nous préférons opposer une culture de la conflictualité[3]. C’est par la dialectique des enjeux entre acteurs – entre la demande de l’usager et l’offre du professionnel – que se réalise la qualité de l’intervention.
Le contrat, dans cette perspective devient un espace de gestion de l’inévitable tension entre la demande de l’usager (ses besoins exprimés par lui) et l’indication posée par l’équipe professionnelle (les besoins de l’usager envisagés en dehors de lui). Le contrat est une véritable instance de débat – espace de conflictualité – qui met en discussion entre les acteurs les tenants et les aboutissants du projet.
.2. LA PRATIQUE DU CONTRAT MODIFIE LE RAPPORT AU DROIT DANS L’INSTITUTION
Le contrat de séjour est opposable en droit :
La contractualisation prévue par la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale ne relève pas du « gadget pédagogique » mais de l’irruption d’un contrat, opposable en droit, dans les pratiques institutionnelles. Un doute subsiste uniquement sur le statut de ce contrat (contrat de droit public ou de droit privé) et donc sur l’ampleur de ses conséquences juridiques.
Le contrat dont il s’agit n’est pas un contrat d’adhésion (modèle du contrat de vente) mais un contrat à exécution successive. Son objet ne peut être réalisé en une seule fois (comme c’est le cas dans une transaction commerciale) mais progressivement dans le déroulement de la prise en charge (au fur et à mesure que des objectifs de travail son atteints).
Il y a quatre conditions nécessaires à la validité juridique d’un contrat : le consentement des parties, la capacité à contracter, l’existence d’un objet certain et une cause licite.
Le consentement des parties :
Ce point est délicat dans le champ de l’action sociale. Par exemple, pour un Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale, que vaut le consentement d’une personne à qui l’on propose un hébergement et de la nourriture en échange de son engagement à suivre un programme de réinsertion ? Sa survie contre sa soumission ? Un contrat entre un éléphant et une souris laisse penser que le premier s’est taillé la part du lion (clauses léonines). Pour être valable, un contrat doit être synallagmatique (symétrique).
Comment créer les conditions d’un véritable consentement quand il y a d’un côté un contractant qui a tout (le pouvoir, la légitimité, les moyens matériels, la domination culturelle, etc.) et de l’autre un contractant qui a besoin de tout (qui n’a rien) ?
Cette volonté de mise à parité des cocontractants suppose une véritable réflexion dans les équipes pour développer des stratégies qui permettent de passer d’un rapport de domination à une relation égalitaire ou au moins équivalente.
La capacité à contracter :
Il s’agit ici de capacité civile à contracter. Cela exclut les usagers mineurs qui doivent être représentés par le titulaire de l’autorité parentale ou représentant légal, les usagers majeurs protégés qui seront représentés par leur tuteur. Cela n’interdit pas de réfléchir à une procédure de signature qui ouvre un espace – symbolique et non juridique – à la place de l’usager : par exemple, la contre signature de l’usager civilement incapable manifestant qu’il a bien été associé à l’élaboration du projet.
La capacité à contracter doit aussi s’évaluer dans l’extrême disparité des positions qui caractérise le rapport entre l’intervenant et l’usager ou son représentant légal. Notre attention au respect de la personne doit être d’autant plus grande que celle-ci est en situation de fragilité. La notion de capacité à contracter nous alerte sur le fait qu’un contrat ne peut jamais être extorqué (sinon, il y a dol).
L’existence d’un objet certain :
Pour que le contrat ne soit pas un marché de dupe (« donne moi ta montre je te donnerais l’heure en échange ») il faut que l’objet du contrat soit clairement défini. L’objet du contrat, c’est le projet d’action lui-même, tel qu’il a pu se négocier entre les acteurs. On peut penser que l’objet du contrat recouvre, au moins en partie, la surface occupée par le projet individualisé de prise en charge ou d’accompagnement.
L’objet du contrat de séjour est constitué des engagements réciproques de l’établissement et de l’usager. Il s’agit d’un engagement sur des moyens à prendre de part et d’autre, non d’engagement formel sur des résultats : le travail social comprend trop d’éléments aléatoires, de variables non-maîtrisables, pour pouvoir honnêtement s’engager sur l’issue de l’action.
Une cause licite :
Le contrat s’inscrit dans un cadre général de droit qui n’autorise pas de dérogation à la loi ou aux lois. Cela peut paraître évident de le dire, ce n’est pas toujours si simple. Par exemple quand un contrat stipule que des sanctions financières sont possibles ou pire, des privations de liberté, le contrat est illicite.
Dans un remarquable article[4], Jean-Marc Lhuillier fait le point sur les conséquences de l’apparition du contrat dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Tout d’abord, il nous alerte sur le danger à voir les pratiques contractuelles mettre en cause le droit fondamental de tout usager à obtenir réparation d’un préjudice subit lors de la prise en charge. D’autre part, il craint que « cette formalisation des droits, au lieu de rapprocher les professionnels, les conduisent plus souvent devant les tribunaux pour trancher les conflits. »
Le contrat, fondé sur la liberté contractuelle, délimite ce que les juristes appellent la responsabilité contractuelle. Il s’agit là d’une individualisation de la prise en charge qui définit pour un usager précis les modalités spécifiques de sa prise en charge. Le contrat ne peut cependant pas exclure des dispositions d’ordre général, liées à la nature même de l’activité de l’établissement ou du service. Les clauses limitatives de responsabilité peuvent avoir une validité juridique en matière contractuelle, elles sont nulles en matière délictuelle. Le contrat ne peut dédouaner ni le professionnel, ni l’institution de leurs responsabilités. « De ce fait, la liberté des acteurs devrait plus jouer sur la détermination de zones de responsabilité, plus que de clauses limitatives de responsabilités [5]» Par exemple, se mettre d’accord sur le moment ou la responsabilité de la famille prend le relais de l’établissement pour le trajet de retour d’un enfant (l’arrêt de bus ou la montée dans le taxi).
Jean-Marc Lhuillier nous fait judicieusement remarquer que la responsabilité contractuelle – qui sera naturellement recherchée par le juge s’il y a un contrat signé en bonne et due forme entre le représentant de l’établissement et le responsable légal de l’usager – risque d’être moins favorable à l’usager que la responsabilité délictuelle, notamment en matière d’indemnisation des victimes.
Du « bénéficiaire » au participant :
Au-delà de ces considérations juridiques qui ne sont pas mineures, il me semble que ce qu’il faut retenir des évolutions en cours, c’est que, entre autre par le truchement du contrat, l’usager, simple bénéficiaire d’une prestation, change radicalement de position. Il n’est plus situé en bout de chaîne dans la production du service, il en devient un acteur à part entière, sans lequel rien ne peut être fait. C’est l’esprit du 7ème alinéa de l’article 311-3 du CASF qui fixe les fondements du droit des usagers : « La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. »
L’usager devient « participant » :
¨ Participant signifie qu’il prend part à l’action pour en tirer profit : Nous quittons une logique strictement descendante, qui porte les stigmates d’un rapport de pouvoir au bénéfice de l’intervenant, pour une logique plus transversale qui engage bilatéralement la responsabilité de chacun des acteurs.
¨ Prenant part à l’action, l’usager en assume une partie : L’intervention n’est plus du seul ressort des spécialistes, elle croise de façon complexe le savoir-faire des professionnels et la compétence de l’usager. La qualité de l’action repose sur la qualité de l’articulation des acteurs entre eux, non plus sur la seule technicité de l’acte.
¨ Ayant apporté sa contribution personnelle, l’usager n’en ressort pas de dette, il est dans le contre-don ; En effet, un des aspects les plus inégalitaires de l’action sociale traditionnelle réside dans le fait qu’à l’issue d’une intervention, l’usager est maintenu en situation de dette. Il a bénéficié de la solidarité sociale et ne peut se dégager de la dépendance symbolique que cela crée entre lui et la société, il est débiteur. La position de participant telle que nous la définissons ici permet d’échapper à ce dilemme.
¨ Participant à l’action, l’usager participe également à sa définition, à son orientation : La posture du participant n’autorise plus que les choses se définissent en dehors de l’usager. Il est acteur, co-créateur.
Roland JANVIER
[1] R. Janvier et Y. Matho « Mettre en œuvre le droit des usagers dans les établissements d’action sociale » Dunod – 2002.
[2] Cf. J.R. Loubat « Instaurer la relation de service en action sociale et médico-sociale » Dunod – 2002
[3] R. Janvier et Y. Matho « la relation professionnelle usager : un conflit fécond à gérer » in « Institutions et organisations de l’action sociale : crises, changements, innovations ? » coordonné par C. Humbert – L’Harmattan – 2003.
[4] Jean-Marc Lhuillier « Les conséquences du développement du droit des usagers sur la responsabilité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Revue de droit Sanitaire et Sociale – 2002
[5] Ibid.
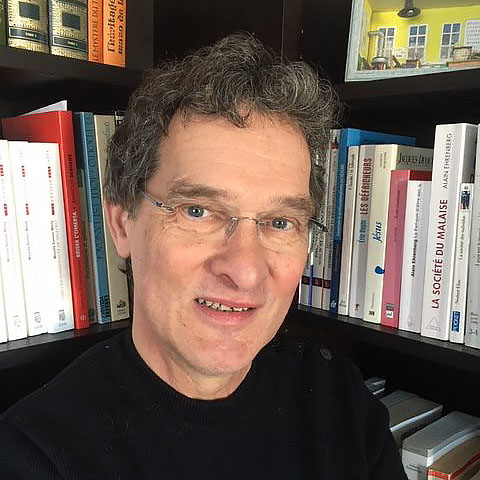
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.



