Innover ou mourir, telle semble être l’alternative d ans laquelle se trouvent les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il faut « transformer l’offre », c’est l’injonction adressée par les autorités publiques aux acteurs de l’action sociale et médico-sociale. Cette injonction pose deux problèmes essentiels. D’une part, la rhétorique employée laisse entendre que toutes les pratiques et organisations sont irrémédiablement obsolètes. D’autre part, que c’est par la rupture avec le passé que peut désormais s’opérer le changement.
C’est pourquoi il nous faut prendre le temps d’interroger cet engouement pour l’innovation qui doit, de plus, être « disruptive ». Pour cela, revenons aux caractéristiques fondamentales de toute évolution technique – car la transformation de l’offre sociale et médico-sociale est une évolution technique – afin de développer une analyse critique de l’innovation telle qu’elle est promue dans ce secteur pour, finalement, ouvrir quelques perspectives sur la manière de transformer l’offre.
- Caractéristiques de l’évolution technique
Contrairement à une idée reçue, les évolutions techniques qui ont accompagné la lente humanisation de l’homme ne sont pas des lignes droites. Si elles sont marquées par des ruptures, elles sont surtout le résultat d’éléments contextuels qu’il convient d’identifier.
D’une part, l’innovation ex-nihilo n’existe pas et n’est pas systématiquement synonyme de progrès, d’autre part, elle suppose des conditions de faisabilité qui la conditionnent plus fortement qu’on ne le pense.
- De la « disruption » : tout changement n’est pas bon à prendre
Depuis les dernières élections présidentielles, le terme « disruption » est entré dans le langage courant comme le socle de tout processus d’innovation. N’oublions pas d’où il nous vient : du latin disruptionem, qui donne le verbe disrumpere signifiant briser en morceaux, faire éclater, rompre, détruire. La traduction française de l’anglais « disruptive » est « perturbatrice ». C’est en sciences (électricité, électronique, atomique) que le terme est d’abord utilisé pour signifier la rupture d’une charge électrique créant un court-circuit, dégradant l’environnement (un isolant par exemple). Puis le concept migre vers les sciences économiques. Disruption est, depuis 1992, une marque déposée appartenant à TBWA, un réseau publicitaire New-Yorkais. Son PDG en donne cette définition : « L’innovation disruptive est une innovation de rupture, par opposition à l’innovation incrémentale, qui se contente d’optimiser l’existant.[1] » Sous cet angle, disruption signifie une transformation radicale des règles d’un marché soit par l’entrée d’un nouvel acteur (les « start-up »), soit par la modification de l’offre. Christensen précise : « Disruptive innovations originate in low-end or new-market footholds[2]. » Cette dernière citation introduit un doute dans la pensée commune qui tend à assimiler la disruption à un mouvement systématiquement positif d’amélioration. Il peut clairement s’agir d’une perte qualitative résultant des lois du marché.
Pourtant, le langage dominant associe toute innovation à une positivité naturelle, le « must » étant l’innovation disruptive, c’est-à-dire non seulement imposée par le cours naturel des choses mais faisant table rase des vieux dispositifs, présentés alors comme inévitablement inadaptés aux besoins de ce temps.
Tout changement n’est pas nécessairement bon à prendre, il peut parfois représenter une régression et, de plus, changer en s’affranchissant des savoirs et expériences hérités du passé peut devenir une aventure risquée. Il n’est pas certain qu’Uber soit un réel progrès du métier de chauffeur de taxi. Il n’est pas certain que la disruption opérée par la SNCF représente une amélioration des conditions de transport des usagers du train. Il n’est pas certain qu’Apple, en imposant ses standards numériques à la planète entière, ait finalement apporté une amélioration qualitative des communications. Et la liste pourrait être allongée.
- De la transformation : des conditions de faisabilité
En contre-feu de cette vision idéologiquement suspecte et intellectuellement béate de l’innovation disruptive, il nous faut revenir vers quelques éléments fondamentaux des processus d’évolution. Toute transformation du milieu technique dans lequel évoluent les êtres humains répond à quelques lois relativement stables depuis que l’homme est homme.
Par milieu technique, il faut entendre le contexte dans lequel nous évoluons tous qui est peuplé d’objets techniques, de dispositifs et d’artefacts. C’est-à-dire d’outils (du silex au marteau et à l’ordinateur), de systèmes (des voies romaines au réseau routier et au Web) et de toute cette production artificielle humaine qui se distingue des éléments originellement disponibles dans la nature.
Le milieu technique, indissociable de l’expérience humaine, n’est pas un donné en soi mais un milieu en perpétuelle évolution/transformation. Il résulte de multiples facteurs d’influence qui impactent ce que nous nommons vulgairement les progrès techniques mais aussi la manière dont ces objets, dispositifs et systèmes s’inscrivent dans des cultures, des contextes sociaux, des rapports humains.
Tout objet technique est déterminé par le milieu dans lequel il évolue. Il est transformé par le milieu qu’il traverse et, ce faisant, transforme ce milieu. Pour illustrer cela, il suffit d’observer le phénomène du smartphone. Né de la nécessité de gagner en liberté de mouvement dans les communications, de s’affranchir du fil des vieux téléphones, il s’est perfectionné au contact de ses usagers et de leur milieu technique (transferts de textes, d’images, de vidéos, accès à l’Internet) et, dans le même mouvement, il a modifié le milieu (mobilités, repérage dans l’espace, disponibilité des datas, etc.).
Penser l’innovation sans prendre en compte le milieu technique dans lequel les objets créés vont évoluer est une forme de myopie qui participe de la dénaturation des transformations du monde ou, du moins, de leur interprétation.
La transformation du milieu technique par l’introduction de nouveaux dispositifs techniques repose sur des conditions de faisabilité assez précises. André Leroi-Gourhan[3] dans ses travaux d’ethnologue, d’archéologue et d’historien spécialiste de la préhistoire nous permet d’en identifier trois.
La première condition est celle du besoin. Une évolution technique suppose qu’il y ait un besoin. Nous ne connaissons pas de progrès ou d’innovation qui ne soit pas apparue pour résoudre une difficulté, combler un manque ressenti ou améliorer une situation insatisfaisante. L’invention de l’enregistrement de sons sur un rouleau de cire, ancêtre du phonographe, par Thomas Edison était pensée pour être une prothèse destinée aux personnes muettes. L’invention du téléphone par A. Graham Bell était destinée aux personnes sourdes pour leur permettre de communiquer. Il est à noter qu’un besoin n’est jamais une réalité absolue mais toujours une contrainte contingente à son environnement. En conséquence, la réponse à un besoin n’est jamais univoque. Dans ce processus d’innovation, nous sommes loin de l’idée simpliste qui prétend « à tout problème sa solution ». La solution, réponse à un besoin, pose parfois de nouveaux problèmes. De plus, elle se trouve elle-même configurée par le contexte, reformatée par le milieu technique où elle s’inscrit. C’est ainsi que l’invention d’Edison a servi à enregistrer des musiques permettant leur reproduction en dehors de la présence d’un orchestre. Que celle de Bell a été appropriée par les dames bourgeoises de centre-ville pour communiquer entre leurs appartements. Bref, l’innovation technique est bien plus complexe que la simple réponse à un besoin. Elle s’inscrit dans des rapports de forces ou des jeux d’intérêts qui relativisent considérablement cette idée que toute évolution technique est un progrès positif en soi.
La seconde condition de faisabilité d’une évolution technique est celle de l’idée. Car pour inventer, il faut avoir une idée de l’objet à créer. Là encore, la réalité observée relativise le mythe de l’invention. L’histoire des techniques nous apprend qu’il n’existe pas d’invention ex nihilo, c’est-à-dire en dehors du contexte de son émergence et de l’historicité dans laquelle elle s’inscrit systématiquement. En fait, l’innovation technique se réalise par emprunt, par porosité avec les inventions déjà réalisées. Les qualiticiens, fréquemment promoteurs d’une conception disruptive des progrès qualitatifs à réaliser, ont l’habitude de prendre l’exemple de l’ampoule. En matière d’éclairage, l’ampoule électrique n’est pas une évolution incrémentale de la bougie. Cette affirmation laisse entendre que c’est parce qu’il y a eu rupture que l’éclairage par des lampes à incandescence a été inventé. C’est une vision idyllique des faits, laissant entendre que l’évolution technique est l’œuvre de génies et non de simples « copieurs ». C’est ignorer la proximité conceptuelle qui existe entre l’incandescence de la flamme pour la bougie, puis d’autres combustibles avec les lampes à huile, puis les becs de gaz avant l’ampoule. L’électricité, selon cette analyse, n’est qu’un changement de ressources mais reposant toujours sur le même principe. L’invention de Joseph Swan, perfectionnée par Thomas Edison, n’est donc pas une création « disruptive » mais l’aboutissement d’une évolution portée par de nombreuses recherches et suivies par d’autres (les ampoules halogènes, basse consommation, à LED…). Il en est ainsi de la quasi-totalité des innovations techniques.
La troisième condition de faisabilité d’une évolution technique est relative au milieu d’accueil de celle-ci. Les plus belles idées, les inventions les plus sophistiquées ne s’imposent à un groupe humain qu’à la condition que celui-ci soit en mesure de l’adopter. Cette adoption du milieu d’accueil n’est pas, là encore, un long fleuve tranquille. Plusieurs facteurs entrent en jeu : géographiques (qui expliquent par exemple le succès de la bicyclette aux Pays-Bas), cognitifs (qui expliquent par exemple la difficulté de pénétration du numérique chez les personnes âgées), d’usages (qui expliquent par exemple l’apparition très tardive des valises à roulette chez les passagers), culturels (qui expliquent par exemple l’hégémonie des déplacements automobiles malgré les embouteillages urbains), etc. Pour séduisante que soit l’illusion disruptive, nous mesurons à quel point l’appropriation d’un changement technique suppose de tenir étroitement compte du milieu d’adoption, de ses attentes ou appétences mais aussi de ses résistances.
- Pour une analyse critique de l’innovation
Il semble donc nécessaire de développer une critique étayée de cette mode de « l’innovation disruptive ». Pour cela, il est utile d’éclairer autrement les évolutions techniques en étudiant leurs conditions d’émergence. Le but poursuivi dans ces lignes est de nous amener à penser autrement les questions d’innovation. Je propose pour cela de nous centrer sur l’innovation dans le champ social et médico-social.
- Des savoirs capitalisés à intégrer
L’apparition du concept de performance, tel qu’il est porté par l’ANAP, tend à nous faire croire qu’il est urgent de faire rupture avec les pratiques anciennes pour adapter l’offre médico-sociale aux besoins actuels. Cette conception du progrès relève d’une vision scientiste des choses, vision qui porte l’idée d’une progression continue du monde du fait des progrès de la science qui, non seulement apportent une amélioration des situations, mais apportent systématiquement la « bonne » solution aux difficultés à résoudre.
La performance est un mythe du même ordre que la qualité : mots valises aux contours flous, utilisés systématiquement au singulier alors qu’ils relèvent de plusieurs plans distincts (l’organisation, les pratiques, les résultats produits, les effets induits, les significations suscitées…). La performance, c’est une norme de conformité déguisée en évidence. Au lieu de provoquer un débat contradictoire sur les finalités visées, elle s’impose comme un dogme indiscutable. De plus, ce dogme ne se construit pas à partir des pratiques et des expériences de terrain mais selon une logique descendante renforcée par l’autorité d’une agence surplombante fruit d’une pensée technocratique.
L’innovation ne peut jaillir de ce concept de performance. Contrairement à ce que prétendent les rhétoriques officielles, il constitue un frein à l’inventivité nécessaire des équipes de terrain pour s’adapter aux nouveaux défis qui se posent quotidiennement à eux.
De plus, cette affirmation d’une performance transcendante nie les expertises mobilisées sur le terrain. Toute définition extraterritoriale des « bonnes manières de faire » porte en elle l’effacement – sinon le reniement – des savoirs issus des expériences : savoirs impliqués des personnes concernées, savoirs professionnels des intervenants développant le croisement de la théorie et de la pratique, savoirs théoriques des scientifiques.
Il ne peut y avoir d’innovation sans prise en compte de ces savoirs capitalisés dans le temps qui configurent à la fois les pratiques, les professionnalités, les organisations et les élaborations théoriques. L’innovation disruptive, faisant table rase de ces dimensions, remettant en cause les pratiques et leurs constructions historiques est une amputation qui annihile ses chances de réussite.
À contre-feu de cette tendance stérilisante, il convient d’intégrer les héritages comme point d’appui de toute évolution technique. Cette intégration suppose d’effectuer un inventaire exigeant et critique permettant de tirer profit des réussites, de tirer leçon des échecs et de tirer enseignement des résultats obtenus et de leurs effets.
- Des références à théoriser
La tabula rasa induite par l’innovation et sa caution la performance, illusion d’un progrès possible ex-nihilo, affranchit le débat de toute dimension théorique. Pas besoin de discuter des références théoriques mobilisées quand la voie à suivre est présentée comme la seule pertinente. Il est intéressant d’observer en ce sens le plan de transformation de l’offre médico-sociale. Il recentre l’attention sur des indicateurs clefs permettant d’évaluer les évolutions à opérer pour transformer les vieux établissements en plates-formes de services.
Cette désinstitutionnalisation programmée des établissements et services sociaux et médico-sociaux semble être un pur produit de cette mécanique implacable qui, à chaque problème, associe la bonne solution sans poser aucune autre hypothèse. Une critique fondée des logiques asilaires a remis en cause le développement, que nous avons connu en France, d’institutions spécialisées avec les effets de stigmatisation et de marginalisation que l’on connaît. Le récent rapport de l’ONU sur le traitement français des personnes en situation de handicap va dans ce sens et provoque une accélération des projets de transformation : fermer les établissements au profit de plates-formes de services.
S’il est fondamental d’interroger des pratiques institutionnelles qui entretiennent des mises à l’écart de certains publics, il est tout autant indispensable de ne pas « jeter le bébé avec l’eau du bain ». Le droit d’inventaire nécessaire doit ouvrir une controverse, pas un procès. Une analyse critique sérieuse de l’histoire des établissements et services révèle des aspects négatifs mais aussi des acquis positifs. Il convient de les mettre en débat, pas d’ignorer les faits qui n’alimenteraient pas la thèse de la rupture.
Les références théoriques et pratiques qui ont permis la construction du champ de l’intervention sociale ne peuvent être ignorées ou passées au crible d’une seule grille de lecture. Elles participent d’une théorie de l’action qui doit être explicitée par le débat entre tous, jamais réduite à une pensée univoque et hégémonique.
Pour illustrer ce point, nous pouvons évoquer le sujet épineux de la psychanalyse. Ce courant a fortement influencé la construction des pratiques éducatives et thérapeutiques dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans la seconde moitié du XXème siècle. Pensée hégémonique dans certains domaines, la théorie psychanalytique a été fortement remise en cause. Mais du nécessaire débat qui aurait du interroger sa cohérence au regard de l’évolution des neurosciences, nous avons assisté à une autre prise de pouvoir des théories cognitivo-comportementales. Ce sont les thérapies comportementales qui sont jugées performantes, notamment par la HAS qui recommande de ne plus utiliser la psychanalyse. L’innovation technique a gommé la question de l’inconscient et confisqué au sujet toute une dimension de sa réalité. Cet exemple montre qu’une innovation par suppression d’un héritage n’est pas un progrès mais une perte.
La mise en débat des héritages référentiels participe de leur intégration critique dans l’ensemble théorique qui contribue à l’évolution technique et conceptuelle du secteur social et médico-social. En ce domaine, toute instrumentalisation de la pensée est infructueuse.
- Des choix à opérer
De plus, aux nécessaires controverses théoriques qui doivent alimenter la transformation de l’offre sociale et médico-sociale, s’ajoute une autre dimension d’ordre politique. La tentation radicale d’une rationalité instrumentale visant à tout formater tend à effacer les composantes socio-politiques des interventions sociales en les réduisant à de simples prestations dont la qualité se résumerait à quelques conformités de principe.
Nous avons vu que les évolutions techniques sont totalement immergées dans les débats sociétaux qui participent à la construction d’un destin commun des communautés humaines. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le travail social. Parce qu’il est un travail sur la société et son devenir, il renvoie à des questions éminemment politiques, c’est-à-dire à la place de chacun dans la cité.
À l’idée, sous-entendue plus haut, que la technique est avant tout sociale, nous pourrions ajouter l’affirmation que, de ce fait, la technique est aussi, et essentiellement, une question politique. En conséquence, une évolution technique en général et plus encore dans le domaine social et médico-social, doit s’analyser selon des critères d’ordre politique : quels sont les rapports sociaux qui l’ont rendue possible ou envisageable ? À qui profite la transformation ? Ces simples questions font tomber toutes les évidences qui alimentent la rhétorique transformatrice des autorités publiques. Aucune évolution des pratiques n’est neutre. Elle porte systématiquement des significations et des implications qu’il convient de mettre au jour.
- La complexité des organisations du travail social
Si, maintenant, nous focalisons l’analyse sur les organisations qui mettent en œuvre les politiques sociales, nous découvrons qu’en ce domaine également, l’idée qu’un idéal organisationnel existerait indépendamment des contraintes qui pèsent sur elles.
- Du mythe de la perfection
Il y aurait une forme idéale applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, existant indépendamment de toute contingence. Il suffit, pour cela, d’appliquer les consignes des experts qui, en surplomb des réalités, déterminent cette forme idéale.
Ceux qui refusent de participer à ce mouvement positif vers la perfection sont alors perçus comme des retardataires, inutilement attachés à des méthodes dépassées. Puisque la voie idéale est tracée, il faut être inintelligent ou mal intentionné pour ne pas l’emprunter.
Ainsi, les thuriféraires de la transformation de l’offre médico-sociale, les afficionados des plates-formes de service, les partisans du réengeenering des dispositifs sont tous convaincus, à l’instar de Margaret Thatcher que « there is no alternative ». Ces prétendus modernisateurs de l’action sociale et médico-sociale font simplement l’impasse sur les conditions de toute transformation technique. Il ne suffit pas d’avoir l’idée – au demeurant tout à fait pertinente – de développer des plates-formes de services plutôt que des dispositifs lourds d’hébergement susceptibles de générer des discriminations. Il faut envisager la manière dont elles peuvent tirer profit des savoirs cumulés par l’expérience d’autres manière de procéder, de prendre le temps de l’acclimatation du projet dans les cultures professionnelles, de développer une analyse critique sur les avantages et les inconvénient de cette hypothèse. Au lieu de cette démarche pragmatique et intégrée, l’idée est promue comme la solution parfaite qui va régler tous les problèmes. Dans ce genre de raisonnement en ligne droite, le chemin le plus court entre le problème et sa solution, on en arrive très vite à la conclusion qu’il faut fermer les internats, quitter les solutions trop institutionnalisées, remettre en cause la notion même d’établissement.
Nous voyons les dégâts que peut causer ce mythe de la perfection. Les meilleures idées – et la transformation de l’offre médico-sociale orientée vers le développement de plates-formes de services en est vraisemblablement une – se trouvent ainsi vouées à l’échec par défaut d’encastrement dans un milieu technique qu’il convient de prendre mieux en compte.
- Des contingences du changement
Prendre en compte les contingences de tout changement n’est pas un plaidoyer pour l’immobilisme ou pour réduire toute évolution aux seuls changement qu’un esprit corporatiste serait en mesure d’accepter. Il s’agit plutôt d’une invitation à développer une plus grande vigilance sur les conditions qui rendent possible l’innovation. À ce point de l’analyse, il apparaît que les éléments qui empêchent l’innovation sont :
- la prise décision dans des instances trop éloignées des lieux où elle produira des effets ;
- des choix posés en extériorité aux acteurs concernés ;
- des options qui n’intègrent pas les références déjà à l’œuvre ;
- l’imposition des transformations selon une logique descendante qui ne prend pas en compte l’avis des acteurs concernés
- l’orientation univoque des solutions à mettre en œuvre présentées comme la seule possibilité ;
- l’instrumentation de la transformation par toute une batterie d’outils que les acteurs peinent à s’approprier.
Force est de constater que ces éléments qui hypothèquent la réussite des transformations techniques sont, dans le secteur social et médico-social, particulièrement présents. Pour exemple, nous pouvons citer les dispositifs de premier accueil inconditionnel, du logement d’abord, des parcours de vie, de l’accompagnement global, etc.
- Penser les transformations
Nous ne pouvons en rester là. Si la critique argumentée développée dans ces lignes remet radicalement en cause les manières de faire trop souvent observées dans le secteur social et médico-social, il nous faut maintenant brièvement ouvrir des voies permettant d’envisager l’innovation autrement.
- Assumer l’héritage et l’ici et maintenant
Contrairement à l’idée que pour évoluer il faut s’affranchir du passé, il faut défendre la conviction que l’avenir ne peut s’envisager qu’en assumant le passé. Assumer le passé ce n’est pas le mythifier mais opérer un droit d’inventaire pour identifier les acquis positifs et les réalités négatives qui ont construit l’histoire du champ.
Le changement suppose de prendre en compte la situation où il est envisagé. C’est-à-dire à considérer que c’est ici et maintenant que les choses peuvent évoluer et non dans une projection fantasmatique vers un idéal à atteindre. Le grand soir n’existe pas, la transformation du monde se joue dans le concret des situations vécues. C’est dans cette immanence de l’expérience que se joue la transcendance des destins communs.
Vouloir ignorer cette concrétude des choses revient à projeter les acteurs dans un rêve inaccessible qui, à terme, se transforme en cauchemar. Cauchemar lié à la frustration de ne pas parvenir à atteindre l’idéal, à la désillusion d’un résultat éloigné des buts annoncés.
Refuser de faire table rase c’est reconnaître les savoir-faire des acteurs, leur laisser la parole sur ce qu’ils souhaitent, projeter avec eux plutôt que contre eux.
- Réformer les pratiques
C’est une autre façon d’envisager les évolutions des pratiques professionnelles qui est défendue ici. Au lieu de définir les transformations a priori, en dehors des situations où elles se déploient, il s’agit d’observer comment elles se jouent dans les faits. Les technocrates de l’innovation seraient surpris de découvrir alors l’inventivité des acteurs, la manière rusée dont ils bricolent des solutions ici et maintenant.
Pour illustrer cela, il faut prendre le temps d’observer la manière dont professionnels et usagers se sont ajustés aux contextes d’action créés par la pandémie du COVID. Il n’a pas été nécessaire d’éditer de multiples notes de service ou recommandations ou protocoles pour que les uns et les autres trouvent les moyens de maintenir les liens, de poursuivre l’action. Une « transformation de l’offre » s’est jouée au cœur même des situations, souvent à l’insu des autorités publiques, qui aurait pu inspirer de manière féconde la façon d’envisager l’évolution des pratiques en travail social.
- Élaborer une vision politique
Finalement, et ce sera ma conclusion, on peut se demander si les conditions dans lesquelles est promue la transformation de l’offre du travail social ne reposent pas sur un leurre. Sous prétexte d’adapter l’offre sociale et médico-sociale aux défis des temps présents, pour améliorer la réponse aux besoins des usagers, nous assisterions à un tout autre scénario. Le cheval de Troie de la transformation disruptive poursuivrait en fait une entreprise d’instrumentalisation des organisations du travail social.
Certains défendent cette orientation en affirmant qu’il est indispensable d’outiller autrement ces structures qui n’évoluent pas assez vite au regard de la mutation des contextes. Mais il nous faut aller plus loin en tentant de répondre à la question « à qui profite cette injonction à la transformation ? »
Là, les choses se compliquent car il n’est pas certain que le bénéfice de l’opération aille directement aux usagers. Il n’est qu’à observer : le déficit de moyens d’accompagnement des personnes, la situation des auxiliaires de vie scolaire à l’Éducation nationale, le manque de moyens du secteur de l’insertion, la loi grand âge sans cesse promise et ajournée, l’échec relatif de l’accompagnement des parcours dans les MDPH, etc.
Par contre, nous assistons à une mainmise des pouvoirs publics sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans des proportions jamais atteintes jusque-là. Il n’est qu’à observer : des Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens de plus en plus formatés, des appels à projets de plus en plus étroits, des modalités de gestion très contraignantes (convergence tarifaire, EPRD, ONDAM…).
L’enjeu ne serait finalement pas d’adapter l’offre aux besoins mais de la formater aux é-exigences d’une administration hypertrophiée, omnisciente et intrusive.
C’est pourquoi il me semble urgent d’assortir le projet de transformation de l’offre sociale et médico-sociale d’un large débat sur les orientations politiques visées. Il s’agit en fait de « détechniser » les mutations techniques pour délibérer sur leur portée politique.
Réformer les pratiques suppose de les réencastrer dans leur dimension politique.
[1] Dru J-M., New: 15 approches disruptives de l’innovation, Pearson (France), 2016.
[2] « Les innovations disruptives trouvent leur origine dans les bas de gamme ou les nouveaux marchés. » Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, & Rory McDonald, What Is Disruptive Innovation? Consultable sur : https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation.
[3] A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole -I- Technique et langage -II- La mémoire et les rythmes, Albin-Michel, 1964, L’homme et la matière, Albin-Michel, 1971, Milieu et techniques, Albin-Michel, 1973,
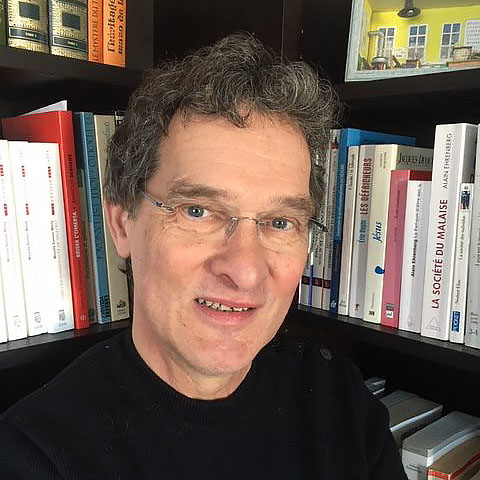
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.



