Introduction :
Juxtaposer ces deux concepts de performance et de bienveillance pourrait faire penser à une provocation. En pensant ce titre, ses concepteurs ne voulaient sans doute pas faire un oxymore… pourtant… Ma première réaction fut de penser que la notion de performance est contradictoire avec celle de bienveillance. Être performant, c’est ne pas faire de détails, aller droit au but sans trop s’occuper d’éventuels dommages collatéraux. Être bienveillant, tout au contraire, c’est accepter de perdre du temps pour porter attention à l’autre, accepter de remettre en cause ses visées pour tenir compte d’autrui.
C’est à partir de ce premier ressenti devant ce titre que je propose une prise de position, non un exposé savant sur ces concepts. Prise de position sujette à débats et à discussions, ce qui est une manière d’approfondir les significations et d’aller chercher derrière la façade des mots.
Si vous faites une recherche sur internet en associant ces deux termes, vous découvrirez que bienveillance et performance forment un tandem d’une mode néo-managériale. Vous trouverez des articles où la bienveillance est présentée comme un levier majeur de la performance de l’entreprise. Plusieurs font référence à une étude de la Havard Business Review[1] qui démontre qu’un management fondé sur la bienveillance portée aux salariés peut améliorer la rentabilité de l’entreprise jusqu’à 20 % !
Par cette dérive néolibérale où le profit immédiat dévore toutes les autres valeurs, la bienveillance se trouve dégradée au rang de simple tactique pour obtenir le meilleur profit de la force de travail des subordonnés, loin des références humanistes qui en constituent la genèse.
Tentons donc d’aller plus loin et d’envisager une association de ces deux concept pour servir les pratiques professionnelles.
- La bienveillance : une idée neuve ?
La bienveillance serait une disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers autrui (Larousse). En quoi, pourquoi et comment cette vieille notion d’attention à l’autre s’est constituée comme une idée nouvelle en travail social ? Je vous propose une approche subjective de cette histoire.
- Une approche subjective de l’histoire de ce concept
Nous pouvons repérer cinq étapes dans la manière dont autrui a fait l’objet de représentations en travail social. Balayons rapidement ces strates historiques. Par strate, je n’entends pas uniquement des tranches chronologiques mais aussi la manière dont les conceptions font sédiments d’une culture, s’alimentent et s’entretiennent les uns les autres.
La charité de l’ancien régime :
On a l’habitude de situer l’origine du travail social par les œuvres religieuses de bienfaisance. Le modèle dominant est alors le principe de charité : Faire le bien de l’autre. Cette posture induit subrepticement une différence de position entre l’aidant et l’aidé. Le premier est en position de supériorité – ce qui lui permet de porter secours – alors que le second est en position d’infériorité – il demande de l’aide… La bienveillance rime avec magnanimité.
Le secours de la Nation
La Révolution française opère une rupture avec ce premier modèle. La Convention nationale qui rédige la constitution de la 2ème République pose le principe d’un droit de secours pour les citoyens[2]. La « bienveillance » (ce terme n’a pas encore cours) devient implicitement un devoir pour l’État à l’égard des citoyens. Le développement de l’action sociale en France va connaître des phases différentes selon les époques mais toujours marqué par une montée en puissance du rôle de l’État.
L’assistance publique
L’assistance publique est un vieux terme pour désigner l’action de soutien de l’État aux personnes en difficulté. C’est de l’après-guerre à 1975 que fleurissent de nombreuses institutions d’assistance : enfance malheureuse ou délinquante, handicapés, personnes âgées, etc. La bienveillance, c’est de porter secours aux publics marginalisés par les aléas de l’existence.
La prise en charge
La technicisation du travail social – que l’on peut situer dans le dernier quart du vingtième siècle – génère la structuration d’un secteur et de ses références (Cf. notamment les lois du 30 juin 1975). Les « publics cibles » – nous sommes à l’époque de la planification rationnelle des actions étatiques – sont « pris en charge » par des « institutions » de plus en plus spécialisées. Prendre en charge c’est porter une bienveillance empreinte de substitution, de suppléance dont les effets en miroir signifient incompétence ou incapacité.
Le « care »
En 2002, le droit des usagers fait irruption dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. Fruit d’une longue évolution, la législation marque le fait que toute personne accueillie ou accompagnée est d’abord sujet de droits. Il s’agit alors, au titre de la bienveillance, de « prendre soin » (care en anglais) des bénéficiaires. Ce n’est pas une révolution en ce sens que ce mouvement résulte des évolutions cumulées dans le temps. C’est par contre une transformation substantielle des pratiques professionnelles : désormais, la bienveillance suppose de faire « avec » l’usager.
- La recommandation sur la bientraitance de l’ANESM
Il me semble que la notion de bienveillance trouve une expression symptomatique avec cette recommandation de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) éditée par l’ANESM en juin 2008. L’introduction de la RBPP situe d’ailleurs la bienveillance comme une notion « préparatoire et complémentaire » de la bientraitance et retient pour cette dernière « l’importance de l’intention vers l’autre… »
L’usager partie prenante :
La bientraitance repose sur le fait que l’usager « est co-auteur de son parcours ». L’accompagnement respecte ses droits et sa liberté de choix, suppose une information – condition de l’autonomie – et de ne pas nuire. Entre prise de risque et sécurité des personnes, la bientraitance suppose un projet personnalisé qui balise le parcours de la personne et s’adapte à son évolution.
La relation professionnel/usager
Mais la bientraitance, nous dit la RBPP, repose également sur la qualité du lien entre professionnels et usagers. Le fondement de l’intervention c’est le respect de la singularité de chacun et, par voie de conséquence, d’ajuster une réponse à ses besoins spécifiques. Il revient aux professionnels d’assurer la sécurité physique des personnes accompagnées. Cela suppose un cadre institutionnel stable, qui ne soit ni rigide ni informel.
La qualité de l’organisation et du fonctionnement
La RBPP insiste également sur la qualité de l’organisation, tant dans sa capacité à travailler avec l’environnement que dans le soutien qu’elle apporte aux professionnels dans leur démarche de bientraitance.
La capacité à travailler avec l’entourage des personnes accueillies est essentiel à la bientraitance : prendre en compte l’entourage dans la construction des projets, créer des lieux et des occasions de rencontre, ne pas juger, développer des réseaux sociaux autour des personnes isolées…
Bien traiter, c’est ne pas vouloir tout faire seul. L’organisation doit être en mesure de mobiliser des ressources externes, notamment en développant des partenariats.
Développer les lieux de parole permet d’améliorer la capacité des salariés à bien traiter les usagers : permettre aux usagers de formuler leurs souhaits, favoriser les échanges professionnels / usagers / familles, développer les échanges entre professionnels, supervisions ou analyses de pratiques, réflexions éthiques, etc.
- Comment « bien veiller » en travail social ?
Pour répondre à cette question, je vous propose de partir de la définition du travail social qui a été inscrite dans le Code de l’Action Sociale et des Familles en son article D142-1-1 :
« Le travail social vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.
A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.
Le travail social s’exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d’un accompagnement social. »
Les droits fondamentaux
Finalement, cette définition nous rappelle les droits fondamentaux de toute personne accueillie ou accompagnée.
Au premier rang de ceux-ci, nous pouvons reprendre, pour le compte du travail social, le premier principe du serment d’Hippocrate « Primum non nocere » c’est-à-dire « avant tout ne pas nuire ». Ce principe promeut la non-violence institutionnelle. Facile à dire, beaucoup plus délicat à vivre au quotidien d’une organisation du travail social. La situation des usagers, l’asymétrie relationnelle qu’ils vivent avec les professionnels, les logiques institutionnelles, les contraintes de toutes sortes qui pèsent sur les pratiques, les facteurs sont nombreux qui peuvent transformer la volonté d’aider en maltraitance.
Ce principe de non-maltraitance est essentiel à toute perspective bienveillante. Il place le respect de la dignité des personnes comme un absolu déontologique qui surplombe toute relation, tout rapport à l’autre. Au plan éthique, cela signifie de placer la reconnaissance de l’autre comme postulat à la relation : reconnaître sa capacité à dire, faire et vivre ses choix, lui prêter la faculté de penser pour lui-même et par lui-même, le valider pour soi comme être de raison, quelles que soient les formes que prend cette raison dans sa vie, sa culture, sa manière d’être, voire sa pathologie.
L’inclusion sociale et l’exercice d’une « pleine citoyenneté »
Notre droit positif affirme la capacité de chacun à vivre une pleine citoyenneté. Notre dispositif d’action sociale affirme la perspective d’une société inclusive. L’inclusion de tous et la citoyenneté de chacun constituent les fondements du vivre ensemble. La bienveillance en travail social suppose donc de permettre aux personnes de vivre en « conformité » avec les normes sociales pour leur permettre de vivre avec les autres.
Une seconde dimension de la bienveillance vient compléter ce premier aspect. Vivre avec les autres suppose également d’être responsable de soi. Être responsable, c’est refuser le confort du statut de victime, statut déresponsabilisant car il empêche le sujet de prendre en main son destin pour changer sa situation, même si celle-ci lui est imposée par des facteurs exogènes.
L’émancipation, l’autonomie et la participation
Dans le même sens, il convient de dépasser le principe de protection. Si celui-ci est incontournable (on pense ici à la protection de l’enfance), il n’est pas suffisant pour fonder une stratégie d’action bienveillante à l’égard des personnes. Il nous faut passer de la protection à la promotion. C’est-à-dire, développer les capacités d’agir des personnes.
Ce mouvement permet de quitter les rives de l’aliénation. Le meilleur moyen de se libérer des déterminismes sociaux qui pèsent si lourd sur les situations que rencontrent quotidiennement les travailleurs sociaux, c’est de promouvoir la solidarité : solidarité à l’égard des personnes en situation de vulnérabilité – cette solidarité concerne tant les collectivités publiques que les professionnels eux-mêmes – mais aussi solidarité des personnes fragiles entre elles.
Promotion est synonyme de prise de parole dans l’espace public. Dire les situation vécues, dénoncer les conditions sociales inadéquates, exprimer ses ressentis, affirmer ses positions, prendre part au débat public sur le destin commun, sont autant de manières de sortir des ornières dans lesquelles sont enfermés les usagers. Des maux à la parole, c’est un chemin de libération qui s’ouvre, condition d’une bienveillance active.
Le développement du pouvoir d’agir
Revenons un instant sur cette idée du pouvoir d’agir. Selon les auteurs, on parlera de capabilités ou d’empowerment. Il s’agit toujours d’agir sur son destin, de ne plus le laisser aux fatalismes de la vie sociale. Ce pouvoir d’agir concerne en premier lieu l’individu, mais aussi les collectifs. Car toute libération suppose une dimension sociétale.
Mais cela ne suffit pas. Agir pour soi et avec les autres induit une dimension plus large encore qui concerne tout l’environnement. Car il s’agit d’agir sur son environnement pour le transformer, modifier les conditions qui ont créé la situation problématique que l’on veut traiter. De fil en aiguille, la question environnementale, au sens écologique du terme, trouve sa place dans ce processus d’émancipation qui conditionne la bienveillance.
Finalement, agir sur son environnement, c’est participer directement, personnellement et collectivement au changement social pour garantir un avenir à notre planète.
Nous voyons que le concept de bienveillance, quand on creuse, ouvre des perspectives qui n’apparaissaient pas au premier abord.
- La performance : une fausse bonne idée ?
La performance, nous dit le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, c’est le résultat obtenu par un cheval, un athlète ou une équipe sportive. Ce sont aussi les « indications chiffrées, courbes, concernant les caractéristiques mécaniques (puissance, vitesse, autonomie) d’un véhicule ou les possibilités de vol d’un avion[3] ». C’est aussi, plus proche de nous, le « succès remporté par une personne ; action, exhibition, interprétation demandant des qualités exceptionnelles. » Ou encore le « Rendement, fiabilité très élevé ou exceptionnel d’une machine, d’un objet, d’un matériau. » Le Larousse parle quant à lui d’exploit ou de réussite remarquable en un domaine quelconque, « Résultat obtenu dans l’exécution d’une tâche. »
Que pouvons-nous faire, en ce qui concerne le travail social, de ce concept récemment importé dans les référentiels ?
- Comment ce concept a-t-il bien pu arriver dans le secteur social et médico-social ?
De manière très subjective, je vois deux axes d’explication à l’émergence de ce concept :
L’hégémonie de la rationalité instrumentale
Nous assistons à un retour massif du scientisme. C’est-à-dire à la résurgence de cette illusion qui consiste à croire que la science apporte – ou à défaut apportera – la solution à tous les problèmes humains. L’arrière-plan de cette croyance, c’est le positivisme qui tend à réduire toute expérience à l’épreuve des faits dans un rapport mécaniste entre causes et conséquences, ne laissant plus de place à d’autres modalités d’interprétation et de compréhension du monde. Ce mouvement entend réduire l’écart entre le problème et sa solution, instrumentalisant toute manière de faire et apportant les excès d’une rationalité qui s’appliquerait à tout le vivant.
C’est le fantasme de maîtrise qui sourd sous ce mouvement prétendu moderniste qui n’est peut-être qu’un retour des superstitions de nos ancêtres. Le fantasme humain de toute puissance, c’est de croire qu’un jour nous puissions parvenir à tout contrôler, tout prévoir, tout savoir… Ce serait cela la performance ?
Le nouveau management public
Une seconde piste peut expliquer cette dictature de la performance, c’est l’effritement des légitimités institutionnelles. Dans un monde de plus en plus incertain, les grandes institutions qui structuraient l’ordre social tendent à se déliter, leurs « programmes » ont perdu de leur puissance. Parallèlement à cette dissolution des institutions qui portaient la puissance publique, l’univers marchand s’est imposé comme une référence de plus en plus incontournable. Au point que l’administration publique s’est tournée vers les modèles de l’entreprise pour inspirer ses propres fonctionnements. L’État s’est converti à ce nouveau management public qui transpose directement aux collectivités publiques les logiques entrepreneuriales, supposées plus vertueuses grâce au jeu de la libre concurrence. Concurrence et performance se trouvent ainsi placées comme des synonymes.
Cette conversion aux valeurs du marché trouve sa traduction dans la logique de concurrence supportée par la réorganisation de la gestion des fonds publics.
La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF[4])
La LOLF, c’est le symptôme d’un nouveau mode de gouvernement par les instruments. Les budgets sont définis sous forme d’enveloppes liées à des programmes, les Budgets Opérationnels de Programme (BOP). Toutes les actions doivent désormais rentrer dans les cases budgétaires ainsi définies. Cette procédure est la consécration des logiques descendantes.
Elle va initier dans son sillage toute une panoplie d’outils pour le champ social et médico-social qui, sous couvert de performance, vont régenter son fonctionnement : les appels à projets qui placent les organisations en concurrence les unes avec les autres, les États Prévisionnels de Recettes et de Dépenses qui imposent la performance budgétaire comme priorité sur les actions, le projet de financement dans le secteur du handicap « serafin-ph[5] » qui découpe les prestations selon une nomenclature fondée sur un repérage des besoins, etc.
- Les conceptions véhiculées par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP)
L’importation du concept de performance dans le travail social est passé par le déploiement d’une agence dédiée : l’Agence Nationale d’Appui à la Performance.
« La convention constitutive de l’ANAP prévoit notamment les missions suivantes :
- La conception et la diffusion d’outils et de services permettant aux établissements de santé et médico-sociaux d’améliorer leur performance et, en particulier, la qualité de leur service aux patients et aux personnes ;
- L’appui et l’accompagnement des établissements, notamment dans le cadre de missions de réorganisation interne, de redressement, de gestion immobilière ou de projets de recompositions hospitalières ou médico-sociales;
- L’évaluation, l’audit et l’expertise des projets hospitaliers ou médico-sociaux, notamment dans le domaine immobilier et des systèmes d’information ;
- Le pilotage et la conduite d’audits sur la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
- L’appui aux Agences Régionales de Santé (ARS) dans leur mission de pilotage opérationnel et d’amélioration de la performance des établissements ;
- L’appui de l’administration centrale dans sa mission de pilotage stratégique de l’offre de soins et médico-sociale.[6]»
La régulation par l’outil
Le fond de décor de cette conception gestionnaire de la performance, c’est le mythe de « la » «Q»ualité. Pour faire bref, ce mythe laisse entendre qu’il existerait « une » qualité et qu’il suffirait d’atteindre ce niveau idéal d’organisation pour régler tous les problèmes. Le scientisme est toujours présent. Pour atteindre cette qualité unique, exclusive et idéale, cette perfection organisationnelle, il suffit de trouver la bonne procédure, la bonne pratique, la bonne organisation. Le mythe de la qualité nous conduit tout droit à la fiction du « bon » instrument. Il suffit d’avoir le bon outil pour que tout se passe comme prévu.
Toute cette fable résulte d’un transfert, sans adaptation aucune, des démarches qualité du monde de l’entreprise. Sauf qu’il est plus aisé d’avoir un protocole et des procédures immuables pour fabriquer une voiture ou un appareil électroménager que pour traiter des relations interpersonnelles.
Le fantasme d’une régulation parfaite par l’outil, garantie de la performance, ne se vérifie pas au quotidien du travail des professionnels du social.
L’amélioration par la gestion
De plus, ce bouleversement des références d’action pour le secteur social et médico-social, selon des logiques essentiellement gestionnaires et instrumentales, ne trouve pas de justification évidente. On peut avoir l’impression que les réformateurs cherchent le changement pour le changement sans s’appuyer sur une réelle évaluation de la situation. Les seules évaluations dont nous disposons sont celles – internes et externes – conduites par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et elles tendent plutôt à prouver, malgré l’insuffisance de moyens, la bonne adéquation des pratiques aux besoins. La limite de ces transformations radicales des tenants et des aboutissants du travail social, c’est qu’elles font table rase du passé. Comme si rien n’était à retenir des pratiques antérieures, des savoir-faire patiemment construits par l’expérience, des cultures qui forment l’identité du secteur.
Cette stratégie qui consiste à améliorer la performance des organisations par la gestion présente deux écueils. Le premier, que nous venons d’évoquer, c’est le mythe de l’organisation idéale.
Le second écueil, c’est que les logiques gestionnaires, à force de nous parler d’optimisation des moyens, d’économies d’échelles, d’efficacité des plateaux techniques, d’efficience organisationnelle, induisent ce qu’il convient d’appeler un tropisme du grossissement. Plus une organisation sera volumineuse, plus elle sera performante ! Une telle affirmation resterait à prouver à l’épreuve des faits…
La performance par la standardisation
Autre idée induite par cette conception néolibérale de la performance, c’est la standardisation. Issue des origines des démarches qualité, la standardisation est pensée comme le socle de la performance. En effet, l’industrie d’armement en passant des ajustements artisanaux à la standardisation des productions a permis l’interchangeabilité des pièces ce qui améliorait considérablement leur rendement sur les champs de bataille. La difficulté provient de l’extension de cette standardisation à toutes les activités de la société.
Si la vie sociale a besoin de norme, nous l’avons évoqué plus haut, le déploiement de la standardisation nous a fait passer de la norme à la normalisation. Pour le dire autrement, nous avons évolué d’un besoin de repères qui rendent possible le vivre ensemble à l’imposition de standards comportementaux.
Au fond, ne sommes-nous pas en pleine confusion entre la nécessaire cohérence d’une vie avec les autres et l’uniformité d’une vie standardisée ? Qu’est-ce qui ferait croire que la performance repose sur un standard ?
Le pilotage par le contrôle de conformité
La contrainte devient alors la manière de développer la qualité. Elle serait, en elle-même, un vecteur de la performance. Les références standardisées, imposées d’en haut, font alors l’objet de contrôles pointilleux de la conformité des pratiques et des organisations. La performance serait à ce prix. Prix cher payé par les acteurs de terrain. Notamment parce que cela génère l’infantilisation des acteurs.
La planification par l’uniformisation
Finalement, la performance, telle que la développe l’ANAP – qui n’est ici que le symptôme d’un mouvement bien plus large – signe la victoire de la bureaucratie : dépersonnalisation des règles, routinisation des pratiques, déshumanisation du travail, hiérarchisation des rapports, morcellisation des tâches, instrumentalisation des acteurs, hégémonie du contrôle, rigidité et immuabilité des consignes, etc.
Nous assistons ainsi à l’hégémonie de la technocratie. C’est le pouvoir des experts qui est seul légitime à définir ce qui est bien et ce qui est mal selon une vision binaire du monde. C’est la domination de la technique qui tend à tout réduire à des mécanismes simples. C’est la réduction des compétences à quelques opérations standardisées qui enferment les pratiques.
- Comment être « performant » en travail social ?
La performance dont nous avons besoin en travail social est assez éloignée des conceptions exposées ci-dessus. Pour répondre à la question « comment être performant en travail social ? », revenons vers la définition officielle du travail social dont s’est dotée la France que nous avons citée en première partie. Elle nous montre déjà des proximités possibles entre bienveillance et performance que nous développerons ultérieurement.
Éthique et déontologie, les proches cousines de la bienveillance
Nous avons vu la proximité naturelle qui existe entre la bienveillance et l’éthique et la déontologie. Ces deux derniers éléments, qui fondent les positionnements professionnels, nous sont également utiles pour penser autrement la performance.
La performance, pour s’extraire de la rationalité instrumentale qui est une impasse pour le travail social, doit se fonder sur la reconnaissance intersubjective. Être performant dans le travail avec et pour autrui, c’est d’abord reconnaître et assumer l’altérité. L’autre n’est pas moi, mais il est tout autant digne que moi. Nous partageons cette commune humanité mais nous ne sommes pas en fusion. La performance suppose ce travail de proximités / distances. C’est dans cet interstice qui relie les personnes que peut se déployer une forme spécifique de performance relationnelle, faite d’estime réciproque, de considération et de prévenance.
Cette performance-là ne peut relever de standards, elle est invention quotidienne.
Le croisement des savoirs : un accélérateur de performance
À l’opposé d’une performance standardisante et uniformisante, il nous revient de plaider pour une performance qui repose sur un choc des cultures. Prendre en compte l’asymétrie relationnelle qui prévaut en travail social suppose de s’interroger sur les intérêts en présence, les différences de cultures, les inégalités des formes d’expression, les écarts de compréhension et d’interprétation des faits.
La performance est à ce prix. Elle réside dans la capacité à tenir compte de toutes ces dimensions.
La co-construction une garantie de performance
À l’inverse d’une performance imposée d’en haut, le travail social a besoin d’une performance fondée sur la solidarité entre toutes les parties prenantes de l’action. Il s’agit de vivre la solidarité, de la concrétiser au plus près des situations humaines. Être performant, ce n’est pas arriver avec des solutions toutes faites mais être en mesure de construire des réponses avec les personnes concernées, modulées en fonction d’elles et des situations concrètes. Rien de générique dans cette démarche pragmatique.
Finalement, être performant, n’est-ce pas revenir au sens premier d’« accompagner » ? C’est-à-dire, cette capacité à cheminer avec l’autre, à rompre le pain avec lui.
Le « côte-à-côte » et le faire ensemble : leviers de performance
À distance des approches technocratiques, la performance dont il est ici question, repose sur l’alliance construite entre professionnels et usagers. Elle réside dans la capacité des uns et des autres à compromettre quelque chose de soi dans le rapport à autrui.
Cette aventure relationnelle, où tout ne peut être défini d’avance, vise à laisser place à l’imprévu.
- Quelques pistes pour une alliance vertueuse de la bienveillance et de la performance
Nous venons de parcourir les notions de bienveillance et de performance, telles qu’elles sont notamment véhiculées par la définition légale du travail social pour la bienveillance et par l’ANAP pour la performance. Ce chemin nous a montré les contre-feux à allumer pour éviter les risques de dérives du travail social, particulièrement pour ce qui concerne la performance.
Ce paragraphe se propose maintenant d’envisager des pistes susceptibles de rendre ces concepts opérationnels pour les professionnels de terrain. En effet, dans les contextes rapidement décrits, comment un travailleur social peut-il se donner des repères structurants pour établir son positionnement ?
Nous investiguerons trois aspects : le projet, le travail et l’organisation.
- Le projet : un actif circulant
La performance de l’établissement ou du service repose sur son projet
Le projet permet de « faire équipe », ce qui constitue la base de toute performance opérationnelle. Parce que la performance n’est pas une affaire individuelle. Nous voyons comment les injonctions à une performance solitaire mènent droit au « burn-out » ! La performance, pour être soutenable, doit être une affaire collective, une mobilisation en équipe. Le projet fédère les acteurs sur les axes qu’il pose, il permet aux énergies individuelles de converger et de se compléter.
Le projet, c’est le lieu du compromis évoqué plus haut : il synthétise des points d’accord négociés entre tous (orientations, références, méthodes, modes opératoires…). C’est cette cohérence qui est gage de performance.
Dessinant un horizon commun, le projet permet de mobiliser toutes les parties prenantes en assurant une place à chacune. Car le projet n’appartient ni aux seuls administrateurs de l’organisme gestionnaire, ni aux seuls professionnels, il est un bien commun partagé entre tous et, notamment, avec les usagers et leurs familles.
La bienveillance des uns vis-à-vis des autres doit être garantie par le projet d’établissement ou de service
Le projet est un repère essentiel pour l’action. En fédérant tous les acteurs – comme nous venons de le dire – il a pour fonction première de compenser l’asymétrie des places et des rôles entre les acteurs. En effet, une distinction doit être opérée entre les statuts fonctionnels des acteurs d’une organisation de travail (hiérarchie, métiers, positions) et les rôles des personnes parties prenantes de l’organisation. Quand il s’agit de parler du projet – le destin commun des membres du système – les différences statutaires s’effacent pour octroyer à chacun un droit égal à la parole, une parité des expressions individuelles.
C’est dans cette deuxième dimension de la relation – que nous pourrions affubler de l’adjectif « citoyenne » – que se joue essentiellement la bienveillance car elle est une scène de rencontre d’homme à homme (intégrant les femmes bien entendu !).
Le projet collectivise les problématiques. Puisqu’il mobilise la dimension collective, il ne laisse personne seul face à ses difficultés. Il signifie en actes cette idée que c’est ensemble que nous pouvons faire quelque chose, que nous pouvons trouver des issues. Par le projet, ce qui est « mon » problème devient « le » problème à traiter collectivement.
Finalement, nous pouvons dire que le projet introduit une dimension politique transversale dans les problématiques singulières. Et ce mouvement-là confère à la volonté de bienveillance toute sa dimension pour ne plus en faire une simple question de « bons sentiments »
- Le travail : un rapport ouvert
Deuxième aspect permettant d’articuler bienveillance et performance, le travail.
Le travail, l’œuvre et l’action
Hannah Arendt[7], identifie trois niveaux des activités humaines : le travail, l’œuvre et l’action.
Le travail (dont la racine latine tripalium fait référence à un instrument de torture), c’est ce que fait l’homme pour (sur)vivre. Le travail est une contrainte, il est soumis aux nécessités de produire.
L’œuvre, c’est ce que crée l’homme. Par ce qu’il fait, l’humain participe à la construction du monde. Cette conception de l’activité dépasse la simple production pour esquisser des finalités qui vont plus loin que l’acte lui-même.
L’action, c’est ce que vivent les hommes. Cette dimension de l’activité humaine ouvre à la transcendance du monde matériel.
Pour illustrer ces trois niveaux de représentation de l’activité humaine, une petite histoire déjà bien connue :
Au temps des bâtisseurs de cathédrales, un homme visite un chantier et interroge un premier tailleur de pierre sur ce qu’il fait. Celui-ci répond : « Je taille une pierre ». Il pose la même question à un second artisan qui répond « Je construis un mur ». Le troisième qu’il interroge lui déclare rayonnant : « Je bâtis une cathédrale ! ». Ces trois réponses illustrent les trois niveaux de conception que l’on peut avoir de son « travail ».
Nous pouvons conclure qu’une vision ouverte du travail social, à la fois travail, œuvre et action, est une voie vers la bienveillance et la performance. Inversement, une conception réductrice du travail social, simple instrument au service de prestations imposées et formatées, est source de malveillance, d’impuissance et d’incapacité.
Le travail « bien fait »
Bienveillance et performance supposent toutes deux que le professionnel aspire à un travail bien fait. Yves Clot nous dit que « La véritable expertise professionnelle se définit justement comme la capacité, dans une situation donnée et à travers des circonstances toujours changeantes, à tenir compte des différents critères qui permettent de prendre la bonne décision. (…) Le professionnalisme consiste à disposer d’une variété de critères pour prendre une décision adéquate en fonction de la situation.[8] »
Il distingue l’intensité du travail de l’intensification du travail. La seconde notion est toxique car elle représente un accroissement de charges (quantité de tâches, stress, rythmes de production…). L’intensité du travail représente la charge positive que le salarié investit dans son action : satisfaction d’atteindre ses objectifs, gratification du résultat obtenu, jugement positif (par lui, ses pairs et sa hiérarchie) sur ce qu’il fait, perception claire et partagée du sens de ce qu’il fait. Clot nous dit que « Ce genre de travail est intense, à la fois psychologiquement et socialement. » Il n’est pas dangereux pour la santé car « Il produit une “bonne fatigue”, dont on récupère facilement. »
Cette orientation impose deux conditions incontournables :
- Donner aux salariés les moyens des ambitions de l’organisation ;
- Donner aux organisations les moyens des ambitions de ses salariés.
Performance et bienveillance supposent donc de nous affranchir d’une évaluation quantitative du travail réalisé au profit d’une évaluation résolument qualitative.
Sécurité au travail
Cette évaluation qualitative, appliquée aux conditions de travail nous amène naturellement à la question du « bien-être » au travail. La qualité de vie au travail (QVT) est un terme à la mode. Il me semble être étroitement lié au concept de travail bien fait d’Yves Clot. La sécurité au travail, condition nécessaire pour être bienveillant et performant, suppose cette double dimension du « bien faire » et du « bien vivre ». Il s’agit tout simplement de vivre à la bonne heure – bonheur. « Être“à la bonne heure”, c’est donc d’abord vivre intensément le présent » déclare Patrick Viveret[9].
Qu’est-ce qui permet à un professionnel de vivre intensément la mission qui lui est confiée ? Bien entendu, cette question convoque le registre des motivations personnelles. Mais peut-on être travailleur social sans avoir, a priori, une volonté d’ouverture aux autres et d’agir sur les situations sociales problématiques ? Je voudrais dépasser ce niveau qui regarde chacun personnellement pour m’intéresser aux conditions organisationnelles de la motivation individuelle. Pour être bref, je retiendrais deux conditions :
- Garantir des espaces de travail : L’intensité du travail suppose des lieux où investir. La contrainte n’est pas un facteur de mobilisation. L’organisation d’espaces d’action doit chercher à promouvoir l’autonomie relative maximale des acteurs. Autonomie : c’est la possibilité de disposer de marges de manœuvre suffisantes pour agir. Relative : c’est ne pas ignorer les interdépendances nécessaires à toute organisation de travail. Maximale : c’est la volonté de maximiser les capacités d’agir selon un principe de subsidiarité (décider au plus proche de l’endroit où se déroule l’action).
- Sécuriser les nécessaires prises de risques : Il ne peut y avoir d’investissement professionnel fort si toutes les actions sont délimitées par des descriptions trop étroites de tâches à accomplir (c’est le principe fordiste de l’organisation du travail par un découpage déresponsabilisant des gestes à faire). Cela suppose donc d’autoriser la prise de risque et que celle-ci n’expose pas le professionnel à titre individuel. Toute prise de risque doit rester une affaire collective portée par l’institution (il, ne s’agit donc pas d’initiatives personnelles non régulées par l’organisation).
- L’organisation : un système finalisé
Nous en arrivons donc logiquement à des questions d’organisation qui conditionnent les principes de bienveillance et de performance tels que nous commençons à les cerner.
« Digérer » la mission
Nous avons vu le rôle essentiel que joue la qualité du projet d’établissement ou de service. Celui-ci doit se traduire en termes organisationnels dans un souci de cohérence. L’organisation concrète est le continuum opérationnel du projet. L’organisation « métabolise » la mission qui est confiée à l’établissement ou le service social ou médico-social en la passant au crible de ses valeurs formulées dans le projet.
Donc, l’organisation ne peut être seulement sous injonction. Elle doit disposer d’une marge de manœuvre qui doit lui être laissée par les pouvoirs publics (autorités chargées de l’autorisation, du contrôle et de la tarification). Cette marge de manœuvre n’est pas garantie a priori. Les temps présents tendent même plutôt à la réduire ou même à l’ignorer. L’organisation de travail social doit conquérir ses marges de manœuvre et les défendre. C’est là une première condition permettant aux professionnels de mettre en œuvre à leur niveau bienveillance et bientraitance.
Ouvrir des débats sur le bien commun
Nous l’avons déjà évoqué : si le projet est un bien commun, il doit être largement débattu entre toutes les parties prenantes.
Nous l’avons également abordé : les pratiques professionnelles ont un impérieux besoin de se dire, de se confronter, de se travailler. Les groupes de paroles entre professionnels, les comités éthique, les commissions de déontologie, les groupes d’analyse de pratique sont des outils indispensables au service de la bienveillance et de la performance.
Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette contribution.
Oser la créativité et l’innovation
Pour terminer ce paragraphe sur la manière d’associer bienveillance et performance en travail social, nous devons insister sur la nécessité de faire du neuf, de développer des pratiques inédites, en un mot, d’innover.
Nous avons vu, au fil de cet exposé, l’importance de s’affranchir d’une conception moralisante de la bienveillance tout autant que d’une conception normalisante de la performance. Pour ce faire, les organisations de travail doivent permettre aux acteurs de sortir des sentiers battus. Elles doivent se penser dans cette tension entre la nécessité de créer et garantir des cadres de travail et cette autre nécessité de permettre souplesse et adaptation.
Finalement, une organisation visant la bienveillance et la performance doit ouvrir de nouvelles voies pour l’action. Ce n’est pas dans les vieilles outres que l’on fait du vin nouveau. Les défis de ce temps ne convoquent pas des vieilles méthodes ni des pratiques codifiées et figées. Ils réclament la créativité.
Conclusion : Comment réinterpréter performance et bienveillance
Le tableau ci-dessous résume brièvement l’ensemble des idées développées jusque-là. Il tente de mettre en lumière les clivages qui existent dans les interprétations des concepts de bienveillance et de performance. À chaque affirmation d’une traduction conforme aux références du travail social correspond, en italique une conception normative du même item qui semble éloignée des visées du travail avec et pour autrui (au moins de celles que je défends).
| Attributs de la performance | Attributs de la bienveillance |
| A contrario de | A contrario de |
| Respecter les droits fondamentaux des sujets | Formaliser et garantir des repères éthiques et déontologiques |
| Le résultat plutôt que le chemin parcouru | L’efficacité immédiate plutôt que le temps du compagnonnage |
| Faciliter l’inclusion sociale des personnes | Élargir la compréhension par le croisement des savoirs et des cultures |
| Discipliner plutôt qu’émanciper | Imposer la police de la culture dominante |
| Développer la participation des usagers | Co-construire l’action avec les intéressés |
| Transférer le poids de l’action sur l’individu | Décider à la place de l’autre |
| Accroître le pouvoir d’agir des acteurs | Amplifier les solidarités |
| Chacun doit trouver sa solution | Chacun doit gérer ses problèmes |
| Promouvoir la citoyenneté de chacun | Être responsables ensemble |
| Laisser s’instaurer des régimes différents de solidarité | Individualiser les réponses et les solutions |
En conclusion, force est de constater que bienveillance et performance sont des termes qui ouvrent des controverses.
Ce sera l’objet de la seconde partie de cette communication que d’ouvrir des pistes d’action permettant de traiter cette conflictualité inévitable… et peut-être même souhaitable.
[1] « Comment le bien-être des salariés génère de la rentabilité », 18/07/2017 sur http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/07/16331-bien-etre-salaries-genere-de-rentabilite/ consulté en novembre 2020
[2] Article 21 de la déclaration des droits de l’Homme de la constitution du 24 juin 1793 : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. »
[3] https://www.cnrtl.fr/definition/performance#:~:text=Ensemble%20des%20r%C3%A9sultats%20obtenus%20par,succ%C3%A8s%20remport%C3%A9%20dans%20une%20course.
[4] Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.
[5] Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées.
[6] https://www.anap.fr/l-anap/qui-sommes-nous/#undefined_c6014.
[7] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, coll. Pocket Agora, Paris, 1983.
[8] Yves Clot, L’aspiration au travail bien fait, in Le journal de l’école de Paris du management 2013/1 (N° 99), pages 23 à 28.
[9] Patrick Viveret, Pourquoi ça ne va pas plus mal ? Fayard, 2005.
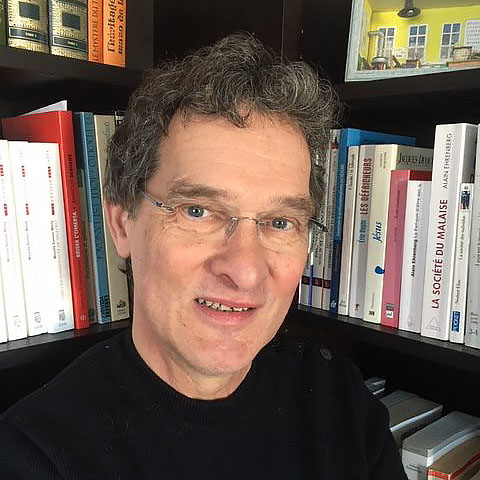
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.



