Préambule :
Ego : « L’établissement que je dirige est une maison d’enfants à caractère social (MECS) relevant du 1°) de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, autorisé par arrêté du Président du Conseil Départemental à accueillir 54 mineurs, garçons et filles, de 6 à 18 ans avec la possibilité dérogatoire d’accompagner certains jusqu’à 21 ans. Le budget global est de 5,2 millions d’euros versés par le Département au titre de l’Aide sociale à l’enfance. 21 travailleurs sociaux – éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, accompagnant éducatif et social ou en attente de formation – encadrent trois groupes de vie organisés par tranches âge. L’équipe de direction est composée d’un directeur, de deux chefs de service et d’une psychologue. L’équipe administrative est gérée par un économe qui est assisté d’une comptable et d’une secrétaire qui est également secrétaire de direction. Le bâtiment de cette MECS est relativement récent, situé sur trois niveaux, il distribue l’ensemble des locaux de vie et les espaces administratifs et techniques. L’établissement appartient à l’association X. qui gère, par ailleurs, des établissements médico-sociaux et un gros service d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). »
Exo : « La maison d’enfants où je travaille est située dans un quartier populaire de Z. donc assez proche des lieux d’origine des jeunes que nous accueillons. Sa construction ne la distingue pas des immeubles voisins, ce qui banalise un peu sa présence à proximité des écoles et des commerces. Cette situation est un atout qui permet aux jeunes de se rendre aux activités proposées dans l’environnement : il y a notamment un club de foot qui remporte un gros succès mais la médiathèque est également très prisée. Les jeunes accueillis sont tous scolarisés dans les écoles voisines, primaires, collège et lycée et un travail de proximité est engagé depuis de nombreuses années avec les équipes enseignantes ce qui participe à la bonne intégration de la maison. Les jeunes les plus autonomes se rendent seuls à leur établissement scolaire. Il n’est pas rare qu’ils soient invités chez des copains ou des copines. Nous-mêmes, quand nous organisons des anniversaires invitons les jeunes du quartier qui, maintenant, viennent sans appréhension parce qu’ils nous connaissent. Il faut dire que notre kermesse annuelle remporte toujours un grand succès : les parents des jeunes viennent mais aussi les habitants du quartier. La fête des voisins est un temps fort de la vie de l’établissement. Quand un de nos jeunes crée un problème (dégradation de l’espace public, comportement agressif…), il y a toujours un voisin pour venir nous prévenir… Finalement, le travail éducatif que nous conduisons auprès de ces jeunes qui nous sont confiés pour leur protection, est grandement facilité par la bonne intégration de la maison d’enfants dans son environnement. »
Ego et Exo décrivent le même établissement, c’est bien la même réalité qui est dite ici avec des mots différents. La seule différence entre ces deux discours, c’est le point d’observation où se situe chacun des narrateurs. C’est cela que voudrait démontrer cet article : la manière de décrire une organisation configure de façon significative sa forme, ce qui a des effets directs sur son propre fonctionnement.
______________
Introduction :
Décrire c’est mettre en forme. Ego expose les aspects solides et tangibles de l’établissement qu’il dirige alors qu’Exo évoque des aspects plus relationnels, plus fluides du fonctionnement de ce même établissement. Aucun des deux n’a raison ou tort, il s’agit seulement de deux points de vue. Cependant, le point de vue d’où l’on parle pour décrire une organisation a des effets modélisateurs sur celle-ci parce que ce ne sont pas les mêmes dimensions qui sont mises en valeur. Selon les éléments placés en premier plan, le tableau prend une signification différente. Appliqué à l’analyse organisationnelle, cette différence produit des effets.
Nous montrerons qu’une vision centralisatrice de l’organisation, inspirée par un positivisme tendant à tout rationaliser, organise les places et les rôles, les relations et les rapports hiérarchiques, les coopérations et le rapport à l’environnement d’une manière particulière, essentiellement marquée par une pensée clivée, binaire.
A l’inverse, une observation attentive de l’organisation en s’intéressant prioritairement non à son centre mais à ses périphéries, aux seuils, produit une toute autre image. C’est la pensée complexe qui vient alors soutenir cet angle d’analyse, permettant de dévoiler des éléments peu visibles, cachés ou impensés, de l’organisation et pourtant puissamment structurants. La perspective de développement durable des associations d’action sociale passe peut-être par le choix de cette vision des organisations par leurs seuils.
Nous conclurons que cette approche particulière, à contrecourant de la pensée managériale dominante, est particulièrement adéquate pour les organisations de l’action sociale car plus sensible à la question humaine qui occupe tous les espaces d’action.
1. Quand décrire c’est mettre en forme
Les discours sur les choses sont tout sauf neutres. Un discours ne nait pas spontanément mais représente la mise en lumière des nombreux présupposés qui le génèrent, lui donnent forme et sens. Les prénotions – c’est-à-dire ces conceptions héritées de notre histoire et de notre culture – connotent la manière de décrire, la façon de dire. La position du narrateur influence son propos et le contexte dans lequel se développe le discours modifie sa forme et son fond.
De plus, toute description de ce que nous nommons le « réel » – ce qui présuppose déjà qu’une réalité objective et pure existerait en elle-même – transite nécessairement par le filtre de celui qui parle : Peut-il exister un réel indépendamment de celui qui le décrit ? Il y a donc un effet modélisateur de toute description. Autrement dit, la manière dont on décrit un objet – à entendre ici de manière très large : chose, personne, organisation, configuration technique ou sociale, dispositif… – lui donne forme, c’est le sens du terme in-former.
Cette règle de formation du discours et des effets de discours vaut pour l’analyse des organisations. Décrire une organisation de travail revient à lui donner forme à partir d’un certain nombre de conditions dont nous n’avons pas toujours conscience. Les différentes sciences s’intéressant à l’analyse des organisations contribuent à modéliser celles-ci. Les sciences de gestion, les théories du management, les sciences économiques dominent en ce domaine. Elles tendent, dans la majorité de leurs productions savantes, à définir les organisations de travail à partir d’une vision centralisée. Se développe ainsi dans les analyses une conception des organisations que nous nommerons égocentrée.
Il faut ici établir un lien entre cette conception égocentrée des organisations et le courant positiviste qui lui confère sa légitimité scientifique. Le positivisme a marqué l’évolution des sciences dans l’effort de l’humanité à toujours mieux comprendre son environnement dans toutes ses dimensions. Fortement inspiré par les sciences physiques et les sciences de la matière, le positivisme repose sur l’idée que tous les phénomènes peuvent être classés selon des liens logiques et permettant d’opérer des déductions des uns aux autres. Se créent ainsi des chaînes de causalités qui relient les effets à des causes en postulant que les mêmes causes produites dans les mêmes conditions produiront les mêmes effets. L’approche positiviste va alors s’intéresser à identifier les causes initiales, l’origine de tout. Par ailleurs, elle tentera une classification méthodique des sciences – c’est la classification opérée par Auguste Comte – dans laquelle la physique occupe une place essentielle. C’est une conception du monde qui se révèle au travers de ce courant scientifique et qui dévoile une hiérarchie des éléments et des phénomènes, la primauté de certaines instances sur d’autres, des ordres de priorités, un ordre du monde et, dans le même mouvement, une conception centralisée des dispositifs biologiques, physiologiques, mécaniques, techniques, sociaux ou organisationnels.
Mais il existe d’autres épistémologies. En effet, le positivisme s’est heurté à des impasses ou, plus précisément, n’a pas pu intégrer à sa conception globale d’une explication du monde des phénomènes de ruptures qui remettent en cause la continuité des liens de causalité, les émergences chaotiques qui bousculent l’ordre logique, les éléments cachés, impensés ou inexplicables qui interrogent la volonté de tout démontrer. C’est en prenant en compte ces déviances d’un agencement supposé cohérent que des chercheurs ont ouvert la voie de l’épistémologie dite systémique. L’idée est simple : quand plusieurs éléments sont mis en présence, ils ne s’organisent pas seulement entre eux selon des liens de cause à effet, ou selon une logique dictée par un ordre supérieur, mais par un enchevêtrement d’interactions des uns sur les autres selon des liaisons complexes et multiples. Le système est un espace où se jouent des relations plurielles et multiformes. Finalement, plutôt que de tenter de comprendre chaque élément de l’ensemble pour comprendre le tout – en les isolant les uns des autres en unités plus aisément compréhensibles comme nous y invite l’approche positiviste – il s’agit de mettre à jour et de comprendre les interactions entre les éléments du système et, ce faisant, de comprendre chacun d’eux et ses qualités propres à travers les liens qu’il entretient avec les autres.
L’approche systémique fut une révolution scientifique car elle inversait le sens des analyses et ouvrait des perspectives nouvelles d’investigation qui irrigueront tant les sciences dites dures (physique, chimie, mathématiques…) que les sciences humaines et sociales.
De l’approche systémique va découler une nouvelle conception de l’observation qui va bousculer le rapport au réel. Devant la complexité des phénomènes ainsi mise à jour, il apparaît qu’il n’y a pas de connaissance objective puisque le sujet observateur est pris lui-même dans le jeu systémique. Le fait d’observer interagit avec l’objet regardé. Conclusion : il n’y a de connaissance qu’à travers un sujet connaissant. Le réel n’est donc pas accessible en tant qu’objet pur, il ne nous est perceptible que par nos interactions avec notre environnement. C’est le poème de l’espagnol Antonio Machado qui résume le mieux cette approche dite constructiviste : « Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant.[1] »
Cette alternative scientifique ouverte par la systémie et le constructivisme nous permet d’entrevoir qu’il existe peut-être d’autres manières d’analyser les organisations de travail. Nous pouvons ainsi compléter l’approche autocentrée ou égocentrée par une vision exocentrée des organisations. C’est-à-dire, plutôt que les analyser avec des principes de centralité, nous allons nous placer sur les périphéries pour les observer, nous allons les regarder par leurs seuils pour voir ce que ce décalage peut produire ou modifier dans notre compréhension de celles-ci.
2. Une critique d’une conception erronée du pouvoir
L’étude attentive des ouvrages qui font référence en matière de management attestent, dans la plupart des cas, que le pouvoir reste relativement impensé, ou, dans le moins pire des cas, mal pensé. Il faut dire que les héritages sont lourds en ce domaine. Les religions dotent la (les) divinité(s) d’un pouvoir sans faille sur les hommes. Dans la Bible, Dieu donne tout pouvoir à l’homme sur la nature afin qu’il la domine. Machiavel, dans sa compréhension populaire, associe le pouvoir à des ruses parfois peu soucieuses de morale, pour assoir l’autorité du Prince. Les théories classiques du management donnent aux différentes stratégies la même finalité d’assurer un contrôle le plus complet possible sur les comportements des subordonnés. Le socle de tous ces sédiments qui alimentent les conceptions habituelles du pouvoir, postule que le pouvoir est une chose, qu’il se possède, qu’il se transmet, s’entretient ou se perd. L’objet-pouvoir, dans une vision égocentrée de l’organisation, se situe en son centre, en haut de la pyramide hiérarchique.
Comme pour l’épistémologie, cette conception du pouvoir a été interrogée par des approches qui envisagent qu’il ne s’agit pas d’un élément substantiel mais d’un rapport. Des philosophes et des sociologues vont particulièrement s’intéresser aux rapports de pouvoir en les considérant comme des rapports de forces. Le pouvoir ne se situe alors plus en un point précis de l’organisation de travail mais comme un actif circulant qui régit les échanges et les liens. Le pouvoir se situe autant du côté du dominant qui impose ses vues que du dominé qui les accepte ou les subit.
Alors que dans une vision autocentrée le pouvoir, manifesté par ses attributs (le bureau directorial, le costume, la voiture de fonction…) est localisé au centre, dans une vision exocentrée, le pouvoir conçu comme un rapport social, circule dans l’ensemble du système et caractérise une partie des interactions des éléments de celui-ci.
Mais il nous faut mesurer l’effort que demande le passage d’une vision égocentrée de l’organisation à une observation par ses seuils. Nous héritons de l’ancien régime. Le roi tenait sa légitimité de droit divin, c’est-à-dire d’une transcendance qui échappe à tout contrôle, absolutisant la conception du pouvoir. Les révolutionnaires français du XVIIIème siècle ont décapité le monarque sans pour autant mettre fin à une conception centralisée du pouvoir : ce fut le combat des girondins contre les jacobins, remporté par ces derniers. La France est restée marquée par cette conception centralisatrice du pouvoir, même si aujourd’hui elle affirme dans sa constitution être une république décentralisée.
L’hégémonie des modèles centralisés domine et il reste difficile de penser des alternatives. Tout a tendance à être décrypté selon un rapport entre centre et périphérie.
Cet atavisme de la pensée nous révèle une vision binaire des choses. La pensée binaire est héritée du positivisme qui clive scientifiquement le vrai et le faux, d’une culture judéo-chrétienne qui sépare le bien du mal, du règne du numérique qui organise le monde en 0 ou 1.
Ainsi, au plan des organisations, toute position s’analyse entre dedans et dehors. Cette conception alimente le tropisme centralisateur et évacue les zones intermédiaires, les espaces de liminalité qui bordent les organisations mais qu’il est parfois délicat de discerner si nous n’avons pas les bonnes lunettes de lecture pour les percevoir.
3. Les tropismes de la vision autocentrée
L’égocentrisme organisationnel comporte quelques caractéristiques qui résultent d’une analyse trop monolithique de l’organisation de travail.
Le rapport centre / périphérie tend à occulter d’autres dimensions qui pourraient exister, les forces structurantes de l’organisation ne sont alors envisagées que selon deux directions : centrifuges et centripètes. Selon une autre explication, introduisant une troisième dimension spatiale à la représentation, les échanges sont limités à aller du haut vers le bas et du bas vers le haut de la pyramide. Ces axes de forces cachent tous les autres : les liens horizontaux, transversaux, latéraux, longitudinaux… A minima, ils souffrent de ne pas être reconnus comme des éléments essentiels de l’organisation et sont peu analysés.
L’analyse de l’organisation par son centre, là où se situerait le pouvoir, tend à en faire un pôle d’attraction des forces vives de l’organisation. Le centre attire à lui les informations, les compétences et plus largement toutes les ressources. A l’inverse, c’est de lui que proviennent les décisions, les normes et les consignes et plus largement toutes les mises en forme de l’organisation. Nous avions déjà montré[2] que le tropisme centraliste tend à transformer le centre de l’organisation en un véritable trou noir. En astronomie, un trou noir est un objet céleste dont la densité, incroyablement élevée, empêche les matières qui le composent et tout rayonnement de s’en échapper. Causé par l’effondrement gravitationnel d’une étoile en fin de vie, il naît d’une concentration gigantesque d’énergies et de matières. Le centre de l’organisation tend ainsi à absorber les énergies structurantes qui la traversent, agglomérant tous les éléments du dispositif.
Pour illustrer cela, une direction générale qui regroupe en son siège les comptables qui étaient auparavant situés dans les établissements fonctionne à l’égard de ces derniers comme un trou noir, un absorbeur des énergies et des compétences des éléments du système.
La vision centralisatrice induit une autre difficulté concernant les densités organisationnelles de l’organisation. Si nous l’observons par son centre, nous avons tendance à concevoir que c’est là que se trouve la densité maximale de l’organisation. Ainsi, plus nous irons vers les espaces périphériques, plus nous aurons le sentiment que la densité est plus faible. La densité serait ainsi inversement proportionnelle à la distance qui sépare l’élément du centre. Plutôt que de nous permettre de concevoir les densités organisationnelles dans leur pluralité, la vision égocentrée nous conduit à n’observer que le rapport de loyauté qui lie le centre aux éléments de pourtour. Ainsi, un soupçon peut naître du centre vers les éléments périphériques concernant leur loyauté. Car s’ils sont perçus comme éloignés, la question se pose de ce lien supposé plus distendu, moins ferme et moins fiable. Une énergie va alors être dépensée par le centre pour tenter de garder la maîtrise de l’élément distant. Dans les entreprises, c’est ce que nous connaissons par les tableaux de reporting, les redditions de comptes chronophages, la prolifération de normes et de procédures dont les seules qualités sont de rassurer le centre sur la loyauté des périphéries.
En conséquence de cette dérive, la vision centralisée tend à développer un rapport particulier à l’environnement. En effet, si les éléments périphériques ne sont pas identifiés comme disposant d’une densité qui leur est propre, un doute va s’immiscer sur les délimitations de l’organisation. La notion d’appartenance se brouille et les frontières s’estompent. Il faut alors bâtir des limites qui clarifient l’appartenance sur le mode binaire : dedans ou dehors. La frontière qui est naturellement un espace d’échanges tend alors à s’ériger comme un mur dont le franchissement est difficile.
Puis, progressivement, cet effort à cadrer les appartenances, va générer un environnement de plus en plus menaçant car il est le lieu où pourrait se diluer l’identité de l’organisation, voire l’organisation elle-même, ce tropisme étant renforcé par les jeux de concurrence entre organisations sur un même territoire. De là à développer un rapport paranoïaque avec l’environnement il n’y a qu’un pas.
Se protéger de l’environnement et des concurrences néfastes qui s’y jouent, oblige l’organisation à être la plus pointue possible sur les compétences qui justifient son existence. Sa survie est au prix d’une hyperspécialisation qui lui permet de résister à cet environnement perçu comme hostile, voire toxique.
Le meilleur moyen de résister, c’est d’atteindre une masse critique qui permet de faire le poids par rapport aux autres. Par des jeux de fusion absorption, l’organisation autocentrée va avoir tendance à s’hypertrophier confondant alors développement et grossissement.
C’est ainsi que la vision égocentrée justifie l’embonpoint d’organisations paranoïaques, hyperspécialisées, à la densité organisationnelle concentrée en leur centre qui fragilise leurs autres éléments.
C’est bien la manière dont sont regardées les organisations qui configure la représentation que s’en font les acteurs. Si l’organisation est perçue comme fragile parce qu’elle ne correspond pas aux canons descriptifs et à leurs normes sous-jacentes, elle devient fragile dans l’esprit de ses responsables. Ceux-ci vont alors partir à la conquête de nouveaux marchés ou renforcer les procédures de contrôle sur leurs services, muscler les compétences de leur direction ou recentrer leurs actions sur les champs qu’ils maîtrisent le mieux au détriment des autres compétences qu’ils auraient pu conserver.
A terme, ce mouvement, fortement influencé par le regard porté sur l’organisation, induit une vision très technologique de celle-ci. Technologique signifie que seuls sont pris en compte les éléments solides et tangibles de l’organisation, laissant dans l’ombre les zones grises, les interstices, les espaces mal définis, les liens peu visibles, les signaux faibles, tous ces petits faits qui, en-deçà des niveaux de visibilité classiques, n’en sont pas moins des éléments fortement structurant de l’organisation. Le processus tend à refermer l’analyse sur le noyau dur de l’organisation, renforçant les procédures autoritaires, les recommandations de pratiques établies solidement et indiscutablement, bref, l’approche technologique qui peut très vite se dégrader dans ces deux formes de la pathologie la plus répandue des organisations que sont la bureaucratie et la technocratie.
4. Pour construire une alternative à l’analyse des organisations : prendre en compte la complexité
C’est Edgar Morin qui a, le plus précisément, conceptualisé ce qu’il nomme la pensée complexe. Cette épistémologie, fortement inspirée du constructivisme et de la systémie, se présente comme une alternative à ce que Morin nomme le paradigme de la pensée simplifiante. L’intuition est que les phénomènes ne peuvent être réduits dans leur compréhension sans souffrir une réduction qui ne permet plus de les percevoir dans leur totalité. Toute tentative d’explication simple ampute ce dont on parle. Morin propose à l’inverse d’intégrer toute la complexité des phénomènes aux efforts d’analyse que nous faisons, c’est-à-dire d’ajouter de la complexité pour éviter tout réductionnisme. Il faut, pour cela, bien distinguer ce qui est compliqué de ce qui est complexe. Une explication compliquée d’un phénomène complexe demande à être simplifiée mais elle doit rester complexe. Autrement dit, ce qui est compliqué doit être simplifié mais ce qui est complexe doit être complexifié.
« La méthode[3] » exposée par Morin repose, pour faire bref, sur trois concepts qui éclairent ce que peut être une analyse alternative des organisations : la dialogique, la récursivité organisatrice et le principe hologrammatique.
La dialogique peut se résumer en ce slogan : tout est dans tout et réciproquement. Les faits ne sont jamais purs mais toujours le résultat d’éléments contraires qui se combinent entre eux. Pour comprendre cette idée, il suffit de prendre l’exemple du rapport entre la vie et la mort. Sans la mort, la vie n’existerait pas en tant que telle, ce qui lui donne sa consistance, c’est l’existence de la mort. De même, la mort n’existe que par la vie. La vie est dans la mort comme la mort est dans la vie, impossible de les séparer. Ces deux termes entretiennent un rapport dialogique de l’un envers l’autre. La conséquence de ce principe pour l’analyse des organisations est qu’aucun élément ne peut être observé indépendamment des autres et même, ils sont contenus les uns dans les autres.
Par exemple, le rapport entre technique et politique qui prévaut dans l’organisation des associations ne peut se contenter de les envisager comme deux éléments dissociés. Il est fréquent d’affirmer que le politique appartient aux seuls administrateurs et le technique est la prérogative des seuls professionnels. En réalité, ils sont inscrits dans un rapport dialogique, ils sont constitutifs l’un de l’autre, inscrits dans une forme de consubstantialité. Le politique agit sur le technique qui, sinon, serait une coquille vide. Mais le technique, par un effet retour, influence les visées politiques de l’organisme gestionnaire. Nous percevons alors que, sur ces bases, l’analyse ne peut être de même nature que selon une simple logique bureaucratique…
La récursivité organisatrice concerne plutôt les liens entre les éléments d’un système. Ils se trouvent inscrit dans une boucle où chaque élément agit sur les autres qui, eux-mêmes agissent sur lui. Le principe cybernétique qui prévaut ici est que tout élément est inscrit dans un processus d’organisation qui passe également par des phases de désorganisation avant de se réorganiser autrement. Ce processus est déterminé par l’environnement de l’élément considéré. Ce principe remet en cause l’idée de progression linéaire. Toute évolution, tout changement, toute transformation connait des ruptures, des discontinuités, des aléas qui empêchent le phénomène de se dérouler selon une continuité logique. Des incidents viennent briser cette vue théorique des choses. Ainsi, les évènements et les faits connaissent en permanence la boucle rétroactive : formation => déformation => transformation => reformation=> etc. Cette boucle rétroactive est organisatrice en ce sens que le rapport entre ordre et désordre qui prévaut donne forme à l’organisation.
Par exemple, dans cette maison d’enfants à caractère social, le service pour adolescents qui avait été construit il y a quelques années pour répondre au vieillissement des enfants accueillis [formation], après une phase de stabilité est entré en crise [déformation], obligeant l’équipe à penser un nouveau projet [transformation] qui a abouti à l’externalisation du service dans une maison louée dans la ville proche [reformation].
Le principe hologrammatique tient son nom de l’hologramme, méthode d’imagerie en trois dimensions rendue célèbre lors d’une campagne présidentielle où un candidat a tenu un meeting en deux endroits en même temps grâce à son hologramme. La représentation classique d’une image à plat ordonne ses pixels en abscisse et en ordonnée, chaque point se situant par rapport à ses voisins immédiats. La particularité de la représentation d’une image en trois dimensions c’est que chaque point doit connaître la position de tous les autres, seul moyen de les situer dans l’espace. Dans un hologramme, l’ensemble connaît chacun des éléments qui le composent et chaque élément connaît l’ensemble. Ce principe, appliqué à la pensée complexe ouvre l’analyse selon une véritable perspective systémique qui prend en compte toutes les interactions du système selon l’idée que le tout est contenu dans chaque des parties qui, elles-mêmes, contiennent le tout.
Par exemple, dans un établissement social ou médico-social, chacun des membres de l’équipe porte en lui toutes les interactions professionnelles qui traversent les différentes dimensions de l’organisation, même celles qui ne le concernent pas directement mais dont il dépend pour une part, par exemple il y a des liens d’interdépendance entre l’équipe d’un service éducatif et la cuisine. Mais aussi, l’établissement contient l’ensemble des acteurs, porte chacun de ses membres. Ce qui fait cohérence c’est cette double dimension individuelle et d’ensemble. Les établissements en difficulté sont ceux pour lesquels ce principe hologrammatique est perturbé : quand un pixel se dédouane de sa responsabilité à connaître et reconnaître l’ensemble des autres points.
Cette entrée par les seuils pour comprendre les organisations, en empruntant les concepts de la pensée complexe, enrichit les points de vue. Quittant des liens mécaniques de cause à effet pour s’ouvrir à la richesse d’interactions indéterminées, l’analyse s’ouvre aux phénomènes de transduction[4], c’est-à-dire à cette dynamique des processus de changement qui transforment les organisations. La transduction, c’est la contamination d’une modification d’une structure aux autres structures les plus proches. Pour comprendre cela, il faut prendre un exemple en chimie. L’introduction d’un germe cristallin dans une solution saturée de soufre va provoquer, de proche en proche, la cristallisation de l’ensemble de la solution. Nous pourrions dire que ce phénomène mobilise les trois principes exposés ici (dialogique, récursivité, hologramme). Plutôt que rechercher une cause ou l’origine d’un phénomène organisationnel, il est plus instructif d’identifier ce qui a joué le rôle de germe structural qui force la structure à muter.
Par exemple, dans un service d’investigation judiciaire (enquêtes sociales, mesures judiciaires d’investigation éducative), une psychologue a introduit avec un travailleur social volontaire une expérience de lecture intégrale du rapport en amont de l’audience chez le juge. Les effets positifs produits par cette pratique ont incité les autres collègues à généraliser cette manière de faire.
Contrairement à une idée reçue, les cadres fonctionnels et normatifs ne sont jamais fixes et totalement clairs. La pensée complexe nous permet de mieux percevoir cela. Les systèmes d’action, particulièrement dépendants des normes de droit dans le secteur social et médico-social, ne sont pas uniquement un ensemble cohérent et objectif d’éléments structurés et clairement délimités. Ils se construisent selon une combinaison complexe de compromis, de ruses, d’ajustements, de petits arrangements entre acteurs. Ce n’est pas la force de la loi qui fait les organisations mais, comme l’indique Mireille Delmas-Marty, « les forces imaginantes du droit[5] ». Dans le domaine des règles de fonctionnement d’une organisation, c’est l’interaction qui est structurante, pas une loi transcendante qui s’imposerait de l’extérieur. Bien sûr, il existe bien un cadre réglementaire qui structure les activités de l’organisation et auquel il n’est pas question de déroger. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est la manière dont ces références sont traduites dans leur application locale à l’échelle de l’organisation et de ses acteurs. En ce domaine, nous sommes toujours, pour prendre une autre formule de Delmas-Marty, dans un « pluralisme ordonné ». Finalement, l’organisation vue ainsi, ressemble à un nuage, c’est-à-dire à un ensemble capable de se former et de changer de forme d’évoluer et même de disparaître au gré des forces (vents, courants, humidité…) qui le traversent.
Aborder les établissements et services sociaux et médico-sociaux par cette analogie du nuage change profondément la manière de les voir alors que nous avons tendance à les présenter par le dur (volumes, quantités, stocks).
Maintenant que nous nous sommes donné quelques repères conceptuels pour imaginer une autre analyse des organisations, nous pouvons tenter de les appliquer à une approche par les seuils.
5. Entrer par les seuils, une inscription environnementale durable
Aborder une organisation par ses seuils induit, d’emblée, la question écologique, c’est-à-dire le rapport qu’elle entretient avec son environnement. Les sciences de gestion nous ont habitué à lire ce rapport selon un principe de survie : l’organisation chercherait spontanément à assurer sa pérennité et pour cela elle doit identifier les éléments de contexte qu’elle doit s’approprier pour s’alimenter et éliminer ses prédateurs ou, au moins, s’en protéger.
La pensée complexe peut nous ouvrir à une autre façon d’envisager le rapport écologique qui, ici, s’oppose au tropisme technologique évoqué plus haut. L’environnement n’est pas d’abord une ressource à consommer pour la survie de l’organisation mais un espace d’échanges selon un principe de don et contre-don tel que l’a observé Marcel Mauss. L’équilibre écosystémique consiste à apporter à l’environnement ce dont il a besoin et, en retour, recevoir de lui ce dont l’organisation a besoin. Dans cet échange, l’équilibre repose sur l’intérêt réciproque des parties : pour l’organisation disposer d’un environnement pérenne qui assure sa survie, pour l’environnement recevoir les apports enrichissants de l’organisation.
Ce principe semble particulièrement adapté à la compréhension de l’inscription territoriale des organisations du travail social. Immergées dans ce jeu de don et contre-don entre elles et leur contexte d’action, elles enrichissent l’environnement par leur travail sur les dysfonctionnements sociaux et, conscientes de leurs interdépendances, se laissent enrichir par lui. Ce mode de compréhension nous prémunit de ces discours guerriers qui envisagent le territoire comme une ressource à consommer. C’est ainsi que des associations se développent par l’extension sans limite de leur zone d’action, ne liant plus leur propre destin à celui des lieux où elles agissent, au risque de devenir des firmes apatrides.
Cette perception d’un écosystème des organisations dans leur environnement dévoile une autre dimension d’analyse. Les éléments qui cohabitent dans l’environnement s’inscrivent dans une interdépendance. Pour le comprendre, il suffit de regarder comment vit une parcelle en permaculture et d’observer la façon dont les végétaux se protègent et s’enrichissent les uns des autres : les plantes qui ont besoin de soleil abritent celles qui ont besoin d’ombre. Ce principe de complémentarité, nous pourrions le nommer altérité : les manques des uns sont comblés par les autres et réciproquement.
Ce principe de complémentarité fondé sur la conscience que les êtres et les organisations sont irrémédiablement marqués par le manque est très pertinent pour les associations d’action sociale. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, a introduit un article L313-1-1 dans le Code de l’Action Sociale et des Familles qui généralise le principe de la concurrence par le dispositif des appels à projets. Ce procédé est parfaitement antinomique avec ce principe de complémentarité et de manque. Il incite les associations à se battre entre elles pour survivre, même si, dans une version civilisée, cela peut se passer de manière douce et feutrée. De plus, il incite également les associations à être le plus autosuffisantes possible. Ces dispositions, empruntées aux règles du marché capitaliste libéral, sont extrêmement toxiques pour l’équilibre écosystémique des territoires.
C’est l’inverse qu’il faudrait faire pour garantir un maillage local des acteurs de solidarité dans les territoires. Ceux-ci pourraient ainsi devenir des espaces de renforcement réciproque des intervenants par ce jeu subtile, à l’image de la permaculture, des complémentarités et étayages des uns par les autres. Bref, il s’agirait de faire vivre entre les associations la solidarité qu’elles promeuvent à l’égard de leurs usagers. Leur survie ne serait plus envisagée de manière individualiste mais comme le fruit d’interdépendances assumées, et même, développées.
Nous percevons ici qu’une analyse par les seuils ouvre le regard sur d’autres perspectives, en contrepoint de la pensée dominante. La conception égocentrée des organisations focalise le regard sur le destin individuel et masque le fait que les destins des organisations sont, par nature, collectifs.
Pour compléter, nous pouvons dire que l’art de faire ensemble repose sur une manière adéquate de cogérer les communs. Par commun, nous entendons des ressources limitées mais nécessaires à une communauté et dont le bon usage doit profiter à tous dans un rapport équilibré[6]. Le bien être des habitants d’un territoire peut être considéré comme un commun car il conditionne toute une série de conséquences aux plans économique, social et politique. Cogérer les communs sociaux d’un territoire s’oppose à l’instrumentalisation des acteurs par la puissance publique. Si nous portons l’attention sur toutes les formes d’échanges plutôt que sur le seul principe descendant des autorisations, des financements, des contrôles, nous découvrons un ensemble d’échanges subtiles et discrets qui peuvent nous servir de modèle pour une cogestion responsable des besoins des habitants.
Envisager l’organisation par ses seuils, c’est faire un pas de côté par rapport à toutes ces certitudes qui encombrent régulièrement nos champs d’action et nous empêchent de penser. Par exemple, le principe des recommandations de bonnes pratiques professionnelles devenu maintenant une évidence, mérite d’être interrogé quant à la façon dont il a évolué. Pour fonder les processus évaluatifs instaurés par la loi de 2002, il était nécessaire de se donner des références. Le conseil puis l’agence de l’évaluation sociale et médico-sociale s’y sont employés en tentant de ne pas être trop normatifs. Les premières recommandations publiées entendaient présenter un état des savoirs professionnels sur la question traitée, sans l’inscrire dans le marbre. La recommandation voulait faire repère afin de permettre aux professionnels de se situer. Au fil du temps, et des conflits d’intérêts, les recommandations se sont dégradées, de repères, elles sont devenues des cadres, c’est-à-dire des dispositifs contraignants impliquant un jugement binaire : conforme / non conforme. Une vision autocentrée supporte cette approche binaire.
Une analyse par les seuils montre autre chose, la manière dont les équipes combinent des logiques différentes dans leurs pratiques quotidiennes, dont elles font preuve d’inventivité au plus micro des actes qui sont posés de manière banale. Elles mettent en œuvre cette metis chère aux grecs, c’est-à-dire cet art de la ruse qui permet de s’ajuster aux situations, non à partir de grands principes posés en toute extériorité mais en s’adaptant, en s’ajustant. Ne pas mettre en lumière ces pratiques, c’est priver l’analyse de ce qui fait la force et la richesse des organisations du travail social.
Cela suppose de quitter une vision monoculaire des objets analysés : un seul point de vue, une seule grille de lecture et d’interprétation, une seule vérité. La vision par les seuils met en lumière la pluralité et la plurivalence des situations. Particulièrement dans le travail avec et pour autrui, la relation est marquée par le pluriel, le divers. C’est en se démarquant du fantasme d’unicité que l’on peut percevoir l’ambigu, le diffus, la disparation (c’est-à-dire la pluralité des points de vue) inhérents à toute situation.
En complément logique de ce pluriel, le regard embrasse non pas uniquement les blocs solides de l’organisation mais aussi les interstices entre eux, les écarts qui permettent la circulation des flux. Un peu comme l’urbaniste qui va aborder la ville non par ses constructions et ses pâtés de maisons mais par ses rues, ses avenues, les distances entre les bâtiments.
L’établissement ou le service social ou médico-social peut alors s’envisager comme un système ouvert. Le plus significatif pour comprendre ce qui s’y passe ne relève pas du quantifiable. Les seuils nous invitent à observer ce qui circule, les entrées et sorties (et pas uniquement celles des usagers !), les énergies structurantes qui traversent l’organisation de part en part, les chemins non institutionnels qui se dessinent en marchant comme des ribines dans les herbages[7]. L’approche par les seuils nous fait quitter une vision par les stocks au profit d’une perception des flux.
6. Incidences organisationnelles
Mais de quoi parlons-nous quand nous disons seuils ? Le seuil est un espace intermédiaire qui permet les passages. Bien entendu, il marque une entrée ou une sortie, la limite entre un dedans et un dehors. Mais il ne se situe pas uniquement aux pourtours de l’organisation. Nous pouvons identifier d’autres seuils à l’intérieur de l’organisation de la même manière que dans la maison il n’y a pas que l’entrée mais aussi ces passages qui séparent et hiérarchisent les espaces de vie internes.
Nous pouvons compléter l’image du seuil par celle de la frontière. La frontière nous intéresse parce que tout en marquant une limite, elle est aussi un lieu d’échange et de régulation car elle peut être ouverte ou fermée, doser les quantités de flux. La frontière dessine une zone frontalière. Il s’agit d’un espace liminaire qui prépare le changement d’état, de statut ou de lieu. C’est par cette association que la situation de handicap peut être vue comme un état liminaire, pas tout à fait stable, ni dedans ni dehors, sans statut définitif.
Ces délimitations confèrent des identités aux acteurs en les situant dans un espace ou un autre. C’est pourquoi il est nécessaire que les organisations disposent bien de limites, de frontières et de seuils. Les premières sont théoriques – pour un établissement social il s’agit de l’habilitation définissant un public et des missions, du cadre législatif – les secondes sont des délimitations topographiques – qui définissent des sentiments d’appartenance, des statuts, des places et des rôles – les troisièmes sont les lieux transitionnels où se jouent les échanges. C’est ainsi que nous parlons d’analyse par les seuils, c’est-à-dire par ces lieux pluriels et plurivalents qui font passage, interstice, entre-deux.
Le seuil est un espace interstitiel de l’accueil, de l’ouverture à l’autre, de l’ouverture à l’environnement. Sa porosité détermine l’inscription environnementale de l’organisation. Selon une vision autocentrée, on porte peu d’intérêt à ces interstices structurants, ainsi, les seuils sont plutôt envisagés comme des filtres, voire des clôtures, ils participent d’une distinction et d’une séparation là où la vision par les seuils élargit les appartenances en assouplissant le rapport dans / hors, en lui permettant d’être relativement flou. Nous pouvons percevoir l’intérêt que représente cette fluidification des rapports identitaires ou d’appartenance pour les publics que rejoint le travail social. L’interaction facilitée par la focalisation sur les seuils développe en conséquence des phénomènes ouverts de reconnaissance et d’identification réciproque.
Poursuivant l’analyse par les seuils, l’observateur découvre alors que, contrairement aux rhétoriques dominantes, l’organisation n’est pas construite autour d’un centre mais selon une pluralité de centres. Plutôt que de parler de centres, il est alors préférable de parler de nœuds. C’est-à-dire de ces multiples croisements de liens qui forment une sorte de tissu. Ces intersections, qui peuvent être de formes et de natures très différentes, contribuent toutes, chacune à leur manière, à structurer l’organisation. C’est un enrichissement de la compréhension de l’organisation que de mettre à jour ces nœuds structurants. Nous pourrions dire que dans une vision égocentrée, le centre est l’arbre qui cache la forêt. Le décalage du regard sur les seuils permet de voir tous les arbres qui forment cette forêt.
En ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, tentons de discerner ce que pourraient être quelques-uns de ces nœuds structurants, ces « pluri-centres ». Tout d’abord, ces organisations sont fortement contraintes par une hétéronomie, leurs règles sont imposées de l’extérieur. Les instances légiférantes constituent donc des nœuds (assemblées législatives nationales, agences régionales, services déconcentrés de l’État, départements, intercommunalités, communes…). Disant cela, nous ouvrons la perspective que des nœuds structurants de l’organisation peuvent se situer en dehors d’elle ce qui va à l’inverse d’une vision autocentrée. A l’interne, nous pouvons citer, pour exemple, les instances représentatives du personnel. Si nous quittons une vision centralisée qui réduit ces instances à leur seule relation au centre – opposition, contestation, résistance – en libérant l’analyse des deux seules forces habituellement prises en compte, centrifuges et centripètes, nous pouvons dévoiler en quoi les débats qui se jouent sur ces scènes ont un pouvoir fortement structurant pour l’organisation. Il faut préciser que structurant ne veut pas dire uniquement constructif et positif. La résistance est un élément qui influe sur l’organisation, qui lui donne forme. Nous pouvons également évoquer les espaces formels et informels de travail. Alors qu’une vision autocentrée insiste sur les espaces formels, une vision par les seuils permet de prendre en compte des dimensions informelles de travail (ce qui se passe dans les couloirs pour rester dans l’image des interstices). Les liens de coopération externes de l’organisation sont également des nœuds structurants à analyser comme influant le fonctionnement de celle-ci. Mais l’analyse doit aller encore plus dans le détail pour mettre en lumière tous les « lieux » qu’il serait trop long de citer mais où il se passe quelque chose qui modifie peu ou prou la trajectoire et le fonctionnement de l’organisation. Pour illustrer cela, au fil de travaux avec des stagiaires de formation continue, j’ai pu découvrir des lieux parfois surprenants qui ont une influence directe sur l’action : le bar voisin de l’établissement où s’échangent des idées entre usagers, professionnels et habitants, le président de cette association qui exerce une activité libérale de santé le mettant en lien avec l’environnement, le radiateur du bureau de la secrétaire où les professionnels rentrant d’une visite à domicile déposent leurs premières impressions, la page Facebook d’une aide-soignante où elle exprime un ras-le-bol de son travail qui donnera naissance à un mouvement social dans l’établissement et bien entendu la salle de pause-café et tout ce qui s’y joue !…
La liste des polysémies organisationnelles révélées par une analyse via les seuils des organisations est longue. Au polycentrisme nous pouvons ajouter la polyarchie[8]. Si l’organisation ne comporte pas qu’un centre mais un agencement réticulaire de nœuds structurants, il est logique de s’interroger sur ce qu’est, en actes, son système hiérarchique. Classiquement présenté sous forme d’une pyramide, la pensée commune adhère à l’idée qu’il n’y a qu’une ligne hiérarchique descendante qui va de la pointe supérieure – lieu supposé exclusif du pouvoir – vers la base – lieu supposé de l’exécution. Mais si nous essayons d’ouvrir cette conception monolithique du pouvoir pour le considérer, comme indiqué plus haut, comme un actif circulant, nous percevons alors des lignes plurielles qui traversent l’organisation venant corriger, modifier, influer ou contredire la ligne hiérarchique descendante. En fait, il s’agit de révéler les rapports de forces qui, en tous endroits de l’organisation, traversent les liens et créent du rapport social entre tous les acteurs et, plus largement, tous les éléments du système. Le pouvoir circule sans se fixer en un point précis de l’organisation. Il passe de main en main, permettant ainsi à des subordonnés d’influencer l’action de leur dirigeant, permettant à des pairs de développer des formes subtiles d’auto contrôle réciproque – que certains nomment solidarité ou camaraderie –, permettant de brouiller les lignes formelles d’interdépendance pour valoriser les effets systémiques de l’organisation.
Tout dirigeant un peu conscient de ses limites sait qu’il ne suffit pas de donner une consigne pour qu’elle soit exécutée, que des déformations vont intervenir entre l’ordre et sa réalisation, qu’il faut parfois passer par des alliances avec quelques personnes influentes de l’équipe pour favoriser l’acculturation de nouvelles pratiques.
Finalement, analyser une organisation par ses seuils revient à penser les bords, à élaborer les éléments périphériques. Penser et élaborer à partir du matériel collecté par une observation au plus près du terrain, c’est cela qui constitue cette forme alternative d’analyse organisationnelle. Il s’agit ici de ne pas se contenter des parties visibles et évidentes que donne à voir l’organisation, notamment à partir des rhétoriques descriptives spontanément exposées. Il s’agit, en passant par les bords et les périphéries d’aller chercher les signaux faibles qui émaillent le quotidien, de désensevelir les impensés ou les tabous que personne ne songe à citer pensant qu’il vaut toujours mieux laisser les fantômes à leur place dans les placards. Les seuils de l’organisation ne font pas clôture mais frontière. Ils nous intéressent parce qu’ils créent des espaces liminaires où le brouillage des repères, le chevauchement des lieux, le flou relatif des statuts, la dilution partielle des appartenances permettent de voir autrement ce qu’est l’organisation, la manière dont elle fonctionne, la façon dont elle interagit avec son environnement.
7. Incidences managériales
Une vision centralisatrice induit implicitement que l’intelligence de l’organisation est inversement proportionnelle à l’éloignement du centre. Autrement dit, plus on est dans le bas de la pyramide hiérarchique, moins on est pertinent pour contribuer à la construction de l’organisation. Les subalternes sont censés ne pas enrichir l’organisation autrement que par leur production formatée par les consignes qu’ils reçoivent.
La vision par les seuils porte un regard d’une toute autre nature sur la manière dont les acteurs, chacun à leur place, contribuent à l’organisation. Elle met en valeur les combinaisons qui maillent les relations internes et externes, les jeux d’alliance et de rejet, attirances et répulsions, qui conditionnent la production matérielle et les effets immatériels de l’ensemble. Ce faisant, elle dévoile les phénomènes d’intelligence collective qui se développent, parfois à l’insu des encadrants, et qui permettent la réalisation des objectifs poursuivis. Certes, l’intelligence collective n’est pas une tendance spontanée des rapports collectifs, chacun sait qu’une foule peut être bête si ses pulsions ne sont pas régulées. L’analyse doit donc s’intéresser aux formes de régulation des échanges collectifs qui influent le fonctionnement du groupe. Mais là encore, il ne suffit pas de réduire l’analyse aux aspects formels de la partie visible de l’iceberg. Par exemple, les liens informels des salariés entre eux en dehors du travail, les liens familiaux ou amoureux, les animosités, qui existent ou se nouent au sein des équipes, les complicités idéologiques, culturelles, sportives ou ludiques sont autant d’éléments qui structurent le rapport collectif.
Une conception égocentrée s’intéresse aux aspects consensuels de l’organisation : ce qui fait accord entre tous pour permettre le bon fonctionnement de l’ensemble. Le management consiste à chercher ce consensus, à le développer et à l’entretenir.
L’analyse par les seuils, c’est-à-dire fondée sur un principe de complexité, démontre assez simplement que le consensus est une fiction managériale. Tout au plus, il s’agit d’un malentendu partagé. La plupart du temps, il masque la prise de pouvoir d’un groupe dominant sur les autres. Il entretient l’illusion que, dans ce jeu de dupes, les minoritaires sont d’accord avec les autres, qu’ils adhèrent finalement au rapport de domination qui s’impose à eux. L’approche par les seuils met en exergue les désaccords qui, constamment, traversent l’organisation. C’est le propre de tout rapport d’altérité – c’est-à-dire d’une relation marquée d’abord par la différenciation des protagonistes – que de vivre en désaccord. Masquer les désaccords sous le voile illusoire du consensus, c’est taire les rapports de forces qui travaillent subversivement l’organisation. Les mettre à jour, ce n’est pas créer la guerre de tous contre tous mais c’est assumer le principe de conflictualité comme élément structurant de l’organisation.
Diriger un établissement ou un service social ou médico-social, selon cette perspective, serait prendre en compte les différences de points de vue comme une opportunité enrichissante pour le projet. La résistance au changement ne serait plus alors une force contraire à vaincre ou à contourner mais une contribution à intégrer au processus de transformation de l’organisation.
Car en effet, la décision dans l’art de diriger est un processus beaucoup plus complexe que ne le laisse penser une approche positiviste. La prise de décision est un arbitrage élaboré dans un champ de conflictualités plurielles. Elle est systématiquement – et systémiquement – influée par de nombreux facteurs. C’est une croyance magique que de penser que le dirigeant prend sa décision dans la solitude de son bureau, éventuellement après de multiples concertations et débats. Au moment de la décision, le bureau directorial est archibondé de tous les facteurs, de tous les acteurs qui influencent l’orientation choisie. Seule une analyse par les seuils – c’est-à-dire de ce qui se passe à la périphérie de ce qui est débattu, exprimé et tranché – permet de prendre conscience de cela.
8. Penser l’organisation par ses seuils pour refonder l’individuation du sujet
En filigrane de cette élaboration d’une alternative méthodologique pour analyser une organisation de travail, il y a la personne. Non qu’elle occupe un rôle central car elle est partout, dans toutes les dimensions de l’analyse. C’est sur ce point essentiel que nous souhaitons conclure cet exposé. Il y a une homologie saisissante entre les processus d’individuation des organisations et les processus d’individuation des personnes.
Car, dans ce qui précède, nous n’avons parlé de rien d’autre que d’individuation organisationnelle. L’analyse organisationnelle consiste à observer la manière dont une organisation s’individue, c’est-à-dire construit sa consistance identitaire pour elle et en elle mais aussi par les autres et pour les autres. Ce processus d’individuation, particulièrement complexe, peut s’envisager selon les deux lignes épistémologiques que nous avons identifiées plus haut : le positivisme et la systémie. La première ligne nous conduit à envisager des liens de causalité mécanique qui tentent, en quelques schémas simples, de démontrer une genèse linéaire de l’organisation en réponse à quelques principes simples qui guident le processus. La vision archétypale de cette approche est centralisée et centralisatrice. La seconde ligne introduit la pensée complexe comme matrice intellectuelle de compréhension de l’organisation. Sa genèse apparaît alors marquée par des aléas, des ruptures et des discontinuités. Ce sont ces principes d’interactivités plurielles qui sont mis en valeur afin de révéler un visage un peu plus composite de l’organisation. Plus qu’une démonstration de principes directeurs, l’analyse est une révélation de phénomènes diffus et divers. La méthode d’approche se distancie alors de la vision centralisée pour s’intéresser aux seuils, aux interstices, aux liminarités de l’organisation.
Ces deux approches de l’individuation des organisations sont applicables à l’individuation des personnes. L’ontogenèse peut emprunter soit à une conception positiviste soit à une vision systémique. Dans le premier cas, l’analyse sera guidée par une téléologie. C’est-à-dire que le processus d’individuation de l’homme est décrypté selon une représentation préétablie de celui-ci. C’est en fonction de la conception que l’on se fait de l’homme que l’on interprète son évolution, comme s’il était, a priori, appelé à devenir ce qu’il est – ou ce que nous pensons qu’il doit être. Ainsi, sa construction est une ligne droite qui est marquée par une succession de stades de développements bien organisés entre eux allant toujours vers une plus grande perfection (cette lecture explique peut-être la difficulté que nous avons collectivement à assumer la dégradation et la perte d’autonomie liée au grand âge dans notre société). Dans le second cas, l’approche par la complexité va chercher à dévoiler les phénomènes de disjonction, les hasards, les imprévus qui colorent l’individuation du sujet. De plus, cette individuation du sujet ne porte pas sur des êtres parfaitement rationnels et cohérents. Êtres de désir marqués par le manque et la frustration, ils sont sujets d’un inconscient, instance éminemment structurante du processus d’individuation qui échappe à toute rationalité automatique.
Cette homologie entre individuation organisationnelle et individuation personnelle – et les disputes épistémologiques qu’elles provoquent – nous conduit à l’aboutissement de notre démonstration. Pourquoi est-ce si important de bâtir une alternative analytique des formes d’organisation ?
La vision égocentrée instrumentalise l’organisation en la réduisant à quelques liens de cause à effet mécaniques. En ne reconnaissant pas l’organisation comme un élément vivant marqué par des phénomènes complexes, elle opère une redoutable réduction de l’organisation en dispositif. C’est-à-dire en un agencement d’éléments déterminés selon un ordre et une finalité donnés une fois pour toute et censés être immuables. Mais le plus inquiétant dans ce procédé, c’est qu’il évacue l’humain. L’homme est analysé selon sa seule capacité à apporter ou non sa contribution aux finalités téléguidées de l’organisation. Il est, lui aussi, réduit au rang d’instrument. Il devient un agent – d’ailleurs cette expression est utilisée dans certains ouvrages de management – ignorant sa capacité d’initiative, à peser sur les orientations, à influer le fonctionnement.
Il nous semble qu’une perception des organisations par leurs seuils ouvre des perspectives plus fécondes à une bonne intelligence des organisations et des hommes qui y agissent. Plutôt que de chosifier l’organisation, elle est vue comme un système complexe, vivant, c’est-à-dire dont l’évolution n’est jamais totalement déterminée, jouissant d’une certaine liberté d’autodétermination en fonction de ses rapports internes et de ses liens avec l’environnement. Ce faisant, elle laisse toute sa place à la personne, c’est-à-dire au sujet agissant avec et pour elle, dans et par elle. La capacité d’agir des personnes, inscrites dans des interactions étroites et dynamiques avec toutes les composantes de l’organisation – les acteurs humains et non humains comme nous y invite la sociologie de l’innovation – devient un élément central de l’analyse. Celle-ci ne cherche plus à justifier des modèles de compréhension préformatés mais à dévoiler toute la richesse des échanges qui se jouent dans cet espace singulier qu’est une organisation de travail.
Ce pas de côté de l’analyse revêt une importance toute particulière en ce qui concerne les organisations d’action sociale. En ce domaine plus qu’ailleurs, il est essentiel de conférer toute sa dimension de sujet à la fois aux personnes accompagnées et aux professionnels qui les accueillent. Une vision instrumentale des organisations enferme les uns et les autres dans des rationalités sclérosantes et mortifères. A l’encontre des discours modernistes qui prônent la réduction de l’action à une prestation et des organisations à des plateformes de services, il convient d’opposer une autre vision des choses. D’abord parce que l’application de ces schémas néolibéraux sur ce qui fait le quotidien des organisations du travail social ne fonctionne pas et ne produit pas les effets attendus. Il n’est qu’à voir l’incapacité de la mise en concurrence par les appels à projet à réguler correctement la réponse aux besoins. Ensuite parce que les principes technocratiques déguisés sous le voile moderniste de l’offre libérale assimilant ce champ aux règles du marché est parfaitement contre-productive. Il n’est qu’à voir les détournements des dispositifs, l’importance des non-recours ou les phénomènes de plus en plus massifs d’invisibilité sociale de certains publics. Enfin, et surtout, la prédominance de la rationalité instrumentale qui émerge par la standardisation issue de la notion de performance, par une rationalisation sans limite des cadres fonctionnels, par le formatage des pratiques via les recommandations diverses et variées est toxique pour tous les acteurs, professionnels comme usagers. Il n’est qu’à voir les phénomènes inédits et de plus en plus fréquents d’usure professionnelle, de burn-out.
Au-delà d’une méthodologie pertinente d’analyse des organisations, l’entrée par les seuils peut représenter une alternative conceptuelle à toutes ces dérives instrumentales qui menacent les organisations du travail social.
[1] Antonio Machado, Chant XXIX « proverbes et chansons ».
[2] R. Janvier, Le syndrome du trou noir, revue Directions, n°166 – juillet 2018.
[3] E. Morin, La Méthode, Le Seuil, 2008.
[4] Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Million, Grenoble, 2005.
[5] Delmas-Marty Mireille, Les forces imaginantes du droit, Le Seuil, 4 tomes, 2004-2011.
[6] Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs, pour une nouvelle approche des ressources naturelles, De Boeck éditeur, Louvain la Neuve, 2010.
[7] En Bretagne, une « ribine » est un petit sentier, un chemin.
[8] Nous empruntons ces termes à Edgar Morin, Op. Cit.
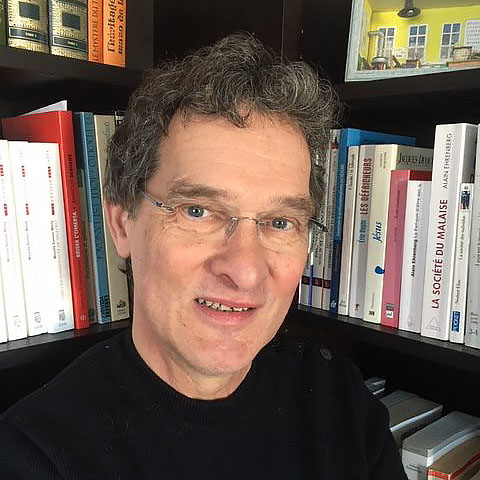
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.



Cher monsieur,
je suis vraiment heureuse d’être tombée sur votre site web; une mine d’or pour moi qui suit en formation bachelier éducateur spécialisé en accompagnement psycho social à Bruxelles. Merci pour la diffusion de vos publications grâce auxquelles je découvre tant de nouvelles connaissances.
Naïma
Merci pour ce retour.